
[Le point sur...] L’Exécution des sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage des investissements dans l’espace OHADA
par Sylvie BEBOHI EBONGO, Docteure en droit, Assistante à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université de Yaoundé II
1.Les dispositions légales existantes en matière d’exécution des sentences arbitrales dans l’espace OHADA, permettaient déjà de pouvoir faire exécuter, les sentences arbitrales prononcées dans le cadre d’un arbitrage en matière d’investissement[1]. Ces dispositions ont encore pris tout leur sens avec l’incorporation, de manière expresse, de l’arbitrage relatif aux investissements dans le champ matériel de l’arbitrage OHADA. Cette intégration résulte notamment des articles 3 de l’Acte uniforme OHADA relatif à l’arbitrage (« ci-après AUA ») N° Lexbase : A0091YTK et 2.1 du Règlement d’arbitrage CCJA (« ci-après RCCJA ») N° Lexbase : A0137YTA.
2.L’article 3 AUA N° Lexbase : A0091YTK dispose désormais que « L’arbitrage peut être fondé sur une convention d’arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements ».
3.L’article 2.1 du RCCJA N° Lexbase : A0137YTA est dans le même sens, puisqu’il dispose, « La cour peut également administrer des procédures arbitrales fondées sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements ».
4.L’élargissement du champ d’application de l’arbitrage OHADA entraîne des conséquences sur la pratique de l’arbitrage dans cet espace, notamment dans le domaine des investissements. Il en est notamment ainsi sur le plan structurel, puisque plusieurs institutions ont été amenées à modifier leur règlement d’arbitrage pour intégrer cette nouvelle donne[2].
5.De manière générale, l’exécution des sentences arbitrales issues des arbitrages relatifs aux investissements reste rare dans l’espace OHADA. Il en est ainsi notamment parce que malgré le fait que la plupart des États parties à l’OHADA soient des États d’accueil des investissements, le contentieux arbitral relatif à l’investissement se déroule souvent en dehors desdits États. Par ailleurs, les différents instruments relatifs aux investissements, qu’il s’agisse des Codes des investissements ou des Traités bilatéraux d’investissement signés entre certains États parties à l’OHADA et des États tiers et même entre les États parties à l’OHADA entre eux, font très peu référence à des centres d’arbitrage situés dans l’espace OHADA, comme potentielles institutions d’arbitrage susceptibles de résoudre les différends relatifs aux investissements[3].
6.Le contentieux arbitral en matière d’investissement, même lorsqu’il implique les États parties à l’OHADA est, en général, traité par des institutions d’arbitrage situées en dehors de l’espace OHADA ; d’ailleurs les sièges desdits arbitrages[4] sont très souvent situés en dehors dudit espace. En outre, lorsque des sentences sont prononcées, la procédure de reconnaissance et d’exécution est très souvent diligentée en dehors de l’espace OHADA. Il en résulte que la plupart des sentences en matière d’arbitrage des investissements impliquant les États parties à l’OHADA sont rendues en dehors de l’espace et exécutées hors de cet espace en l’occurrence dans les pays occidentaux, lesquels ont souvent, dans certains cas, une législation plus favorable à l’exécution des sentences arbitrales contre les États et les personnes morales de droit public. Il suit de là que les demandes d’exécution des sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage des investissements dans l’espace OHADA restent quantitativement faibles.
7.Dès lors, qu’est-ce qui peut expliquer la tendance ci-dessus constatée, alors même qu’on sait que les pays membres de l’OHADA offrent d’énormes potentialités en termes d’investissement ? Est-ce une perception que leur législation en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales n’offre pas les garanties nécessaires à une exécution effective desdites sentences ou une simple méconnaissance de l’environnement juridique qui englobe l’immunité d’exécution ?
8.Dans les développements qui vont suivre, nous allons constater que le nombre des sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage d’investissement dans l’espace OHADA ou concernant leur exécution reste relativement faible. Cela ne devrait toutefois pas faire perdre de vue qu’un cadre légal approprié pour l’exécution des sentences rendues en matière d’arbitrage des investissements existe dans l’espace OHADA (I). Par ailleurs, l’exécution forcée desdites sentences s’inscrit dans une nouvelle dynamique, celle de l’évolution favorable dans l’espace OHADA de la question de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public (II).
I. Le cadre légal de l’exécution des sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage des investissements dans l’espace OHADA
9.Il convient de distinguer, d’une part, les sentences arbitrales issues des arbitrages privés ou rendues sous l’égide des centres d’arbitrage privés internes et internationaux (A) et, d’autre part, celles rendues par les centres d’arbitrage spécifiquement dédiés à l’arbitrage d’investissement ou qui contiennent des dispositions spécifiques en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales comme le CIRDI ou la CCJA (B).
A. Les sentences arbitrales issues des arbitrages ad hoc ou rendues sous l’égide des centres d’arbitrage privés internes ou internationaux
10.Une sentence arbitrale relevant d’un litige d’investissement peut être rendue dans le cadre d’un arbitrage ad hoc. En effet, l’arbitrage ad hoc peut résulter, en dehors de toute clause contractuelle, d’un accord entre l’État et l’investisseur de soumettre le litige résultant d’un investissement à l’arbitrage. Mais bien souvent, l’arbitrage ad hoc est mis en œuvre soit sur la base de l’offre d’arbitrage contenue dans le contrat entre l’État et l’investisseur, soit de l’offre d’arbitrage contenue dans un Accord international d’investissement (AII), par laquelle l’État stipule que tout différend résultant de l’interprétation ou de l’exécution de l’investissement sera soumis à l’arbitrage ad hoc.
11.Cependant, dans la plupart des cas, les Accords internationaux d’investissement contiennent une offre d’arbitrage renvoyant, en cas de litige, au choix d’une institution d’arbitrage. Dans ce contexte, une sentence arbitrale ayant trait à un litige d’investissement peut être rendue par un centre d’arbitrage privé opérant dans l’espace OHADA. En effet, l’ouverture de l’arbitrage OHADA à l’arbitrage des investissements permet aujourd’hui, à l’ensemble des centres d’arbitrage privés situés dans l’espace OHADA de connaître de l’arbitrage des investissements.
12.L’élargissement du champ d’application de l’arbitrage OHADA apparaît, à cet effet, comme une invitation à faire confiance à des centres d’arbitrage de droit privé opérant dans l’espace OHADA pour résoudre les litiges relatifs aux investissements. Comme on a pu le relever précédemment et bien que cela soit encore relativement faible, certains Traités bilatéraux d’investissement conclus par les États parties à l’OHADA mentionnent, au titre des centres d’arbitrages susceptibles d’être choisis pour le règlement des différends relatifs aux investissements, des centres d’arbitrages de droit privé situés dans l’espace OHADA. C’est le cas du Traité bilatéral entre le Burkina Faso et la Turquie qui indique expressément le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de conciliation de Ouagadougou au nombre des centres d’arbitrages pouvant être choisis pour résoudre le différend entre une partie contractante et les investisseurs de l’autre partie contractante[5].
13.Dès lors, une sentence arbitrale issue d’un arbitrage ad hoc ou rendue sous l’égide d’un centre d’arbitrage privé dans l’espace OHADA peut y être exécutée sur la base des articles 30 et 31 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK. Les trois premiers alinéas de l’article 31 AUA N° Lexbase : A0091YTK précisent les modalités à remplir pour que la procédure d’exequatur puisse être engagée. La reconnaissance et l’exequatur seront refusés si la sentence est manifestement contraire à l’ordre public. Mais surtout, l’exequatur doit être accordé quinze (15) jours, à compter de la saisine de la juridiction ; si au bout de quinze jours la juridiction saisie ne s’est pas prononcée sur la demande d’exequatur, celui-ci est réputé être accordé.
14.La célérité en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales, instituées par le nouvel AUA N° Lexbase : A0091YTK est, à n’en point douter, l’un des points forts de la réforme de l’arbitrage OHADA ; et cette innovation majeure en l’état actuel de l’arbitrage international a été largement commentée[6].
15.Toutefois, encore faudrait-il que ce dispositif soit effectivement mis en œuvre par les juridictions étatiques. En effet, l’implémentation des dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution reste encore source de nombreuses incohérences, susceptibles de survenir, même au sein des juridictions d’un même État. Ces contradictions sont causées par plusieurs facteurs. Il en est ainsi, la liste n’étant pas exhaustive, de la coexistence entre plusieurs textes en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales[7], des pratiques différentes entre les juridictions.
16.Ainsi, la détermination du juge compétent en matière d’exécution des sentences arbitrales et son mode de saisine continuent de faire débat dans certains pays de l’espace OHADA, du fait de la juxtaposition entre plusieurs textes et de l’interprétation divergente qu’en font les praticiens.
17.Ces questions se sont en l’occurrence posées au sujet de plusieurs sentences arbitrales qui avaient été rendues en dehors de l’espace OHADA et pour lesquelles l’exécution était sollicitée dans un pays de l’espace OHADA, en l’espèce au Cameroun[8]. Bien qu’il s’agisse de l’exécution des sentences rendues dans des arbitrages commerciaux, les difficultés rencontrées illustrent à suffisance les questions qui peuvent se poser même en cas d’exécution de sentences rendues en matière d’arbitrage des investissements.
18.À côté des sentences arbitrales rendues par les centres d’arbitrage privés opérant dans l’espace OHADA, les sentences arbitrales rendues par des centres d’arbitrage internationaux en matière d’arbitrage des investissements peuvent également être exécutées. Il peut s’agir des sentences arbitrales CNUDCI, CCI, LCIA pour les centres les plus connus, mettant en cause des États ou Sociétés publiques de l’espace OHADA, et dont l’exécution doit avoir lieu sur le territoire d’un État partie à l’OHADA. Dans ce cas de figure, l’exécution de la sentence rendue sous l’égide d’un centre d’arbitrage international se fera par application de l’article 34 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK lequel dispose, « les sentences rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme sont reconnues dans les États parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables et, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions du présent acte uniforme ».
19.Bien que cette disposition ait fait l’objet de critiques pour certaines justifiées en l’occurrence s’agissant de l’omission de manière expresse de la procédure d’exequatur dans un chapitre qui traite pourtant de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales[9], il n’en reste pas moins que l’article 34 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK traite bien de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le fondement des règles différentes de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK, soit parce que les sentences ont été rendues à l’étranger, soit parce qu’elles ont été rendues dans l’espace OHADA, mais sur le fondement des règles différentes[10].
20.Dès lors, une sentence arbitrale rendue par un centre d’arbitrage situé en dehors de l’espace OHADA, peut être reconnue et exécutée dans l’espace OHADA soit dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l’acte uniforme ; en d’autres termes selon les articles 30 et 31 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK.
21.On observe cependant que l’article 34 AUA N° Lexbase : A0091YTK est appliqué de manière parcellaire, notamment par la haute Cour communautaire. C’est ainsi que dans l’affaire Société Vodacom International Limited c/ Société Congolese Wireless Network SPRL[11] relative à une sentence arbitrale CCI rendue en Belgique dont l’exequatur était sollicité en République Démocratique du Congo, pays membre de l’OHADA. La CCJA a rejeté l’application de l’AUA à la procédure d’exécution de ladite sentence arbitrale, en indiquant notamment que :
« Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme sont reconnues dans les États parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables… »
Attendu donc qu’il appert que l’exequatur des sentences arbitrales rendues dans les États tiers à l’OHADA s’opère selon les conventions internationales si l’État où la sentence a été rendue et l’État partie où la sentence est invoquée sont liés en ce domaine ; qu’en l’espèce la Belgique (pays où la sentence a été rendue) et la République Démocratique du Congo (pays de l’exécution) sont liées par des conventions internationales notamment celle de New York en date du 10 juin 1958 ; que c’est donc à tort que le Président du Tribunal a fait application de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage ».
22.On constate de prime abord que la Haute Cour ne cite pas entièrement le texte de l’article 34 AUA ; elle conclut ensuite, sans que sa décision soit juridiquement discutable per se, que le pays du siège de l’arbitrage et le pays de l’exécution de la sentence étant liés par la convention de New York, cette dernière s’applique à l’exécution de ladite sentence arbitrale et que c’est à tort que le Président du Tribunal a fait application de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK.
23.Dans une autre affaire, Ascot Commodities c/Monsieur Bocar Samba DIEW[12], relative à une sentence arbitrale rendue à Londres et dont l’exequatur était sollicité à Dakar, la Haute Cour Communautaire a indiqué que :
« Le présent acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage, lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des États parties », que selon les dispositions de l’article 34 du même acte :
« Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent Acte uniforme sont reconnues dans les États parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables… »
« Attendu en l’espèce, que la sentence dont l’exequatur est sollicité à Dakar au Sénégal a été rendue à Londres en Angleterre sous l’égide de la GAFTA ; que ces deux États sont tous membres de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de New York du 10 juin 1958 dont l’article 3 prévoit que : “Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée (…) ; qu’il ressort des dispositions combinées de cet article et de celles de l’article 34 susvisé de l’Acte uniforme précité que cet Acte uniforme n’est pas applicable au Sénégal à la sentence rendue en Angleterre”.
24.La Haute Cour semble faire une interprétation restrictive de l’article 34 AUA N° Lexbase : A0091YTK, puisqu’elle a repris le même raisonnement dans plusieurs autres affaires[13].
25.Si ces affaires ne se rapportent pas à l’arbitrage d’investissement stricto sensu, elles appellent néanmoins des observations sur la manière dont les juridictions de l’espace OHADA et, en particulier, la haute Cour communautaire appliquent l’article 34 AUA N° Lexbase : A0091YTK. Cette observation est importante d’autant que ce même article est également applicable pour des sentences rendues en matière d’arbitrage des investissements.
26.L’une des premières observations à ce sujet concerne le champ de l’application de l’AUA, tel qu’il résulte de l’article 1. L’article 1 (1) indique que l’AUA N° Lexbase : A0091YTK a « vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège de l’arbitrage se trouve dans l’un des États parties ». Avoir « vocation signifie » être « susceptible de… », sans que cela soit nécessairement une obligation. En d’autres termes, même lorsque le siège de l’arbitrage est dans l’espace OHADA, les parties peuvent décider que des règles différentes régissent la procédure. Rien n’empêcherait par exemple les parties à un arbitrage ad hoc par exemple, se déroulant dans l’espace OHADA de choisir la loi type de la CNUDCI à la place de l’AUA pour régir l’arbitrage. Cette possibilité d’écarter l’AUA comme lex arbitri est encore plus évidente lorsque l’arbitrage se déroule en dehors de l’espace OHADA.
27.Si l’AUA pose véritablement une option, à savoir qu’il peut s’appliquer ou non lorsque le siège de l’arbitrage se trouve dans l’espace OHADA, l’interprétation qui est faite de ladite option est largement différente en pratique. Cette situation se vérifie notamment à l’étape de l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans l’espace OHADA : l’AUA est habituellement évoqué pour écarter l’exécution des sentences étrangères dans l’espace OHADA.
28.Il s’agit, à notre avis, d’une position qui est critiquable pour deux raisons fondamentales :
29.Tout d’abord, à la lecture l’article 34 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK, on constate que cette disposition[14] introduit une option : principalement, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale « étrangère » se font suivant les conventions internationales applicables… ; puis à défaut, c’est-à-dire subsidiairement, la reconnaissance et l’exécution s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions de l’AUA, c’est-à-dire les articles 30 et 31 AUA N° Lexbase : A0091YTK.
30.Ensuite, il faut bien mettre en évidence la phase dans laquelle on se trouve au moment de la reconnaissance et de l’exécution : c’est la phase post-arbitrale. En d’autres termes, il ne s’agit plus de régir la procédure arbitrale elle-même. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères renvoie, sur la base de son article VII au droit national plus favorable en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales[15].
31.Il découle, par conséquent, de ce qui précède que, du fait même de la deuxième option posée à l’article 34 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK, celui-ci peut être appliqué à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, sans que cela ne soit ni en contradiction avec le texte de l’article 1, ni une mauvaise application de la loi comme l’indique à chaque fois la haute juridiction communautaire. En tout état de cause, si tel était le cas, on aurait du mal à comprendre pourquoi, le législateur communautaire aurait maintenu cette partie du texte lors de la réforme de 2017, ignorant ainsi la jurisprudence constante de la CCJA sur ledit article.
32.Il y a lieu de regretter une telle position de la Haute Cour qui se livre à une application biaisée de l’article 34 AUA N° Lexbase : A0091YTK, laquelle pourrait entraîner des conséquences négatives sur la portée d’un texte moderne qui intègre en son sein les grands principes de l’arbitrage international.
B. Les sentences arbitrales en matière d’arbitrage des investissements rendues sous l’égide du CIRDI ou de la CCJA.
33. Le CIRDI qui est le centre d’arbitrage spécifiquement dédié aux investissements, dispose d’un régime spécifique d’exécution des sentences arbitrales résultant des articles 53 et 54 de la Convention de Washington instituant le CIRDI. Ce régime spécifique d’exécution s’applique dans l’espace OHADA, lorsqu’il s’agit d’exécuter les sentences arbitrales CIRDI.
34. En effet, la plupart des États parties à l’OHADA sont États membres du CIRDI[16]. Dès lors, l’exécution des sentences arbitrales CIRDI dans l’espace OHADA obéit au régime spécifique mis en place par la convention de Washington. Il faut toutefois mentionner que malgré la spécificité de ce régime, unanimement reconnu comme autonome, les mesures d’exécution restent nationales.
35. Dans ce régime spécifique d’exécution des sentences arbitrales habituellement qualifié d’« autonome », l’exécution forcée reste à minima tributaire des États membres, puisque ces derniers doivent désigner les autorités compétentes indiquées à l’article 54 (2) de la Convention de Washington pour permettre la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales issues d’un arbitrage CIRDI. Sur les dix-sept (17) États parties à l’OHADA dix (10) ont procédé à la désignation de cette autorité[17].
36. Concrètement, pour obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale CIRDI, arbitrage des investissements par excellence dans un État partie à l’OHADA, la partie intéressée doit présenter la copie certifiée conforme de la sentence arbitrale par le Secrétaire Général du CIRDI, au Tribunal national compétent ou à toute autorité compétente que chacun des États OHADA aurait désigné à cet effet. L’autorité nationale compétente doit, ensuite, simplement apposer la formule exécutoire sur la copie de la sentence arbitrale. Les mesures d’exécution, c’est-à-dire les voies d’exécution seront ensuite exécutées selon la législation nationale de l’État dans lequel l’exécution est sollicitée[18].
37. On rencontre difficilement des cas d’exécution des sentences arbitrales CIRDI dans l’espace OHADA. En la matière, les investisseurs bénéficiaires des sentences arbitrales CIRDI qui leur sont favorables, notamment contre des États parties à l’OHADA, préfèrent solliciter leur exécution à l’étranger. On mentionnera à titre d’illustration, sans que la liste ne soit exhaustive, quelques affaires bien connues :
Benvenutti & Bonfant c/ gouvernement de la république populaire du Congo : Par une sentence arbitrale rendue sous l’égide du CIRDI, la République du Congo avait été condamnée à payer des sommes d’argent à la société Benvenutti & Bonfant qui avait sollicité l’exequatur de ladite sentence en France. Le Président du Tribunal de Grande Instance avait accordé ledit exequatur en stipulant toutefois : “qu’aucune mesure d’exécution, même conservatoire ne pourra être prise en vertu de la sentence (…) sur les biens situés en France, sans notre autorisation préalable”[19]. Cette ordonnance avait été reformée par la Cour d’appel de Paris qui avait, à ce propos, rappelé les termes de l’article 54 de la Convention de Washington et considéré que « l’ordonnance d’exequatur ne constitue pas un acte d’exécution, mais seulement un acte préalable aux mesures d’exécution… le premier juge saisi en application de l’article 54 de la Convention ne pouvait donc, sans excéder sa compétence, s’immiscer dans la seconde phase, celle de l’exécution à laquelle se rapporte la question de l’immunité d’exécution des États étrangers »[20].
Société Soabi et a. c/État du Sénégal : par une sentence arbitrale rendue sous l’égide du CIRDI, le Sénégal avait été condamné à payer à la Soabi diverses indemnités. L’exequatur obtenu par la Soabi devant le Tribunal de Grande Instance de Paris avait été annulé par la Cour d’appel de Paris. La Cour de cassation avait cassé l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris en indiquant, d’une part, que l’État étranger qui s’est soumis à la juridiction arbitrale a, par là même, accepté que l’exequatur soit accordé à la sentence, lequel ne constitue pas, en lui-même un acte d’exécution de nature à provoquer l’immunité d’exécution de l’État considéré et, d’autre part que, la convention de Washington du 18 mars 1965 a institué, en ses articles 53 et 54, un régime autonome et simplifié de reconnaissance et d’exécution qui exclut celui des articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile[21].
38. On observe par ailleurs ces dernières années, dans les litiges impliquant notamment les États ou sociétés d’États, une tendance au règlement amiable[22], notamment par voie par la conciliation[23]. Par conséquent, il n’est pas souvent nécessaire d’avoir recours à la procédure de reconnaissance et d’exécution dans toutes les affaires CIRDI dans lesquelles sont généralement impliqués certains États membres de l’OHADA.
39 .À côté de ce régime spécifique du CIRDI, il paraît nécessaire d’évoquer le régime de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales rendues sous l’égide de la CCJA qui s’applique tant en matière d’arbitrage commercial que des investissements. L’intérêt de consacrer un développement audit régime de reconnaissance et d’exécution tient à ce qu’il va même encore plus loin que celui du CIRDI. En effet, dans l’arbitrage CCJA, nonobstant l’implication d’un État dans l’arbitrage, le dispositif de reconnaissance et d’exécution développé par les États membres de l’OHADA permet que l’exequatur puisse être directement octroyé par le Président de la Cour, pour une exécution susceptible d’avoir lieu dans l’ensemble des dix – sept (17) États parties à l’OHADA.
40.C’est ainsi qu’en application de son régime de reconnaissance et d’exécution, la CCJA a eu l’occasion d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral statuant sous son égide, dans le cadre d’un des litiges ayant opposé la Société Bénin Control SA à l’État du Bénin[24]. Dans cette affaire, L’État du Bénin avait suspendu le contrat qui le liait à la Société Bénin Control SA ; cette dernière avait par conséquent saisi la CCJA d’une demande d’arbitrage conformément à la clause compromissoire insérée à l’article 49 du contrat. Le tribunal arbitral statuant sous l’égide de la CCJA avait lourdement condamné l’État du Bénin et ordonné l’exécution et la reprise du marché. Tandis que l’État du Bénin sollicitait l’annulation de ladite sentence pour violation de l’ordre public notamment, la Société Benin Control en sollicitait l’exequatur, lequel lui avait été accordé par la Haute Cour[25].
41. Une fois l’exequatur accordé par le Président de la Cour[26], comme cela a été le cas dans l’affaire sus-évoquée, seule la formule exécutoire doit être ensuite apposée, sans autre forme de procès par l’autorité compétente chargée de l’apposer telle qu’elle est en vigueur dans l’État où l’exécution est envisagée. Le dispositif mis en place pour l’exécution des sentences arbitrales dans le cadre du système d’arbitrage de la CCJA constitue, à n’en point douter, un véritable avantage comparatif qui a une signification encore plus prononcée en matière d’arbitrage des investissements.
42. En tout état de cause, après l’apposition de la formule exécutoire par l’autorité nationale désignée dans le cadre du CIRDI ou de la CCJA, commence la recherche de l’exécution véritable, c’est-à-dire l’appropriation véritable des biens du débiteur, condamné par la sentence arbitrale. En matière d’arbitrage des investissements, la question est encore plus sensible du fait de l’immunité d’exécution généralement excipée par les États ou les entités publiques. Dans l’espace OHADA, on assiste depuis quelques années à une nouvelle donne en matière d’immunité d’exécution, insufflée par a jurisprudence, laquelle a conduit à une réécriture de l’article 30 de l’AUPSVRE.
II.La nouvelle donne de l’exécution forcée dans l’espace OHADA des sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage des investissements dans l’espace OHADA : l’évolution de l’immunité d’exécution
43. L’immunité d’exécution qui fait obstacle aux voies d’exécution contre les États et personnes morales est une question sensible en droit international. Elle se situe au confluent de la protection due à l’État en tant que sujet de droit international d’une part, et du traitement qui doit lui être réservé, en sa qualité d’opérateur du commerce international d’autre part. Elle conduit depuis toujours à la recherche d’un équilibre destiné à la fois à ne pas exposer l’État en tant que souverain, de même qu’à ne pas léser les droits du créancier bénéficiaire d’une décision favorable.
44. L’immunité d’exécution dans l’espace OHADA est restée pendant longtemps enfermée dans un régime juridique traditionnel porté par l’article 30 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution ci-après AUPSVRE avant sa révision N° Lexbase : A0099YTT (A). Fort heureusement, la CCJA dans son rôle d’interprétation des actes uniformes avait amorcé, en 2018, une évolution hautement appréciable sur la question, laquelle a abouti à une réécriture de l’article 30 de l’AUPSVRE N° Lexbase : A6607134 (B).
A.Le régime juridique de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA avant la réforme de l’AUPSVRE
45. Le régime juridique de l’immunité de l’exécution dans l’espace OHADA reposait sur l’article 30 de l’AUPSVRE qui disposait N° Lexbase : A0099YTT :
« L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution ».
Toutefois les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises ».
46. L’article 30 dans l’ancienne rédaction de l’AUPSVRE N° Lexbase : A0099YTT posait, en son article 1er, le principe général de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA et en atténuait les conséquences en son article 2. Cette disposition a été appliquée pour la première fois par la Haute Cour communautaire en 2005, dans une affaire qui a fini par être célèbre, au regard du nombre de commentaires et critiques dont elle a fait l’objet : il s’agit de l’affaire Aziablévi Yovo et autres C/ Sté Togo Telecom[27]. Cet arrêt avait notamment établi le principe d’une immunité stricte au bénéfice de toutes les personnes morales de droit public, d’autant que l’article 30 AUPSVRE N° Lexbase : A0099YTT n’avait pas déterminé avec précision les personnes bénéficiaires de l’immunité d’exécution.
47. Pendant plusieurs années, la jurisprudence la CCJA était devenue monotone sur la question ; malgré les critiques, la Haute Cour communautaire appliquait de manière absolue le principe de l’immunité d’exécution. On mentionnera à titre d’exemple et de manière non exhaustive des cas dans lesquels la CCJA ne faisant aucune distinction sur la forme de l’entité, appliquait automatiquement le principe de l’immunité d’exécution, dès lors qu’une exécution forcée était requise contre une entité publique :
- - Kouatouati A. Akakpo Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé [28]- Dans cette affaire, la CCJA avait notamment indiqué que malgré que la loi togolaise soumette les entreprises publiques aux règles de droit privé, il n’en restait pas moins que lesdites entreprises bénéficient, aux termes de l’article 30 alinéa 1 de l’AUPSVRE, d’une immunité d’exécution ; par conséquent en ordonnant le sursis à exécution (…) le juge des référés d’appel de Lomé n’a rien en rien violé l’article 30 alinéa 1 de l’Acte uniforme susmentionné ;
- Société des Télécommunications du Tchad dite Sotel-TCHAD c/Société SAS Alcatel Space [29] - Dans cette affaire la CCJA avait indiqué que nonobstant l’absence dans le dossier de la législation nationale lui accordant l’immunité d’exécution, il résulte de l’article 30 visé en son alinéa 2 que les entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, échappent à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires. Ainsi, l’arrêt querellé, en ordonnant le maintien de la saisie sur Sotel, aurait violé la disposition
visée au moyen et encourrait la cassation. - Gnankou Goth Philippe c/ Fonds d’Entretien Routier dit « FER » « Société ECOBANK Côte d’Ivoire – Dans cette affaire, la CCJA avait indiqué que le « FER » réunissait les attributs d’une entreprise publique lui permettant de se prévaloir de l’immunité d’exécution prévue par l’article 30 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et que ce faisant, la loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’État qui le soumet aux règles de droit privé est inopérante à cet égard en vertu de l’article 10 du Traité OHADA[30].
48. Il s’infère de ces exemples, si l’on considère l’affaire Aziablévi Yovo c/ Société Togo Telecom comme point de départ, que l’on a assisté pendant plus de 15 (quinze) ans, à la mise en œuvre d’une conception absolue de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA. La haute juridiction communautaire appliquait l’immunité d’exécution sans aucune considération, ni de la forme de la société, ni de la catégorie des personnes qui la constituait, allant même à contre-courant des législations nationales qui soumettent pour certaines, des sociétés d’État aux règles de droit privé. On mentionnera à titre d’exemple la législation togolaise évoquée dans l’affaire Aziablévi Yovo ou ivoirienne dans l’affaire Gnankou Goth Philippe c/ Fonds d’Entretien Routier dit “FER)[31].
49. Ce courant a connu une inversion considérable par un arrêt rendu par la haute cour communautaire, lequel a ouvert la voie à une évolution appréciable de la conception de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA.
B.Une évolution de la conception de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA ayant abouti à la réécriture de l’article 30 de l’AUPSVRE
50. « Revirement », « modification du régime de l’immunité d’exécution… », « évolution jurisprudentielle » [32] tels sont les mots et expressions employés par la plupart des commentateurs de l’arrêt rendu par la CCJA le 26 avril 2018, dans l’affaire Mbulu Museso c/Société des Grands Hôtels du Congo[33], considérée désormais comme un arrêt de principe en matière d’évolution de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA.
Sur les faits, on rappellera brièvement que le Sieur Mbulu Museso, en l’espèce créancier de la Société Anonyme des Grands Hôtels du Congo, avait fait pratiquer une saisie-attribution sur les deniers cette dernière auprès des différents établissements bancaires au Congo pour avoir paiement de la somme de 59.696,7 USD. La société des Grands Hôtels du Congo contesta lesdites saisies au motif qu’elle était bénéficiaire de l’immunité d’exécution en application de l’article 30 de l’AUPSVRE. Le premier juge accédât favorablement à la sollicitation de la société et sa décision fut confirmé en appel.
C’est contre cet arrêt pourtant conforme à la jurisprudence de la CCJA en la matière que le Sieur Mbulu Museso s’est pourvu en cassation devant la CCJA, sur le moyen unique de la violation de l’article 30 de l’AUPSVRE indiquant que… l’immunité, prévue à l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, ne doit bénéficier qu’à l’État et ses démembrements et aux entreprises publiques ; qu’au regard de la législation congolaise, la défenderesse n’est pas une entreprise publique, mais une société d’économie mixte soumise au régime des sociétés privées ; qu’en lui accordant l’immunité d’exécution, les juges ont violé non seulement l’article 30 susvisé, mais aussi l’article 3 de la loi 18/10 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État.
Sur la base de ce moyen, pour la première fois, la Haute Cour a examiné la forme sous la Société était formée. Elle a rappelé le principe posé par l’article 30 AUPVSRE N° Lexbase : A6607134 et finalement décidé : « … qu’au regard de la législation congolaise, la défenderesse n’est pas une entreprise publique, mais une société d’économie mixte soumise au régime de sociétés privées ; qu’en lui accordant l’immunité d’exécution les juges ont violé non seulement l’article 30 susvisé, mais aussi l’article 3 de la loi 18/10 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’État… ».
51. Il faut dire que cet arrêt était attendu et a ainsi révolutionné la doctrine de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA. La doctrine majoritaire [34] avait pendant longtemps cette position de la CCJA qui consistait à appliquer, de manière systématique, la règle de l’immunité d’exécution dès lors qu’une mesure d’exécution devait être mise en œuvre contre une Société d’État. La CCJA appliquait la règle de l’immunité d’exécution en toutes circonstances pour les entités publiques, sans en considérer ni la forme (CCJA, 1ère Ch., n° 43/2005, 7 juillet 2005), la mission (CCJA, 2e ch., n° 09/2014, 27 février 2014 N° Lexbase : A7021WQ4), le degré de participation totale (cas du Fonds d’Entretien Routier en Côte d’Ivoire, CCJA, 1ère Ch., n° 44/2016, 18 mars 2016 N° Lexbase : A97322WD) ou partielle de l’État dans leur capital (Cas de AES Sonel Cameroun : CCJA, Ass. Plén. n° 105/2014, 4 novembre 2014 N° Lexbase : A8777WQ7) et indépendamment de leur soumission au droit privé par le droit national (cas du Port Autonome de Lomé : CCJA 3ème ch., n° 024/2014, 13 mars 2014 N° Lexbase : A4810WGA)[35].
52. L’arrêt de la CCJA en date du 26 avril 2018 a introduit une nouvelle ère en matière d’immunité d’exécution dans l’espace OHADA. Par cette jurisprudence, la CCJA a plus clairement déterminé le cercle des bénéficiaires de l’immunité d’exécution[36]. Il résulte ainsi de l’arrêt Mbulu Museso et des arrêts subséquents ayant suivi que ne peuvent ainsi bénéficier de l’immunité d’exécution :
- . Les sociétés d’économie mixte, c’est à dire celles dont une partie seulement du capital est détenue par une personne publique et qui est constituée sous une forme de droit privé (CCJA, 3e Ch., n° 103/2018, 26 avril 2018, Mbulu Museso c/Société des Grands hôtels du Congo N° Lexbase : A2142Z8T) ;
- Les sociétés de droit privé entièrement détenues par les personnes publiques (CCJA, 1ère Ch., n° 267/2019, 28 novembre 2019)[37]. En l’espèce, la constitution de la société sous l’une des formes sociétales consacrées par l’AUDSCGIE conduit à la soustraire du cercle des bénéficiaires de l’immunité d’exécution, ce malgré la présence de l’État dans son capital[38].
- En revanche, les personnes morales et les entreprises publiques en considération soit d’une disposition expresse leur octroyant ladite immunité, soit de la nature de leur mission bénéficient de l’immunité d’exécution[39]. L’immunité reconnue à ces entités n’empêche toutefois pas que des actions puissent être dirigées contre elles[40].
53. Les solutions retenues par la Haute Cour Communautaire, laquelle procède désormais à examen approfondi des entités publiques contre lesquelles les mesures d’exécution forcée sont sollicitées, pour décider si elles bénéficient ou non de l’immunité d’exécution sont conformes à celles connues en droit comparé et international[41]. En droit français notamment, on sait depuis l’arrêt Eurodif que l’immunité d’exécution dont jouit l’État est de principe ; cependant, une distinction a été établi selon la catégorie des biens, plus précisément, suivant que le bien se rattache non pas à l’exercice d’une activité de souveraineté (acte jure imperii), mais à une opération économique, commerciale ou civile de droit privé (actes jure gestionnis) qui donne lieu à la demande en justice[42], de sorte que l’immunité d’exécution peut être écartée.
54. Cependant cette position française a connu une évolution considérable, concernant notamment les missions diplomatiques des États étrangers. En effet, la Cour de cassation avait indiqué que les missions diplomatiques des États étrangers bénéficient, pour le fonctionnement de la représentation de l’État accréditaire, d’une immunité d’exécution à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale[43].
55. Par un arrêt de 2021, la Cour de cassation a étendu l’immunité d’exécution sur les avoirs bancaires des missions diplomatiques en indiquant que « l’immunité peut porter sur des comptes bancaires des missions diplomatiques présumés être affectés aux besoins de la mission de souveraineté de l’État accréditaire »[44]. L’immunité, au départ réservée aux actes de souveraineté, est étendue aux comptes bancaires des missions diplomatiques en raison de leur affectation aux missions de souveraineté de l’État accréditaire.
56. L’évolution de la conception de l’immunité d’exécution en France sera confirmée par la loi Sapin II, avec l’introduction de l’article L.111-1-3 N° Lexbase : L7408LBY du code des procédures civiles d’exécution qui impose désormais que la renonciation à l’immunité d’exécution doive être, en matière de biens diplomatiques notamment, non seulement expresse, mais également spéciale[45].
57. Il y a donc dans le droit français en matière d’immunité d’exécution une évolution qui peut apparaître en recul par rapport à la conception qui était traditionnellement admise, en ce sens qu’elle complexifie l’exécution contre les États étrangers ; toutefois, elle ne renverse pas de manière intrinsèque la possibilité d’une exécution forcée sur les personnes morales de droit public comme on avait pu l’observer avant l’évolution jurisprudentielle en droit OHADA.
58. La construction jurisprudentielle amorcée par la CCJA dès l’arrêt Mbulu museso de 2018, laquelle a abouti à la réécriture de l’article 30 de l’AUPSVRE N° Lexbase : A6607134, a été un jeu d’équilibre entre la jurisprudence antérieure de la Cour sur l’immunité d’exécution qui était rigide et les considérations contenues dans certaines législations qui l’ont également inspiré dans sa démarche d’évolution de cette question.
59. À titre d’exemple, la Haute Cour s’est appuyée sur le droit malien pour déterminer si une société anonyme, dont le capital est réparti entre l’État malien à hauteur de 99,45 % et une personne privée à hauteur de 0,51 % était ou non une entreprise publique. Elle s’est, pour ce faire, référée à l’article 2 de la loi n° 2016-061 du 30 décembre 2016 relative aux partenariats public-privé au Mali qui considère comme entreprise publique « toute entreprise sur laquelle les autorités contractantes peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation qu’elles détiennent ou des règles qui la régissent ». Par ailleurs et selon le même texte, “l’influence dominante est présumée lorsque les autorités contractantes directement ou indirectement 1) détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise… La haute cour s’est, par conséquent, fondée sur cette loi pour décider que l’État du Mali détient 99,49 % du capital et qu’au regard de la composition de son capital et de loi malienne, la CMDT est une entreprise publique au sens du droit malien et donc bénéficiaire de l’immunité d’exécution[46].
60. A contrario dans une autre affaire, Société Ivoirienne de Concept et de Gestion Mali (SICG-Mali)[47], la haute Cour écarte l’application du droit national ; elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan qui avait considéré que le fait que le capital social de la BMS soit majoritairement détenu par l’État et ses démembrements et que par ailleurs ces derniers possèdent la majorité des voix dans les organes de décision et d’administration en fait une entreprise publique. La Haute Cour Communautaire a considéré que la participation de l’État au capital d’une société privée, quoique majoritaire, constituée sous forme de société anonyme ne change pas la forme de celle-ci, malgré la participation même majoritaire de l’État.
61. L’article 30 de l’AUPSVRE révisé en octobre 2023 N° Lexbase : A6607134 et qui est entré en vigueur en février 2024 dispose désormais :
“Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles.
Les dettes visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes".
62.Il va sans dire que l’une des grandes innovations de cette nouvelle disposition de l’article 30 (1) a été, de déterminer clairement certains[48] des bénéficiaires de l’immunité d’exécution : l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Cet article innove également en ce qu’il, écarte, complètement, aux alinéas 2 et 3 la notion d’entreprise publique qui entraînait une sérieuse confusion dans l’interprétation qu’on pouvait faire de l’ancien article 30. Cette interprétation avait en effet permis aux entreprises publiques de bénéficier de l’immunité d’exécution, alors même que pour la plupart, il s’agissait de personnes morales de droit privé. En effet, l’immunité d’exécution ne s’applique aucunement aux personnes morales de droit privé, même si elles assurent la gestion d’un service public ou bénéficient des prérogatives de service public[49].
63. En adoptant cette nouvelle écriture de l’article 30, la CCJA confirme l’évolution amorcée depuis 2018 laquelle lui a permis d’adopter un critère transparent pour traiter de la question de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA : dès lors qu’une société est constituée sous l’une des formes sociétales consacrées par l’AUSCGIE N° Lexbase : A0024YT3, elle demeure une entité privée et le degré de participation, même majoritaire de l’État dans le capital de ladite société n’a pas d’incidence sur sa forme juridique.
64. Le nouvel article 30 de l’AUPSVRE N° Lexbase : A6607134 est à la fois la réponse aux critiques qui avaient été formulées par la doctrine, notamment sur la confusion entre établissement public et entreprises publiques[50], la prise en compte des textes internes de certains États parties qui avaient apporté une réponse claire au traitement de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public, de même qu’une traduction de la jurisprudence dynamique de la CCJA dont la hardiesse dans la gestion des affaires qui lui ont été présenté a permis d’établir une constante appréciable en matière d’immunité d’exécution dans l’espace OHADA.
65. Le nouveau texte de l’article 30, qui s’est enrichi de trois nouveaux tirets est aussi un texte d’ouverture à l’immunité d’exécution en matière internationale [51] notamment aux pratiques audacieuses telles que l’inscription d’office [52] ou aux tempéraments pouvant être apportés aux mesures d’exécution forcée et conservatoires à l’égard des autres personnes morales… assurant notamment un service public[53].
66. En conclusion, l’on peut affirmer sans ambages que le cadre législatif de l’espace OHADA présente toutes les garanties pour faciliter l’exécution des sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage d’investissement. La nouvelle donne en matière d’immunité d’exécution de l’État et des personnes morales de droit public, confirmée par la réécriture de l’article 30 de l’AUPSVRE N° Lexbase : A6607134, est un signal rassurant pour les milieux d’affaires et les investisseurs souhaitant opérer dans l’espace OHADA, quand on sait notamment que l’État et les entités publiques demeurent encore des acteurs majeurs de la vie économique dans la plupart des États membres de l’OHADA.
67. Par la nouvelle codification sur l’immunité d’exécution dans le nouvel AUPSVRE N° Lexbase : A6607134, la haute cour a su trouver un équilibre entre la nécessité de parvenir à un droit communautaire cohérent, solide et les législations nationales qui présentaient des particularismes, concernant notamment la définition des entreprises publiques. Il ne fait aucun doute aujourd’hui qu’on jugera de la pertinence de cette nouvelle codification à l’épreuve de la pratique, puisque c’est la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions qui permettra de juger de leur efficacité. En tout état de cause, l’on saura compter sur le rôle de gardienne de la CCJA, notamment en matière d’interprétation des actes uniformes pour rectifier le tir en cas de dérives dans l’application des nouvelles dispositions de l’AUPSVRE N° Lexbase : A6607134.
[1] Bien qu’il n’existât pas expressément de dispositions textuelles relatives à l’arbitrage des investissements dans le champ matériel de l’arbitrage OHADA, rien n’empêchait qu’un arbitrage d’investissement puisse se dérouler sous l’égide d’un texte OHADA relatif à l’arbitrage, qu’il s’agisse de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage ou du Règlement d’arbitrage CCJA. Par ailleurs, les sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage d’investissement sous d’autres cieux peuvent être exécutées dans l’espace OHADA.
[2] V. par exemple, Règlement d’arbitrage du Centre de Médiation et d’Arbitrage du GICAM, adopté le 1er novembre 2019 dont l’article 4. 2. 2ème dispose désormais : « Le Centre peut être saisi sur la base d’un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral aux investissements ».
[3] La plupart des Traités bilatéraux d’investissement (« ci-après TBI ») signés par certains États Parties à l’OHADA après la révision des textes OHADA sur l’arbitrage contiennent très peu de références renvoyant, en cas de différends, à des centres d’arbitrage situés dans l’espace OHADA. On aurait pu s’attendre à une tendance contraire, puisque les textes OHADA relatifs à l’arbitrage prévoient désormais et expressément l’arbitrage des investissements. Parmi les rares TBI signés après la réforme OHADA sur l’arbitrage, on peut mentionner le TBI Maroc-Congo (signé en 2018, mais pas encore en vigueur), TBI République Centrafricaine – Rwanda (signé en 2019, mais pas encore rentré en vigueur ; il renvoie, pour le règlement des différends entre un État et le ressortissant d’un autre État contractant au Centre international d’arbitrage de Maurice (MIAC), Côte d’Ivoire-Japon (signé en 2020, mais pas encore en vigueur), Mali -Émirats Arabes, Mali -Turquie (signés en 2018, mais pas encore en vigueur), Tchad -Émirats arabes unis (signé en 2018, mais non encore en vigueur et dont le texte est non disponible). L’un des TBI signé après l’entrée en vigueur des textes OHADA et qui fait référence à un centre d’arbitrage situé dans l’espace OHADA, est le TBI Burkina Faso-Turquie signé en 2019. Informations disponibles [en ligne], consultées le 24 mai 2024.
[4] La notion de siège ici doit être comprise dans le sens juridique, avec les conséquences que cela peut entraîner sur la lex arbitri et non comme une simple localisation du lieu de l’arbitrage.
[5] Art. 10 Accord entre le Burkina Faso et le Gouvernement de la République de Turquie sur la Promotion et la Protection réciproque des investissements, 11 avril 2019, susmentionné.
[6] A. Fénéon « L’arbitrage OHADA après la réforme du 23 novembre 2017 », Revue de l’arbitrage, Volume 2018, Issue 4 (2018), pp. 731-764 ; M. Kebe, « L’attractivité du nouveau droit de l’arbitrage OHADA », [en ligne] ; R.Ziade, Cl. Fouchard « New OHADA Arbitration texts enter into force », [en ligne]
[7] Au Cameroun notamment, la loi n° 2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et fixant leur mode de saisine, coexiste avec la loi du 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et des actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères.
[8] On peut mentionner l’affaire Safic Alcan c/Complexe Chimique Camerounais (CCC) relative à une sentence arbitrale rendue à Londres par le centre d’arbitrage de la Fédération of oils Seed and Fats limited (FOFSA) à Londres le 14 juin 2002. Le tribunal arbitral ayant condamné la société CCC au paiement des diverses sommes, la société Safic Alcan a saisi, le Président du tribunal de première instance de Douala Ndokoti d’une requête aux fins d’exequatur en date du 3 novembre 2016. Pour ce faire, la Société Safic Alcan s’est appuyée sur la loi de 2007 susmentionnée. Le Président dudit Tribunal a rejeté la requête aux motifs que le demandeur devait se conformer aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi de 2007. On peut constater la loi de 2003, qui constitue pourtant le texte de référence en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales, en ce qu’il a désigné les juridictions compétentes visées à l’acte uniforme sur l’arbitrage et leur mode de saisine, n’est pas souvent utilisé par les praticiens. Dans la pratique, la reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales étrangères sont notamment sollicités sur la base de la loi de 2007 ; l’incohérence est toujours perceptible, dans la pratique, quant au mode de saisine, alors même que la procédure d’exequatur étant non contradictoire, le juge de l’exequatur doit être saisi par requête ou motion ex-parte, ainsi que cela ressort clairement de la loi de 2003 susmentionnée.
[9] A. Brabant, M Desplats, O. Divoy, « L’exequatur des sentences arbitrales étrangères au sein de l’espace OHADA : l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage suscite toujours bien des questions (première partie) », Revue Lexbase-Afrique-OHADA, n° 6, décembre 2017 N° Lexbase : N1699BX9 [en ligne].
[10] A. Brabant, M Desplats, O. Divoy, « L’exequatur des sentences arbitrales étrangères au sein de l’espace OHADA : l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage suscite toujours bien des questions (première partie) » art. préc.
[11] CCJA, 2ème Ch., n° 003/2017 du 26 janvier 2017, Société Vodacom International c/Société Congolese Wireless Network SPRL N° Lexbase : A4763WGI.
[12] CCJA, n° 135-2021, 24 juin 2021, Ascot Commodities c/Monsieur Bocar Samba Diew N° Lexbase : A75967BX
[13] V. notamment dans le même sens CCJA, 1ère ch., n° 166/2017 du 27 juillet 2017, Société Geodis Projects Cameroon anciennement dénommée Tchad Cameroun Logistique (TCL) S.A c/Société Tenga S.A N° Lexbase : A1678WTC
[14] L’article 34 de l’AUA est cité in extenso au paragraphe 13 infra.
[15] Article VII de la Convention de New York sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères dispose : « Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux et bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée ».
[16] Au 17 juin 2024, les dix États parties (17) à l’OHADA sont parties à la Convention de Washington instituant le CIRDI. La Guinée Équatoriale qui était jusque-là le seul État partie de l’OHADA non partie à cette Convention l’a signée le 13 juin 2024 : [en ligne], consulté le 23 juin 2024.
[17] Dix (10) des États membres de L’OHADA ont procédé à la désignation de cette autorité : il s’agit du Bénin (Cour suprême), Burkina Faso (Cour suprême), Cameroun (Cour suprême, Chambre administrative), Centrafrique (Tribunal de grande instance), République du Congo (Tribunal de grande instance de Brazzaville), Côte d’Ivoire (Président du Tribunal de Première instance d’Abidjan), Niger (Tribunal de première instance dans le ressort duquel la sentence arbitrale doit être exécutée), Sénégal (Cour d’appel de Dakar), Togo (Président du Tribunal de droit moderne de première instance de Lomé), Convention[en ligne], consulté le 14 juin 2024.
[18] L’article 54(3) de la Convention de Washington prévoit en effet que : « L’exécution est régie par la législation concernant l’exécution des jugements en vigueur sur le territoire duquel on cherche à y procéder ».
[19] TGI Paris, 23 déc.1980 : Rev. arb. 1982, p.204.
[20] JDI 1981.843, note Oppetit ; C.Kessedian, Rep.drt int. Immunité, octobre 2017, n° 123.
[21] Sté SOABI et a. c/ État du Sénégal, Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juin 1991, 90-11.282, JDI 1991.1005, note Gaillard ; Rev. arb. 1991.637, note Broches.
[22] La Camerounaise des Eaux (CDE) v. Republic of Cameroon and Cameroon Water Utilities Cooperation (CAMWATER) (ICSID Case N°. CONC/19/1.
[23] Société d’Énergie et d’Eau du Gabon and Veolia Africa c/ Gabonese Republic and Société de Patrimoine du service public de l’eau potable, de l’énergie électrique et de l’assainissement (ICSID Case N° ARB/18/36).
[24] CCJA, Ass.Plén. n° 103/2015 du 15 octobre 2015, Affaire Société Benin Control SA c/ État du Bénin N° Lexbase : A8908WT4.
[25] Il convient de préciser que l’État du Bénin avait été attrait en arbitrage dans deux contrats distincts. Le premier des contrats était celui conclu avec la Société Benin Control et le deuxième avec la Société Commune de participation et Patrice Talon. Dans la première affaire, la Cour avait rejeté le recours en contestation de validité et accordé l’exequatur à la sentence, tandis que la deuxième affaire rendue le même jour, la Cour avait annulé la sentence arbitrale et refusé l’exequatur, CCJA, n°104/2015 du 15 octobre 2015 N° Lexbase : A8909WT7.
Pour un commentaire de ces deux arrêts voir, S. Bebohi Ebongo et P. Hermann Zangue, Rev. Camerounaise Arb, n° 71 octobre-novembre-décembre 2015, p.8 et s.
[26] L’article 30.2 RCCJA N° Lexbase : A0137YTA dispose : « L’exequatur est accordé, dans les quinze (15) jours du dépôt de la requête, par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge qu’il délègue à cet effet (nous soulignons) et confère à la sentence un caractère exécutoire dans les États parties. Cette procédure n’est pas contradictoire ».
[27] CCJA, 3ème ch, Arrêt n° 043/2005, 7 juillet 2005 Aziablévi Yovo c/ Société Togo Telecom
[28] CCJA, n° 024/2014, 13 mars 2014, Kouatouati A. Akakpo Danwodina et 18 autres c/ Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé N° Lexbase : A4810WGA.
[29] CCJA, 2ème ch, n° 009/2014 du 27 février 2014, Société des Télécommunications du Tchad dite Sotel-TCHAD c/Société SAS Alcatem Space N° Lexbase : A7021WQ4.
[30] CCJA 1ère Ch, Arrêt n° 044/2015 Gnankou Goth Philippe C/1) Fonds d’Entretien Routier dit « FER », 2) Société Ecobank Côte d’Ivoire N° Lexbase : A7220WGI.
Voir également pour une évocation de ces différents arrêts, J. Kodo, [en ligne]
[31] Loi togolaise n° 90/26 du 4 décembre 1990 portant réforme du cadre institutionnel et juridique des entreprises publiques ; loi n° 97-519 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d’État.
[32] V. notamment E.D. Fotso « Évolution de la jurisprudence de la CCJA sur l’immunité d’exécution », Recueil LGA, N° 4 2018, J. Kodo « Sur le revirement de la jurisprudence de la Cour de Justice et d’arbitrage de l’OHADA en matière d’immunité d’exécution », Penant 906, Janv-Mars 2019, p.102 et s., O. Bustin et H. Fanci, « Immunité d’exécution des sociétés commerciales appartenant à une personne morale de droit public : évolution de la jurisprudence de la CCJA », LEDAF – oct 2018, n° 111q1, p.2.
[33] CCJA, 3e Ch., n°103/2018, 26 avril 2018, Mbulu Museso c/Société des Grands hôtels du Congo N° Lexbase : A2142Z8T.
[34] V. notamment F.M. Sawadogo de la saisissabilité ou de l’insaisissabilité des entreprises publiques en droit OHADA (à propos de l’Arrêt CCJA du 7 juillet 2005, affaire Aziablévi Yovo et autres contre Société Togo Telecom) ohadata D-07 -16), F. Onana Etoundi, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA », Revue de droit uniforme africain, n° 000-09/08/2010 ; ohadata D-13-55.
[35] E.D. Fotso, Eyike-Vieux, « L’exclusion des personnes morales de droit privé au bénéfice de l’immunité d’exécution : réflexion à la lumière de la jurisprudence de la CCJA », Recueil LGA n° 7, avril 2020.
[36] Ce qui était appelé par la doctrine majoritaire depuis des années. Voir en ce sens F-M. Sawadogo, art.préc.,
[37] CCJA, 1ère Ch., n° 267/2019, 28 novembre 2019 N° Lexbase : A48673AI. Voir pour le commentaire de cet Arrêt, E.D. Fotso, Eyike-Vieux, art.préc.
[38] Cette position est en conformité avec l’article 1 de l’AUSCGIE qui dispose : « Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des États parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (…) est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme » N° Lexbase : A0024YT3.
[39] V. notamment sur la question, J. Kodo, « Sur le revirement de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage en matière d’immunité d’exécution », art. préc. p. 112 et s.
[40] V. notamment en ce sens, CCJA, 2e Ch., n° 032/2019 du 31 janvier 2019, État de Côte d’Ivoire, Agence comptable centrale de Dépôt c/ Monsieur Roland Tesseyre N° Lexbase : A3815YZC
[41] V. notamment en ce sens la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens.
[42] Cass. 1ère civ., 14 mars 1984, pourvoi n° 82-12642.
[43] Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 09-72.057 [LXB=9984HX3] ; Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 10-25.938, n° 11-10.450 et n° 11-13.323 N° Lexbase : A2242KBN; Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22.494 N° Lexbase : A8999W98).
[45] . J. Heymann, « La loi Sapin II et les immunités d’exécution » ; à propos de la loi n°2016 1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017. 102 ; R. Bismuth, « L’immunité d’exécution après la loi Sapin II », JDI 2018. Doctr. 4.
[46] CCJA, 2ème Ch. Arrêt n° 259/2018 du 13 décembre 2018, Société Inter Africaine de Distribution dite IAD c/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT SAEM N° Lexbase : A4983YXT
[47] CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 368/2020 du 26 novembre 2020, Société Ivoirienne de concept et de Gestion Mali (SICG-Mali c/ Banque Malienne de Solidarité Banque Malienne de solidarité Côte d’Ivoire N° Lexbase : A76724W3.
[48] Le texte indique notamment, ce qui laisse entendre qu’il ne s’agit pas d’une énumération exhaustive.
[49] Filiga Michel Sawadogo, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA – À propos de l’arrêt de la CCJA du 7 juillet 2005, Affaire Aziablévi Yovo et autres contre Société Togo Telecom », ohadata J-O6-32. Revue Camerounaise de l’arbitrage, numéro spécial, février 2010, p. 136 et s.
[50] V. notamment Filiga Michel Sawadogo, art.préc.
[51] Article 30-3, AUPSVRE révisé N° Lexbase : A6607134.
[52] Article 30-1, AUPSVRE révisé N° Lexbase : A6607134.
[53] Article 30-2, AUPSVRE révisé N° Lexbase : A6607134.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[Jurisprudence] Opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans une convention cadre
par Maurice TANKEU, Chargé de Cours (Université de Bamenda/Cameroun)
Réf:Commentaire de l’arrêt no 140-2023 du 15 juin 2023 de la CCJA : affaire la Société Scania Crédit AB -SA contre la Société Perform World – SA N° Lexbase : A70362WI
Commentaire :
Les modes alternatifs de résolution des litiges (MARL) ont été adoptés par les pays africains comme le levier de l’investissement aussi bien national qu’international. En effet, les investisseurs redoutent les juges étatiques et rechignent à les saisir pour des raisons diverses. Le recours aux MARL en général et à l’arbitrage en particulier devint ainsi le rempart de la justice des affaires, car ils offrent plusieurs avantages (confidentialité[1], célérité[2], loyauté[3]). L’arbitrage est une forme de justice dans laquelle les parties décident de soumettre le règlement de leur différend à des personnes privées. Elle se fait sur la base d’une convention signée entre les parties qui les oblige à abandonner la voie du juge national au profit du juge arbitral.
À croire que l’existence d’une convention d’arbitrage entraîne moins de tracasseries, de tergiversations et de conflits entre les parties serait une appréciation erronée. En effet, malgré l’entente antérieure ou postérieure à la naissance d’un litige, de le confier à des arbitres, il n’est pas rare de voir les juges étatiques être saisis en lieu et place du juge arbitral. L’arrêt no 140/2023 du 15 juin 2023 rendu par la CCJA dans l’affaire opposant la Société Scania Credit AB -SA, à la Société Perform World -SA N° Lexbase : A70362WI, en cassation du jugement contradictoire n° 3939/2021 du 20 janvier 2022 du tribunal de commerce d’Abidjan est une illustration parfaite.
En effet, dans le cadre d’un contrat de prêt d’argent, les Sociétés Scania Credit AB, Société anonyme de droit suédois, et la Société Perform World dont le siège social est à Abidjan avaient en date du 22 août 2018 signé une convention dite convention générale de prêt. Cet accord déterminait les conditions dans lesquelles se dérouleraient leurs rapports. Il y avait été inséré une clause compromissoire selon laquelle tous les différends qui découleraient de leur rapport devraient être réglés par trois arbitres, conformément aux règles de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm. Quelques mois plus tard, estimant que la société Perform World ne respectait pas ses engagements contractuels, la société Scania Credit AB l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce d’Abidjan.
Face à cette action, la défenderesse a soulevé l’incompétence du juge saisi au motif que l’existence d’une convention d’arbitrage, et dans le cas d’espèce, une clause compromissoire, faisait obstacle à la compétence du juge étatique pour connaître du différend. La juridiction ainsi saisie a fait droit à cette demande de se déclarer incompétente, d’où le pourvoi relevé par la société Scania Credit AB. Cette dernière, sans contester l’existence de la clause compromissoire devant la CCJA, prétend que le jugement attaqué du tribunal de commerce d’Abidjan manque de base légale. Elle faisait donc une distinction entre les conditions générales des conventions de prêt dans lesquelles figurent la clause compromissoire et les conventions de prêt et de gage.
Cette décision rendue en 2023 témoigne du contentieux nourri sur la question du juge compétent en présence d’une convention d’arbitrage. La nature de la convention d’arbitrage est fonction de l’époque de sa conclusion par rapport à la survenance du litige. Si la clause est préalable à la naissance de celui-ci, il s’agit d’une clause compromissoire. En revanche, si elle lui est postérieure, on serait en en présence d’un compromis d’arbitrage. Toutefois, il ne faut pas méconnaître la faculté reconnue aux parties de conclure une convention d’arbitrage qui viserait à la fois un litige qui les oppose déjà et des litiges susceptibles de les opposer dans le futur au sujet d’un rapport juridique déterminé. La validité d’une telle convention a d’ores et déjà été reconnue par la jurisprudence[4]. Son analyse révèle un double consentement quoique de manifestation simultanée : par rapport au litige actuel qu’il est besoin de résoudre, c’est un compromis d’arbitrage, par rapport aux litiges éventuels, il s’agit d’une clause compromissoire[5].
Dans cette affaire à l’apparence banale, mais qui illustre la vitalité du contentieux l’intervention du juge étatique en matière arbitrale, il s’était posé devant le juge la question de savoir si une juridiction étatique peut statuer en présence d’une clause d’arbitrage. La réponse de la CCJA était univoque. Le juge suprême de l’OHADA, en rejetant le pourvoi contre la décision du tribunal de Commerce d’Abidjan qui s’était déclaré incompétent pour connaître de l’affaire en cause, réaffirme sans équivoque le principe de la compétence exclusive du tribunal arbitral en présence d’une clause compromissoire et par voie de conséquence l’incompétence du juge étatique (I). Sans que cela ne résulte des faits, le juge saisit l’occasion pour rappeler au visa de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage N° Lexbase : A0091YTK les hypothèses d’une intervention exceptionnelle du juge étatique (II).
I. La réaffirmation du principe de la compétence exclusive du tribunal arbitral en présence d’une convention d’arbitrage
L’arbitrage soustrait l’administration de la justice de l’emprise du juge étatique. En rejetant le pourvoi contre le tribunal national qui a décliné sa compétence au profit du juge arbitral en présence de la clause compromissoire, la CCJA met en lumière l’effet positif de la convention d’arbitrage. Comme le relève un auteur[6], corroboré par une jurisprudence abondante[7], cette règle est régulièrement observée par les juges africains. Il convient toutefois de noter que la compétence du juge étatique ne peut être évincée (B) que si les fondements de la compétence du juge arbitral sont établis (A).
A. La précision du fondement de la compétence du juge arbitral
La compétence d’un tribunal arbitral se fonde sur l’existence d’une clause d’arbitrage valable. Cette validité est appréciée non seulement au regard de la théorie de la volonté consacrée à l’article 1108 du Code civil ivoirien N° Lexbase : A9960YSP (1), mais aussi sur les critères d’arbitrabilité qui sont particuliers au droit de l’arbitrage (2).
1 – Une clause dérivée de la volonté des parties
Selon la théorie de l’autonomie de la volonté, le contrat est le résultat de la volonté des parties. Le pacte d’arbitrage, du moins lorsqu’il ne s’agit pas d’un arbitrage forcé[8], doit impérativement émaner de la volonté des parties prenantes.
Ainsi, elle est soumise aux conditions de formation traditionnellement posées à l’égard de tout contrat[9]. Il s’agit particulièrement du consentement exprimé qui doit être libre, éclairé et exempt de vices. L’absence de consentement de l’une des parties entraîne l’inexistence de la convention d’arbitrage [10] et par conséquent l’inefficacité de la sentence rendue sur son fondement[11]. Le consentement des parties est donc cardinal pour la validité d’une clause d’arbitrage. Dans une affaire antérieure, la CCJA le rappelait en ces termes, « le consentement à la saisine du tribunal arbitral sous l’égide de la CCJA ne se présume point »[12].
En règle générale, les parties expriment leur consentement à l’arbitrage par la conclusion d’une convention d’arbitrage. « Pour faire trancher leurs litiges par des arbitres […], les parties doivent exprimer, avec le moins d’ambiguïté possible, leur consentement dans un “contrat arbitral »[13]. Elles le font, le plus souvent, au moment où elles contractent en insérant une clause compromissoire dans leur contrat. Dans l’espèce, la société Perform World évoque à l’appui de sa demande d’incompétence du juge étatique une clause compromissoire insérée dans la convention dite convention générale de prêt du 22 août 2018. Il est relevé sans équivoque que la société Scania Credit AB ne conteste pas sa volonté dans l’adoption de cette convention et par conséquent, cette clause compromissoire est l’émanation de leur consentement dont elles sont tenues de lui accorder les effets de droit qui s’y attachent comme le rappelle le juge de l’espèce : « Mais attendu qu’après avoir exactement relevé que la clause attributive de compétence en faveur d’un tribunal arbitral voulue par les parties est leur loi avec tous les effets qui s’y rapportent, le tribunal de commerce d’Abidjan, qui, en application de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, en a justement déduit son incompétence ».
Concernant l’obligation de respecter l’engagement pris, le juge fait bien de rappeler l’effet de la chose décidée. En effet, il reprend in extenso l’article 1134 du Code civil ivoirien N° Lexbase : A9960YSPqui dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C’est la traduction de la maxime : pacta sunt servanda. Le principe de l’engagement et de la force obligatoire consacre que les parties sont liées par leur engagement : ni l’une ni l’autre ne peut y échapper. Il n’est pas possible d’y renoncer unilatéralement : ce que le consentement mutuel a fait, seul ce même consentement mutuel peut le défaire. Le contrat en général et le contrat d’arbitrage en particulier crée des obligations et des droits pour les parties. Celles-ci sont ainsi obligées à lui accorder les effets en soumettant leur différend au tribunal arbitral. Le fait de saisir une juridiction étatique en lieu et place d’une juridiction arbitrale au mépris des prévisions conventionnelles était une violation flagrante de leur loi par la société Scania Crédit AB.
Au-delà de vérifier si le recours à l’arbitrage résulte de la volonté des parties, il fallait s’assurer que la convention d’arbitrage portait sur les différends arbitrables.
2 – La nécessité d’une convention obéissant aux critères d’arbitrabilité
La société Perform World et la société Scania Credit AB pouvaient-elles compromettre ? Plus encore, ont-elles compromis sur des litiges arbitrables ? La validité d’une convention d’arbitrage est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions relatives aux parties. Au-delà de cette volonté [14] qui sous-tend la validité, celle-ci peut être appréciée sur l’angle de la qualité pour compromettre (arbitrabilité subjective) et de la matière sur laquelle on peut compromettre (l’arbitrabilité objective).
Relativement à l’arbitrabilité subjective, le droit uniforme pose des règles novatrices. En effet, il est noté à l’article 2, al. 1er de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK le principe en vertu duquel « toute personne physique ou morale peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition ». Cette disposition renvoie à la règle selon laquelle la personne qui contracte doit avoir la capacité générale de contracter et la libre disposition du droit objet de la convention. Ainsi, les mineurs et les incapables majeurs, n’ayant pas la libre disposition de certains droits patrimoniaux, ne sont pas aptes à compromettre. Les personnes morales de droit privé sont aptes à compromettre dès que leur existence juridique ne souffre d’aucune contestation, mais cet engagement doit être pris par l’organe de gestion habilité à cet effet par les statuts de ladite personne morale et/ou les dispositions légales auxquelles elle est soumise[15]. Les pouvoirs de direction ou d’administration des mandataires sociaux ou représentants légaux sont suffisants à cet égard[16]. Dans l’espèce, il n’est nullement contesté de la capacité des Société Scania Credit AB et Société Perform World à compromettre, car elles sont des entités morales dotées de la personnalité juridique. De plus, aucun élément soulevé devant la Cour ne permet de remettre en cause le pouvoir des organes ayant signé la clause compromissoire de le faire. Par conséquent, la validité d’une telle clause insérée dans la convention de prêt entre les deux parties ne pouvait être remise en cause sous cet angle.
L’arbitrabilité objective quant à elle renvoie aux litiges qui sont susceptibles d’être soumis à l’arbitrage. L’article 21 du Traité OHADA N° Lexbase : A9997YS3 parle des « différends d’ordre contractuel » pouvant résulter de relations de nature civile ou commerciale tandis que l’article 2 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK parle des « droits dont on a la
libre disposition ». Les différends d’ordre contractuel sont des litiges en lien avec le contrat entre les parties pouvant survenir dans la phase précontractuelle, durant l’exécution du contrat ou encore après le contrat. Les droits dont on a la libre disposition renvoient aux droits qui sont dans le commerce et sur lesquels le titulaire a une maîtrise absolue dans la mesure qu’il peut disposer ou renoncer[17]. Certaines législations le désignent au moyen de l’expression de « droits sur lesquels, on peut transiger »[18]. Dans l’arrêt objet de cette analyse, les conditions de l’arbitrabilité objective étaient pleinement observées, car il s’agit d’un contrat de prêt d’argent entre les sociétés Scania Credit AB et Perform World dans lequel la première mettait du crédit au profit de la seconde. Le prêt d’argent par un établissement financier est indubitablement contractuel et les droits mobilisés (somme d’argent) étant pleinement à la libre disposition des parties, par conséquent une clause compromissoire indexée à cette convention est valable.
Le fondement de la compétence du juge arbitral étant parfaitement vérifié dans l’espèce, car la clause compromissoire stipulée dans le contrat de prêt résulte de la volonté des parties et porte sur les droits dont elles ont la libre disposition, il en résulte une éviction de jure de la compétence du juge étatique.
B. La réitération de l’éviction de la compétence du juge étatique
La présence d’une convention d’arbitrage valide entraîne ipso facto l’incompétence du juge étatique à connaître de l’affaire. Le choix de l’arbitrage par les parties exprime leur désir de retirer le litige du giron du juge étatique qui doit se déclarer incompétent. C’est l’effet négatif de la convention d’arbitrage consistant dans une incompétence des juridictions étatiques à l’égard de litiges pour lesquels une clause compromissoire ou un compromis ont été rédigés. Il interdit au juge étatique de connaître à titre principal du contentieux de la compétence et du fond du litige. Cette mesure assure non seulement le respect de la volonté des parties à soustraire de l’empire du juge étatique les litiges entrant dans le cadre de la convention d’arbitrage, mais, et surtout, de les soumettre à des juges privés.
Cette négation de la compétence du juge étatique n’étant pas d’ordre public, pour être effective, encore faut-il qu’elle soit soulevée par une partie (1) et avant tout débat au fond (2).
1- L’exigence d’une demande d’éviction émanant d’une partie
Il ressort de l’article 13 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK, d’ailleurs repris in extenso par le juge de l’espèce que « lorsqu’un différend faisant l’objet d’une procédure arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l’une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente ». Il s’agit d’un devoir pour le juge étatique, mais celui-ci ne peut pas relever d’office son incompétence[19]. Un auteur a à ce sujet noté que le déclinatoire de la compétence de ce juge « est conditionné par un acte positif de l’une des parties qui excipe son incompétence »[20]. L’exception d’incompétence est ainsi une exception de procédure n’ayant pas un caractère d’ordre public. Les parties doivent expressément la soulever devant le juge saisi qui ne peut d’office le faire. L’abstention de le faire peut alors être comprise comme une renonciation tacite à l’arbitrage. Elle a un effet général, absolu et irrévocable[21].
La CCJA fait une saine et bonne application du droit positif lorsqu’elle statue dans l’espèce commentée que : « le tribunal de commerce d’Abidjan, qui, en application de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, en a justement déduit son incompétence dès lors que l’une de ces parties en a fait la demande, n’a pas violé la loi ». En effet, le déclinatoire de compétence avait été bel et bien fait par la Société Perform World dès l’entame du procès comme l’exige le texte.
2 – L’exigence d’un déclinatoire de compétence in limine litis
Dans un arrêt du 4 juillet 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation[22] statuait sur le régime procédural de l’exception tirée du principe compétence-compétence, en vertu de laquelle un plaideur invoque l’incompétence du juge étatique sur le fondement d’une clause compromissoire que : « le défendeur représenté en première instance, qui aurait pu invoquer, à ce stade de la procédure, le moyen d’incompétence du juge étatique tiré de l’existence d’une clause compromissoire, et qui ne l’a pas valablement fait, est irrecevable à soulever une telle exception pour la première fois en cause d’appel ». Cette solution est une application pure et simple de l’obligation de soulever les exceptions de procédure in limine litis[23]. L’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage constitue une exception de procédure et doit de ce fait être soulevée avant tout débat au fond. Dans l’arrêt commenté, la Société Perform Word avait soulevé l’incompétence du tribunal de Commerce d’Abidjan in limine litis et c’est donc à bon droit que ce dernier s’était déclaré incompétent. Cette règle vise plusieurs objectifs. Pour corroborer les propos de Clemence Lemetais Dormesson, cette règle évite le comportement déloyal d’une partie qui pourrait s’abstenir d’invoquer l’existence d’une clause compromissoire en première instance pour la soulever en appel. En outre, cette solution s’explique par le fait que les parties peuvent renoncer à l’arbitrage au profit de la justice étatique[24]. Il ne faudrait pas qu’elles puissent revenir sur leur décision en invoquant l’arbitrage : le principe de l’estoppel les en défend formellement.
En rejetant le pourvoi contre la décision du tribunal de Commerce d’Abidjan qui a décliné sa compétence à connaître du différend opposant les parties, la CCJA a réaffirmé la compétence exclusive du juge arbitral en présence d’une clause compromissoire. Le juge suprême a reconnu ainsi l’effet obligatoire du contrat matérialisant la volonté des parties à soustraire leur litige à l’emprise du juge étatique qui ne peut être appelé à statuer que de façon exceptionnelle.
II. L’intervention exceptionnelle du juge national réitérée par la CCJA
La justice arbitrale est la chose des parties, car confiées à des institutions ou personnes privées librement choisies par elles[25]. Le juge étatique est souvent amené à intervenir dans le processus arbitral pour diverses raisons. On a ainsi pu dire qu’il n’y a pas de bon arbitrage sans bon juge. L’interférence du juge étatique n’est envisagée que de façon exceptionnelle de peur de la vider de ses fondements. Il serait impertinent d’envisager toutes les hypothèses d’intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale dans le cadre de ce commentaire. Il convient à cet effet de se limiter aux cas mis en exergue dans l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage N° Lexbase : A0091YTK et d’ailleurs repris par le juge de l’espèce. Ainsi, il ressort clairement de l’arrêt que le juge national peut intervenir en cas de clause d’arbitrage inefficace (A) ou encore lorsque les mesures d’urgence sont requises (B).
A. L’intervention du juge étatique en cas de clause d’arbitrage inefficace
L’inefficacité de la convention d’arbitrage peut résulter de sa nullité ou de son inapplicabilité. Dans ce cas, le juge étatique procède à une appréciation de l’inefficacité de la convention (1) avant de statuer au fond en cas de besoin (2).
1 – L’appréciation par le juge étatique de la nullité et l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage
Le terme « manifeste » caractérise ce dont la nature, la réalité et l’authenticité s’imposent avec évidence [26]. Il s’agit de ce qui est évident, qui saute aux yeux et ne demande pas d’investigation approfondie. Peuvent être ainsi considérés comme synonymes les mots tels que : notoire, incontestable, indiscutable, tangible ou flagrant[27], etc. La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable lorsque les conditions essentielles de sa validité ne sont pas remplies et qu’elle doit être purement et simplement écartée de la procédure. L’on peut citer le cas d’une clause compromissoire qui ne porte pas la signature de l’une des deux parties ou insérée dans une convention principale non signée des deux, entachant ainsi sa volonté de compromettre (nullité manifeste) ou d’une convention arbitrale envisagée dans un domaine non arbitrable, pénal par exemple (inapplicabilité manifeste). Il est donc hasardeux de chercher à faire une liste des causes de nullité ou d’inapplicabilité de la convention d’arbitrage. Dans l’espèce commentée, il n’est nullement contesté la validité ou l’applicabilité de la clause compromissoire entre les parties bien que la société Scania Credit AB semble distinguer « les conditions générales des conventions de prêt » et « les conventions de prêt et de gage ». Il s’agit sûrement d’un argument fantasque visant à distraire le juge.
Il se dégage du même alinéa 2 de l’article 13 N° Lexbase : A0091YTK que le juge de l’espèce rappelle fort opportunément, le pouvoir attribué au juge étatique de statuer sur sa compétence, et ce, en dernier ressort, lorsqu’il se trouve devant une convention d’arbitrage manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est fait allusion dans cette occurrence d’une nullité ou d’une inapplicabilité qui apparaît de façon évidente dont le renvoi des parties devant le tribunal arbitral ne peut entraîner qu’une perte de temps, puisque celui-ci devra certainement se déclarer incompétent[28].
Notons pour le rappeler que le juge étatique statue sur sa compétence dans les 15 jours, sa décision étant de dernier ressort, elle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant la CCJA. Au-delà de délai de 15 jours, la décision du juge étatique est considérée comme non avenue. Le juge du Tribunal de commerce d’Abidjan, en se déclarant « incompétent pour connaître de la présente cause au profit du tribunal arbitral désigné par les parties », avait ainsi statué sur sa compétente tel que prévu par l’Acte uniforme et seule la CCJA était susceptible de connaître du recours contre sa décision.
2– La compétence du juge étatique pour statuer au fond du litige
C’est la conséquence inéluctable du caractère manifeste de la nullité et de l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage. Une fois celle-ci écartée, la juridiction étatique statue sur le fond de l’affaire en appliquant le droit qui aurait dû l’être en l’absence de la convention d’arbitrage déclarée manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Bien que le juge de l’arrêt commenté ne statue pas expressément sur la compétence du juge étatique à se prononcer sur le fond du litige, il faut noter que l’office de ce dernier est encastré dans l’objet et l’étendue de sa saisine. Il ne peut donc statuer extra ou infra petita.
B. L’assistance du juge étatique en cas d’urgence
Un auteur relevait que : « Mais il n’est pas un homme, ayant l’expérience des affaires, qui n’ait eu occasion de reconnaître très souvent qu’il est des circonstances dans lesquelles le délai d’un seul jour, et même le délai de quelques heures, peuvent être la source des plus grandes injustices, et causer des pertes irréparables »[29]. Cette pensée traduit l’importance du recours au juge de référé qui statue en matière d’urgence pour éviter un péril irréparable. Faisant écho de ce postulat, le législateur de l’OHADA stipule à l’alinéa 4 de l’article 13 de l’AUA N° Lexbase : A0091YTK dispose que « Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction étatique, en cas d’urgence reconnue et motivée, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du différend au fond pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent ». Cette disposition consacre un appui du juge étatique bien identifié [30] lorsque les mesures urgentes sont nécessaires. Cet office du juge national est conditionné par une urgence dont il convient d’en préciser le contour (1) avant de préciser le cantonnement de ce dernier aux mesures provisoires et conservatoires (2).
1– L’urgence comme fondement de l’intervention du juge étatique
Malgré son apparente simplicité, la notion d’urgence n’est pas toujours facile à définir[31]. De manière sommaire, l’on peut dire que l’urgence est le caractère d’un état de fait susceptible d’entraîner, s’il n’est porté remède à bref délai, un préjudice irréparable, sans qu’il y’ait toujours nécessairement péril imminent[32]. Il y a urgence dès que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable[33].
Les questions urgentes relèvent de la compétence du juge de référé. Sauf si le demandeur est forclos du droit d’agir au fond, une demande en référé peut être introduite en dehors même de toute instance au fond[34], comme un incident d’une demande soumise à une autre juridiction, ou encore lorsque l’instance est terminée pour statuer sur des difficultés urgentes d’exécution[35]. La compétence du juge de référé doit être limitée à ce que commande sa raison d’être. En cas de disparition de l’urgence qui a conditionné la compétence du juge et appréciée au moment de sa saisine, la demande est sans objet[36]. Ainsi, l’urgence doit donc exister non seulement lors de l’introduction de la procédure, mais jusqu’à la clôture des débats[37].
En matière d’arbitrage en particulier, le juge étatique statue lorsqu’une demande lui en a été faite sur les mesures urgentes sollicitées par les parties. Il importe toutefois de préciser que lorsque le tribunal arbitral a déjà été constitué, le juge étatique et l’arbitre disposent d’une compétence concurrente pour l’octroi des mesures provisoires. La partie qui sollicite lesdites mesures a le choix de porter sa demande soit devant l’arbitre déjà saisi, soit devant le juge étatique compétent.
Face à cette concurrence entre le juge étatique et le juge arbitral, il est recommandé de recourir au juge étatique, car la décision qu’il rend n’a pas besoin de l’exequatur pour une exécution dans un pays non membre de l’OHADA ou une exécution forcée au plan interne[38]. Les juridictions étatiques sont ainsi jugées plus efficaces tant en raison de la possibilité de les saisir d’urgence qu’en raison du caractère exécutoire des décisions qu’elles sont susceptibles de rendre. Dans l’affaire commentée, il n’est nullement fait allusion à une situation d’urgence pouvant justifier la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan au regard des règles pertinentes applicables. On peut donc, sur cet angle, dire que ce juge, en déclinant sa compétence au profit du tribunal arbitral a fait bonne application de la loi.
2- Le cantonnement du juge aux mesures provisoires et conservatoires
Lorsque le juge étatique est appelé à intervenir dans une instance arbitrale en cas d’urgence, il doit se limiter aux mesures provisoires et conservatoires sans préjudicier au fond du litige. Les mesures provisoires peuvent être appréhendées comme toute mesure à caractère temporaire, précaire ou transitoire. Elles sont particulièrement marquées par la cessation de leurs effets lorsqu’intervient le jugement définitif au fond. Les mesures conservatoires visent à assurer l’entretien d’un droit ou un bien, à préserver une situation ou des preuves. Elles ont également un caractère provisoire[39]. Le juge étatique appelé à se prononcer sur les mesures provisoires et conservatoires doit s’abstenir d’examiner les droits des parties sous peine de cassation[40]. Le juge de référé qui examine les mesures provisoires ne doit préjuger de ce que le juge du fond pourrait décider. Ainsi, la Cour d’appel du Littoral retenait la compétence du juge étatique pour prendre, sur demande d’une partie, des mesures provisoires visant uniquement la suspension des effets d’une convention d’arbitrage[41]. Afin d’assurer l’intégrité du fond du litige face au juge du provisoire, la CCJA a relevé l’incompétence du juge des référés lorsqu’une action tendait à obtenir la mainlevée du gage constitué aux termes de la convention de garantie à première demande et qui impliquait nécessairement l’examen au fond sur la validité de la convention de garantie conclue entre deux parties[42]. Cette mesure ne doit pas être érigée en règle absolue. En effet, au cas où le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, refuser au juge étatique de se prononcer sur les mesures provisoires qui impliqueraient un léger examen au fond serait un déni de justice. La Cour d’appel de Niamey dans une décision pragmatique avait dans une affaire où la mesure demandée amenait à apprécier le caractère non contestable d’une créance a admis la compétence du juge étatique[43].
En définitive, le juge de la CCJA était appelé à statuer sur la question de savoir si une juridiction étatique peut statuer en présence d’une clause d’arbitrage. En rejetant le pourvoi en cassation contre la décision du Tribunal de commerce d’Abidjan qui avait décliné sa compétence, le juge suprême a catégoriquement répondu par la négative. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la CCJA qui concoure à assurer l’exclusivité du tribunal arbitral en présence d’une clause d’arbitrage valable et applicable. Le juge d’appui à l’arbitrage ne doit intervenir que de manière très limitée au risque de vider l’arbitrage de ses principes fondamentaux. Même si l’œuvre législative, doctrinale et jurisprudence semble aujourd’hui parachever le régime de cette institution, il n’en demeure pas moins que beaucoup reste à faire. L’acceptation de l’intervention du juge étatique en matière provisoire lorsqu’il y a nécessité d’un léger examen au fond du litige marque aujourd’hui est avancée notable. Toutefois, cette ouverture peut constituer une boîte à pandore si elle n’est pas bien encadrée.
[1] La confidentialité est le caractère de ce qui est confidentiel, c’est-à-dire qui n’est pas révélé au grand public. La confidentialité de la justice arbitrale s’oppose à la publicité de la justice étatique qui est par nature publique dont le déroulement se fait dans une salle ouverte au public avec possibilité d’accès aux médias.
[2] La célérité peut être définie comme une urgence renforcée justifiant une promptitude particulière d’intervention. Elle exige à tout intervenant à la procédure d’agir avec diligence.
[3] La loyauté dans l’arbitrage peut être conçue comme étant le bon comportement qui consiste, pour chaque adversaire, à mettre l’autre à même d’organiser sa défense, en lui communiquant en temps utile ses moyens de défense et de preuve (G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit. p. 156).
[4] Cass. req., 13 janvier 1947, S., 1947, 1, p. 77 cité par M. de Boisseson, Le droit français de l’arbitrage interne et international, préface de P. Bellet, GLN-éditions, Paris, 1990, p. 79.
[5] V. O. Diallo, Le consentement des parties à l’arbitrage international, Nouvelle édition [en ligne], Genève : Graduate Institute Publications, PUF, 2010, p.86.
[6] N. Aka, A. Fénéon et J.-M. Tchakoua, Le nouveau droit de l’arbitrage et de la médiation en Afrique (Ohada), LGDJ, 2018, p.87.
[7] CA Ouagadougou, arrêt nº 116 du 19 mai 2006, Ohadata, J-09-25 ; CA d’Abidjan, arrêt nº 1032 du 30 juill. 2002, Ohadata J-03-28 ; Tribunal de commerce de Kayes au Mali, jugement du 5 juill. 2007, cité par P. MEYER, in Ohada : Traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope 2016, p. 165 ; CCJA, arrêt nº 082/2014 du 22 mai 2014 N° Lexbase : A8378WQD
[8] L’arbitrage est forcé lorsqu’il existe une disposition légale qui décrète que tel ordre de litige sera obligatoirement soumis à des arbitres. Voir : G. Cornu (éd.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 8e éd.,
PUF, Paris, 2000, V° Arbitrage forcé ou obligatoire, p. 67 ; R. M. Rodman, Commercial Arbitration with forms, West Publishing Co., 1984, p. 3.
[9] V. en ce sens l’art. 1108 du Code civil N° Lexbase : A9960YSP.
[10] Et donc incompétence de la juridiction arbitrale, Sentence arbitrale partielle du 20 octobre 2004, aff. Ngando Bebey c/ Société AXA Assurances, Rev. arb. n° 26, juillet-août-septembre 2004, p. 3, note Roger Sockeng, Ohadata J-08-165.
[11] Cour d’appel de l’Ouest-Cameroun, Arrêt n° 21/civ du 12 mars 2008, aff. Société British American Tabacco (BAT) c/ Ritz Palace Night-Clubs, Ohadata J-08-133.
[12] V. CCJA, 17 avril 2014, État du Mali c/ CFAO, Cahiers de l’arbitrage, 2015, n° 3, p. 561, note A. Ngwanza.
[13] M. de Boisseson, Le droit français de l’arbitrage interne et international, préface de P. Bellet, GLN-éditions, Paris, 1990, p. 139 et s. ; V. aussi : O. Diallo, Le consentement des parties à l’arbitrage international, Nouvelle édition [en ligne], Genève : Graduate Institute Publications, PUF, 2010, pp.85 et s., [En ligne]
[14] Voir supra.
[15] Il s’agit des gérants dans la SNC (l’article 277-1 AUDSCGIE N° Lexbase : A0024YT3) ; la SCS (l’article 298 AUDSCGIE N° Lexbase : A0024YT3) et la SARL (l’article 329 AUDSCGIE N° Lexbase : A0024YT3), du PDG (l’article 465 AUDSCGIE N° Lexbase : A0024YT3) ; du PCA (l’article 477 AUDSCGIE N° Lexbase : A0024YT3) du DG (l’article 487 et 488) et l’Administrateur général (l’article 498 AUDSCGIE N° Lexbase : A0024YT3) dans les SA et enfin, les administrateurs (l’article 879 AUDSCGIE N° Lexbase : A0024YT3) dans les GIE.
[16] D. Cohen, « L’engagement des sociétés à l’arbitrage », Rev. Arb. 2006, en matière d’arbitrage interne, n° 12 et s ; Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international, Montchrestien, Lextenso, 2013, p. 107 ; C.C. Tsafack Djoumessi, La justice arbitrale dans l’espace OHADA, thèse, p. 38 à 41.
[17] V. P. Level, « L’arbitrabilité », in Perspectives d’évolution du droit français de l’arbitrage, Rev. arb. 1992, p. 219 ; N. Aka, A. Fénéon et J.-M. Tchakoua, op. cit., p. 33 et s.
[18] Lire l’art. 2059 C. civ. Français N° Lexbase : L2305ABY ; l’art. 1030 (3) du C.P.C. néerlandais, l’art. 442 du C.P.C. algérien ; l’art. 74 (4) du Code tunisien de l’arbitrage.
[19] V. CCJA, 3ème ch., 7 jull. 2016, Arrêt. n° 129/2016, , Aff. UBA C/ Sté Grassfields Holding Limited, GBL C2 N° Lexbase : A9100WYP.
[20] V. C.C. Tsafack Djoumessi, thèse précitée, p.16, no 148.
[21] V. C.C. Tsafack Djoumessi, thèse précitée, p.17, no 150.
[22] Cass. 1ère civ., 4 juill. 2018, n°17-22.103 N° Lexbase : A5525XXW
[23] Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil, Ch. sociale, Arrêt du 22 juillet 2008, aff. Koumba Koudjo c/ La Confédération Syndicale Gabonaise et la Société Cora Wood Gabon, Ohadata J-08-174. CA de Pointe Noire (Congo) arrêt nº 046 du 7 nov. 2008.
[24] Cass. 1ère civ. 20 avr. 2017, n°16-11413 N° Lexbase : A3102WA7 qui rejette le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel qui avait notamment jugé que la saisine du juge consulaire et l’abstention de la défenderesse de soulever in limine litis l’exception d’incompétence tirée des clause compromissoires caractérisaient l’intention des parties de renoncer à ces clauses. Voir aussi : TPI de Cotonou, 1re ch. com., jugement nº 025 du 2 sept. 2002, Ohadata J-05-294 ;
CCJA, arrêt nº 009/2006 du 29 juin 2006, Recueil jurisprudence n° 7, janvier-juin 2006, p. 38 ; Le juris-Ohada nº 4 : 2006, p. 2 ; CCJA, arrêt nº 047/2010 du 15 juill. 2010 N° Lexbase : A4707XDP
[25] On fait ainsi le distinguo entre l’arbitrage ad hoc et l’arbitrage institutionnel. L’arbitrage institutionnel est celui qui se fait sous l’égide d’un centre d’arbitrage auquel les parties ont décidé d’y recourir tandis que l’arbitrage ad hoc est assuré par des arbitres de circonstance choisis par des parties en dehors de toute institution permanente.
[26] Voir le Dictionnaire Le Robert, Dictionnaire en ligne
[27] Idem.
[28] V. N. AKA ; A. Feneon ; J-M. Tchakoua, Le nouveau droit de l’arbitrage et la médiation en Afrique (OHADA), éd., LGDJ, 2018, p. 90
[29] Real cité par G. de Leval, « Le référé en droit judiciaire privé », Revue de la Faculté de Droit de Liège, deuxième année, 1992.3, p. 855.
[30] Voir au Cameroun, la Loi n° 2003/009 du 10 juillet 2003 N° Lexbase : A8184X8M désignant les juridictions compétentes visées par l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; au Bénin, la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 N° Lexbase : A83923LE portant organisation judiciaire ; en Côte d’Ivoire, l’Ordonnance n° 2012-152 du 9 février 2012 déterminant l’intervention des juridictions nationales dans la procédure d’arbitrage ; au Sénégal, le Décret n° 2016-1192 portant désignation de la juridiction nationale compétente en matière de coopération étatique dans le cadre de l’arbitrage.
[31] Certains auteurs ont même pu dire que l’appréciation de l’urgence est fonction d’une comparaison entre ce qui risquerait d’être et ce qui doit être et que cette notion était d’une « déconcertante malléabilité » (V. BAOUSSON, C. Langlamet, S. Marquet, D. Veron, « La notion d’urgence en référé [Analyse de la jurisprudence des Cours d’Angers et de Rennes] », in Revue Judiciaire de l’Ouest, 1987-2. pp. 173-179)
[32] Voir J. Robert, « Les situations d’urgence en droit constitutionnel », R.I.D.C., 1990, p.751-764.
[33] Cass., 21 mars 1985, Pas., 1985, I, 908. Voir G. de Leval, « Le référé en droit judiciaire privé », op. cit. p. 866.
[34] Mais le maintien de la mesure ordonnée par le juge des référés est subordonné à l’introduction de la procédure au fond dans un délai déterminé.
[35] A. Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 325, n° 442.
[36] Cass., 6 mai 1991, Pas., 1991, I, 788 ; Cass., 10 avril 2003, inédit, C. 02.0229.F/1, disponible [En ligne]. Voir aussi J. Englebert, « Inédits de droit judiciaire (VI) – Référé (2) », J.L.M.B., 1992, p. 508 à 530. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 mai 1998, précisé cette règle en décidant que le juge des référés « apprécie l’urgence de la cause au moment de sa décision » (Cass., 11 mai 1998, Pas., 1998, I, 536).
[37] Cass., 4 nov. 1976, Pas., 1977, I, p. 260 ; Cass., 6 mai 1991, Bull., 1991, p.788 ; J. Englebert, « Inédits de droit judiciaire – Référés », J.L.M.B., 1992, p. 512.
[38] L’arbitre est dépourvu de l’imperium ce qui rend peu efficaces les décisions qu’il peut prendre en attendant l’exequatur du juge étatique.
[39] À titre d’exemple, on peut saisir le juge étatique avant la saisine des arbitres pour solliciter la mise sous séquestre de loyers provenant de la location-gérance, même s’il existe une convention d’arbitrage, car le séquestre de loyers est une mesure provisoire (TGI WOURI [Cameroun], Jug. n° 640, 03 juin 2011. Aff. Illoul Christian Antoine c/ Rongiconi Charles Philippe, Code bleu, éd., Juriafrique, 2018, p. 1126). On peut aussi citer la nomination d’un mandataire, la nomination d’un administrateur judiciaire ou bien encore l’inscription provisoire d’hypothèque.
[40] Voir J. van Compernolle, « Actualité du référé », Ann. Louv., 1991, p.141-172 ; P. Marchal, Les référés, Larcier, 1992, p. 56, n° 26.
[41] CA Littoral Douala (Cameroun), arrêt n° 33/REF, 08 janvier 1997, Aff. Société Reemtsma c/ Société Sitabac, Code bleu, éd., Juriafrique, 2018, p. 1128.
[42] CCJA, arrêt n° 018/2015 du 2 avril 2015, Aff. Société United Bank for Africa (UBA) c/ Société Beneficial life Insurance (BLI) N° Lexbase : A4892WGB. Voir aussi : CCJA, arrêt nº 047/2015 du 27 avr. 2015, Ohadata J-16-47 N° Lexbase : A6565WRL.
[43] CA Niamey, arrêt nº 142 du 24 déc. 2003, Ohadata J-04-75.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[En librairie] Droit comparé de l'arbitrage en droit mozambicain et en droit OHADA
par La rédaction Lexbase Afrique OHADA

Cet ouvrage a été rédigé en portugais par Dr. Nelson Osman Jeque sous la direction scientifique de Me Olivier Bustin.
Co-préfacé par Monsieur le professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, Secrétaire Permanent de l'OHADA et par Me Olivier Bustin, publié par l'éditeur Lamy Éditions en partenariat avec Les Éditions de l'ERSUMA, cet ouvrage est le premier livre de la collection de six ouvrages de droit comparé droit OHADA et droit mozambicain des affaires, annoncée par la lettre d'information www.ohada.com du 21 janvier 2022.
Sa publication a été rendue possible grâce au soutien notamment de l'association ACP Légal Océan Indien, de TotalEnergies, du Département de Mayotte, de l'éditeur Lamy Éditions et de l'ERSUMA.
L'arbitrage un mode alternatif est un mode de résolution des différends, apprécié et utilisé autant par les entreprises de droit privé que celles de droit public, en raison notamment de l'expertise technique et du temps que l'arbitre ou le tribunal arbitral peut dédier aux parties en litige, tout en assurant la confidentialité des débats.
Le Mozambique et l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) ont chacun adopté des règles en matière d'arbitrage inspirées, avec quelques ajustements, de la loi type sur l'arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI). C'est donc sans surprise, que la comparaison entre ces deux régimes fait ressortir à la fois des similitudes et quelques spécificités.
L'étude comparée du droit de l'arbitrage de ces deux pays contribue à mettre en évidence la nécessité d'en améliorer certains aspects. Par ailleurs, afin de promouvoir un plus grand nombre d'investissements, en particulier les investissements intra-africains, il est nécessaire de renforcer l'harmonisation juridique au sein des différents blocs régionaux du continent.
Il fera l'objet, ainsi que les cinq autres ouvrages de la collection en cours de publication, de conférences de présentation et dédicaces dans les grandes villes du Mozambique en fin d'année.
cet ouvrage, à l'instar de l'ensemble de la collection, constitue une contribution précieuse au rapprochement du Mozambique avec l'espace juridique unifié de l'OHADA ainsi qu'à la promotion du droit OHADA dans l'ensemble de l'Afrique lusophone.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[En librairie] Système comptable OHADA (5e Édition)
par La rédaction Lexbase Afrique OHADA
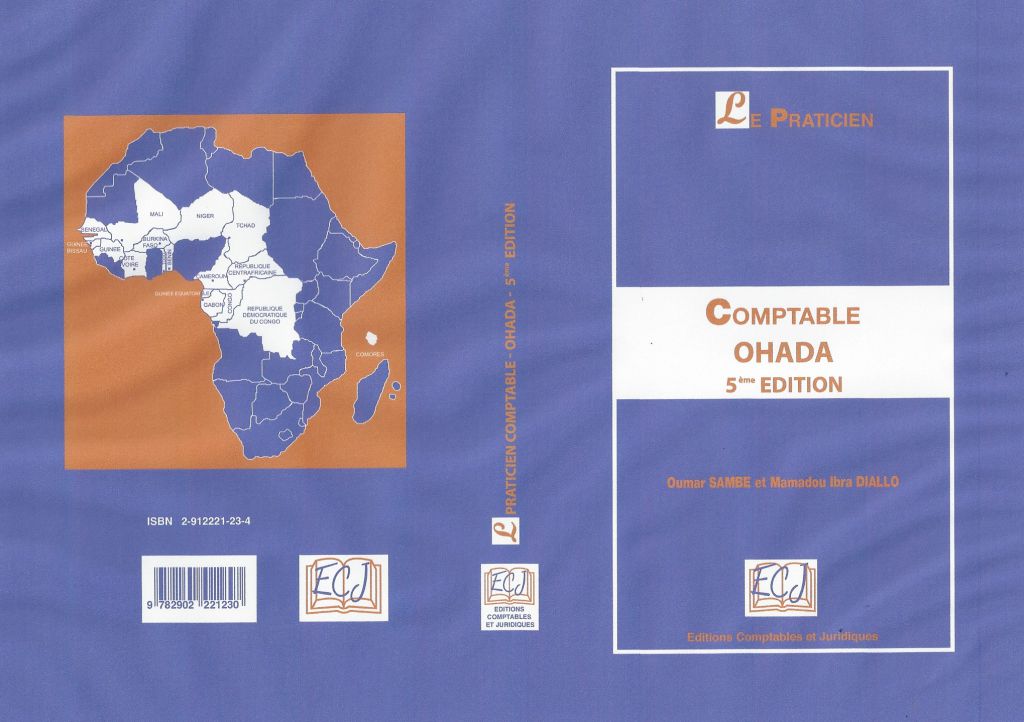
Le praticien comptable - OHADA 5e Edition [Memento du SYSCOHADA et du SYCEBNL].
Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour :
- des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie
- et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.
Cette actualité rend nécessaire de disposer d'un outil de travail pratique et complet. C'est ce que vous proposent les Editions Comptables et Juridique à travers le praticien comptable - OHADA 5e Edition.
Ce livre de référence de 1554 pages traite :
Dans la première partie relative au SYSCOHADA
- - l'historique et l'évolution de la comptabilité
- - une présentation générale de la comptabilité du Système Comptable OHADA
- - l'intégralité des dispositions du Système Comptable OHADA
- - le contrôle interne et les contrôles externes (audit et commissariats aux comptes)
- - les dispositions relatives au droit des sociétés, au droit commercial et à la fiscalité, nécessaires à la compréhension de chaque point traité
- - une étude exhaustive et pratique des comptabilités spéciales :
- - Concession de services publics
- - Opérations en participation et GIE
- - Contrats pluri-exercices
- - Opérations faites pour le compte de tiers, intermédiaire de commerce
- - Opérations effectuées par les succursales
- - Fusion, absorption apport partiel d'actif
- - Consolidation
- - Comptes combinés
- - Tous les aspects de la comptabilité des sociétés (constitution, emprunts obligataires, augmentation capital, ...)
Dans la deuxième partie consacrée au SYCEBNL, uniquement les points spécifiques aux associations, aux ordres professionnels et aux projets de développement. Tout ce qui est applicable aux entités à but non lucratif dans la première partie n'est pas repris pour éviter des répétitions. Sont donc abordés :
- les immobilisations destinées à la vente provenant de dons et legs non encore reçus
- - les usufruits reçus en donation temporaire
- - les donations et legs
- - les fonds propres et assimilés
- - les fonds affectés
- - les fonds reportés
- - les cotisations
- - les revenus des activités économiques
- - le bénévolat
- - les fonds d'investissement
- - les fonds d'administration
- - deux modèles d'états financiers: l'un pour les associations et l'autre pour les projets de développement.
- Plus de 280 schémas d'écritures et de cas pratiques résolus sont proposés pour une meilleure compréhension des différents points abordés.
Un index alphabétique détaillé assure un accès facile et rapide aux informations et permet une consultation aisée.
- Le praticien comptable SYSCOHADA 5e Edition est un excellent viatique pour la mise à niveau des parties prenantes de la comptabilité : il est exhaustif, digeste, pragmatique, convivial et donc accessible au plus grand nombre.
- Le plan de comptes et états financiers du SYCEBNL. Ce fascicule, permet au comptable d'avoir à portée de main la nomenclature des comptes du SYSCEBNL une découpe de 10 encoches répertoire qui permet d'accéder directement aux comptes de la classe 1 à 9 et aux états financiers.
La liste des points de vente est disponible [en ligne]
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[Jurisprudence] Recevabilité d'un pourvoi devant la CCJA : Sur les conditions de régularisation d'un recours et le dessaisissement d'une Cour d'appel statuant hors délais
par Jocelyne Yvonne MEGOU EBOCK, Docteure en droit, Assistante à l’Université de Bamenda-Cameroun
Réf:CCJA, 13 juillet 2023, Arrêt N° 171/2023, Société Internationale d’Assurances Multirisques (SIDAM SA) c/ Société MCI Care Côte d’Ivoire, N° Lexbase : A35432EX
CCJA, 1re ch., 13 juillet 2023, arrêt n° 171/2023
ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA)
--------
COUR COMMUNE DE JUSTICE
ET D’ARBITRAGE (CCJA)
Première chambre
-------
Audience publique du 13 juillet 2023
Pourvoi : n° 166/2022/PC du 16/05/2022
Affaire : Société Internationale d’Assurances Multirisques (SIDAM SA)
Contre
Société MCI Care Côte d’Ivoire, Ex MCI SOGEM
Arrêt N° 171/2023 du 13 juillet 2023
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 13 juillet 2023 (…)
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 16 mai 2022, sous le n°166/2022/PC (…) en cassation de l’arrêt RG n° 937/2021 du 24 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SIDAM ;
Déclare recevable le recours en annulation formé par la société MCI Care Côte d’Ivoire, Ex MCI-SOGEM contre la sentence arbitrale N° CACI :179-ARB/21 rendue le 17 novembre 2021 sous l’égide de la CACI par le tribunal arbitral ; Annule ladite sentence arbitrale ;
Condamne la Société Internationale d’Assurances Multirisques dite SIDAM SA aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit du Cabinet d’Avocats KOUABENAN, Avocats à la Cour aux offres de droit. » ;
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
(…)
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que, par convention en date du 18 avril 2012, la SIDAM confiait à la société MCI Care CÔTE D’IVOIRE la gestion de portefeuilles d’assurance « maladie » contenant chacun plusieurs assurés et bénéficiaires et dénommés SIDAM, SIDAM- COOPEC, SIDAMCORA, OLAM ; qu’en exécution de la convention, la société MCI Care était chargée du paiement des sinistres découlant de la gestion desdits portefeuilles moyennant une commission et le remboursement des débours engagés sur présentation des bordereaux de sinistres et de factures à la SIDAM ; qu’estimant que cette dernière restait lui devoir un montant reliquataire de 1.467.335.637 FCFA sur un total de 7.927.248.950 FCFA retenu après rapprochement des parties, la société MCI Care saisissait la Cour arbitrale de Côte d’Ivoire (CACI) pour demander le paiement dudit montant augmenté des sinistres et honoraires postérieurs à la date du 23 février 2018 à laquelle ils avaient arrêté leurs comptes ; qu’après avoir homologué le rapport d’expertise commandité pour l’occasion, le tribunal arbitral, constitué sous l’égide de la CACI, condamnait la SIDAM SA à payer à MCI Care la somme de 125.821.851 FCFA, outre celle de 5.001.891 FCFA au titre des intérêts moratoires, soit au total la somme de 130.823.742 FCFA, condamnait MCI Care à payer à la SIDAM SA la somme de 569.197.164 FCFA et ordonnait la compensation entre ces différents montants, ce qui mettait finalement à la charge de MCI Care la somme de 438.373.422 FCFA à payer à la SIDAM SA ; que sur recours de la MCI Care, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan rendait l’arrêt annulant la sentence arbitrale et qui fait l’objet du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, la société MCI Care COTE D’IVOIRE a soulevé l’irrecevabilité du recours en cassation au motif, d’une part, que la requête aux fins de pourvoi ne mentionne pas le nom et l’adresse de l’avocat ayant occupé pour la défenderesse au pourvoi devant la juridiction nationale dont la décision fait l’objet du pourvoi, la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié à la SIDAM SA, alors, selon la défenderesse, qu’en application de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour, de tels manquements non régularisés entraînent l’irrecevabilité du recours ;
Mais attendu que l’absence des mentions prévues à l’article 28 précité dans la requête aux fins de pourvoi n’entraine l’irrecevabilité du recours que suite à une demande de régularisation formulée par le greffe à l’attention du requérant et restée infructueuse ; qu’en l’espèce, aucune demande de régularisation du recours n’a été adressée à la SIDAM SA ; que le pourvoi est donc recevable ; qu’il échet dès lors de rejeter la fin de non-recevoir comme non fondée ;
Sur l’excès de pouvoir, relevé d’office
Attendu que l’excès de pouvoir, prévu à l’article 28 bis du Règlement de procédure, sanctionne la décision prise par une juridiction en dehors de ses attributions juridictionnelles, notamment lorsqu’elle méconnaît les limites de sa saisine, soit parce qu’elle n’est pas encore saisie, soit parce qu’elle ne l’est plus ;
Attendu qu’il résulte de l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA) que « la juridiction compétente statue dans les trois mois de sa saisine. Lorsque ladite juridiction n’a pas statué dans ce délai de trois (03) mois, elle est dessaisie et le recours peut être portée devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans les quinze (15) jours suivants » ;
Attendu qu’il résulte des articles 46 et 173 du code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirien qu’au jour fixé pour l’audience, si l’affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée ; que l’article 140 alinéa 4 du même code dispose qu’ « En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de six mois maximum, à compter de la première audience. » ; qu’il ressort également des articles 41 et 49 de la loi ivoirienne relative aux juridictions de commerce que si les parties comparaissent, la juridiction de commerce s’assure que les parties ont entrepris les diligences en vue de parvenir à un règlement amiable du litige ; que l’article 45, alinéa 3 de la même loi dispose qu’« En tout état de cause, le jugement est rendu dans un délai impératif de trois mois à compter de la première audience. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’aucune juridiction ivoirienne ne peut commencer à instruire une affaire avant la date fixée pour la première audience, elle-même fixée par le demandeur sur l’acte de saisine ou lors de l’enrôlement ; qu’il en ressort que la notion de date de saisine prévue par l’article 27 AUA doit être entendue, en République de Côte d’Ivoire, comme celle à laquelle la juridiction nationale peut légalement commencer l’instruction de son dossier, à savoir la date de la première audience ;
Attendu qu’en l’espèce, l’affaire objet du recours en annulation de la sentence arbitrale a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 décembre 2021, le délai de trois mois qui commence à courir à compter de ce jour expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte ou de l’événement qui le fait courir ; que ce jour qui porte le même quantième étant le 23, la cour d’appel qui a statué le 24 mars 2022, alors que le délai avait expiré la veille à savoir le 23 mars 2022, l’a fait hors délai ; qu’au moment où elle statuait, la cour d’appel était donc dessaisie au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; qu’en statuant alors qu’elle n’était plus saisie, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir et son arrêt est dès lors nul et non avenu ; qu’il échet dès lors de déclarer l’arrêt nul et non avenu et de dire n'y avoir à évocation ;
Sur les dépens
Attendu que la société MCI CARE COTE D’IVOIRE a succombé ; qu’il échet de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Déclare le pourvoi recevable ;
Déclare l’arrêt RG n° 937/2021 du 24 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan nul et non avenu ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Condamne la société MCI CARE COTE D’IVOIRE aux dépens.
Observations :
La révolution juridique et judiciaire opérée par le Traité N° Lexbase : A9997YS3 de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) a permis la création d’une juridiction supranationale : la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA)[1]. Cette Cour assure par le biais de ces juges l’interprétation et l’application uniforme du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.
Dans sa fonction juridictionnelle, elle revêt des compétences qui lui permettent de juger en cassation les recours contre les décisions prises en droit harmonisé par les juridictions nationales en premier ressort et en appel. C’est dans cet ordre d’idées que l’arrêt n° 171/2023 du 13 juillet 2023 opposant la Société Internationale d’Assurance Multirisques (SIDAM SA) contre Société MCI Care N° Lexbase : A35432EX a été rendu. Cette décision rendue par la haute juridiction met en lumière l’application des articles 28 et 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, lequel organise la recevabilité d’un recours en cassation devant le CCJA.
Les faits et la procédure examinés par les juges étaient les suivants : en date du 18 avril 2012, la SIDAM confiait à la société MCI Care Côte d’Ivoire la gestion d’un portefeuille d’assurance « maladie » de plusieurs clients et qu’en exécution de la convention, MCI Care était chargé du paiement des sinistres découlant de la gestion desdits portefeuilles moyennant une commission et le remboursement des débours engagés sur présentation des bordereaux et facture à la SIDAM. À cet effet, estimant que cette dernière restait lui devoir un montant reliquataire retenu après rapprochement des parties, la société MCI Care saisissait en premier lieu la Cour arbitrale de Côte d’Ivoire (CACI) pour demander le paiement du montant des honoraires postérieurs à la date du 23 février 2018 date à laquelle ils avaient clôturé leur compte.
Dans un premier temps, le tribunal condamnait réciproquement la SIDAM et la MCI Care et ordonnait la compensation entre les différentes dettes. Par ailleurs, sur recours de la MCI Care devant la Cour d’appel de commerce d’Abidjan. L’arrêt RG n° 937/2021 du 24 mars 2022 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan faisait l’objet d’un recours en cassation devant la CCJA. Par l’arrêt n° 171/2023 du 13 juillet 2023 N° Lexbase : A35432EX, la CCJA s’est prononcée en matière de recours contre cette sentence arbitrale. Cette dernière, après avoir statué sur la recevabilité du pourvoi, relevait d’office l’excès de pouvoir commis par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan qui s’était prononcée en dehors des délais impartis. Statuant publiquement et après avoir délibéré, la haute juridiction déclarait le pourvoi recevable, rendait nul et non avenu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et dit n’y avoir lieu à évocation.
In limine litis la MCI Care a dans un premier temps soulevé l’irrecevabilité du recours en cassation en invoquant les dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la CCJA. Dans un second temps, requiert l’annulation pour excès de pouvoir de la décision rendu par la CACI. Dès lors, la CCJA a rappelé d’une part que, « en l’absence de demande de régularisation dans un délai imparti, le pourvoi est recevable » et d’autre part que, « en statuant hors délai, la CA n’était plus compétente donc elle a commis un excès de pouvoir ».
De l’analyse de l’arrêt n° 171/2023 du 13 juillet 2023 N° Lexbase : A35432EX de la CCJA de l’OHADA, il est établi que le recours devant la Cour est subordonné au respect des conditions fixées à l’article 28 du Règlement de procédure. Celles-ci au-delà de leur généralité regorgent certaines spécificités. L’arrêt sous commentaire en est une illustration. La question qui se dégage est la suivante : qu’est-ce qui fait la spécificité du recours en cassation devant la CCJA ? En réponse à cette question, l’on pourrait affirmer que, celle-ci réside aussi bien dans la recevabilité que dans le respect des délais. C’est fort de ce propos que l’on analysera le caractère contingent de la recevabilité du recours d’une part (I) et l’impératif du respect strict des délais du jugement impartis aux juridictions nationales d’autre part (II).
I. Une recevabilité contingente du recours en cassation devant la CCJA
Le caractère contingent de la recevabilité du recours en cassation s’observe dans le fait qu’en l’absence d’une demande de régularisation, le recours reste recevable (A). En revanche, l’irrecevabilité peut être constatée à la suite à une demande de régularisation restée infructueuse (B).
A. La recevabilité en l’absence de demande de régularisation.
L’article 28 du règlement de procédure de la CCJA prévoit les informations et documents qui doivent être contenus dans le recours adressé à cette Cour. La même disposition prévoit en son point 6 les conditions de régularisation des recours qui ne seraient pas conformes aux exigences fixées par cet article. Il est prévu en ce point que si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées à l’article 28 du règlement de procédure], « le juge rapporteur fixe au requérant un délai aux fins de régularisation de recours ou de production des pièces mentionnées ». Ainsi, « à défaut de régularisation ou de productions des pièces dans le délai imparti, la Cour se prononce sur la recevabilité du recours ». La régularisation d’une requête reste possible lorsque les informations ou pièces[2]. C’est en application de cette disposition que la CCJA précise dans l’arrêt sous commentaire qu’en l’espèce, en dépit de l’absence de certaines informations requises, aucune demande de régularisation du recours n’a été adressée à la requérante. Elle en déduit ainsi que le recours serait donc recevable.
On entend par régularisation la mise en conformité d’un acte juridique ou d’un acte de procédure avec les prescriptions légales opérant validation de l’acte originairement entaché d’irrégularité[3]. Au sens de la jurisprudence de la CCJA, la demande de régularisation qui doit être faite par le greffier peut consister en une invitation au requérant à produire les pièces manquantes. Dans le cas d’espèce, il s’agissait du nom et de l’adresse de l’avocat ayant occupé pour la défenderesse au pourvoi devant la juridiction nationale, la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié à la partie adverse. C’est du moins ce qui ressort de l’arrêt objet du commentaire où le juge observe « qu’en l’absence des mentions suscitées, et d’une demande de régularisation formulée par le greffe, le pourvoi est recevable ».
En droit ohada, le pouvoir de régularisation est consacré à l’article 28.6 du règlement de procédure de la CCJA en ces termes ; « si le recours n’est pas conforme…, le juge rapporteur fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours »[4]. À cet effet, le législateur précise avec clarté l’auteur de la demande de régularisation adressée au requérant. Il s’agit là d’une innovation, car dans le texte révisé, cette prérogative était l’apanage du greffier en chef[5]. Cependant, le texte évoqué par le juge dans le cadre de ce litige fait état de la possibilité de recourir toujours au greffier en chef pour adresser une demande de régularisation au requérant.
En effet, l’arrêt commenté ne manque pas des répercussions sur la clarté et l’efficacité du droit OHADA. En effet, le règlement de procédure de la CCJA reconnaît au juge rapporteur le pouvoir d’adresser au requérant une demande de régularisation. Cependant, l’arrêt semble encore reconnaître cette prérogative au greffier en chef de la CCJA, malgré la modification du Règlement de procédure survenue depuis 30 janvier 2014. Il convient donc de préciser que selon le présent arrêt, la demande de régularisation des mentions ou de production de pièces semble pouvoir être adressée au requérant autant par le juge rapporteur que par le greffier en chef de la CCJA. Une précision de l’auteur de la demande de régularisation serait bienvenue. S’agit-il du greffier en chef tel qu’il ressort du présent arrêt ? S’agit-il du juge rapporteur tel qu’en dispose l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ? S’agit-il de l’un et de l’autre ? Quoi qu’il en soit, il demeure que la demande de régularisation restée infructueuse peut entraîner l’irrecevabilité du recours.
B. L’irrecevabilité suite à une demande de régularisation infructueuse
Aux termes de l’article 28 du règlement de procédures de la CCJA, si le recours n’est pas conforme aux conditions fixées dans ledit article, « le juge rapporteur fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation ou de production des pièces mentionnées (…) ». C’est bien dans ce sens que l’arrêt indique que, « l’absence des mentions prévues à l’article 28 précité dans la requête aux fins de pourvoi n’entraîne l’irrecevabilité du recours que suite à une demande de régularisation formulée par le greffe à l’attention du requérant et restée infructueuse ».
On entend par demande de régularisation restée infructueuse une demande qui n’a pas abouti au résultat voulu ou escompté. Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une demande adressée au requérant qui n’a pas abouti à la régularisation ou à la production des pièces manquantes à la requête. Ainsi, le recours exercé au mépris des prescriptions de l’art 28 serait irrecevable dès lors que, dans les délais impartis, une demande de régularisation adressée au requérant n’a pas abouti au résultat escompté. Cette position a été confortée par le juge dans plusieurs décisions dans lesquels le recours a été déclaré irrecevable si le requérant ne l’a pas régularisé malgré le rappel à lui fait par le greffier en chef[6]. Dans le même ordre d’idées, sera également déclaré irrecevable le recours qui n’a pas été régularisé dans le délai, par la transmission au greffe des éléments manquants à la requête[7]. Cette position des juges de la CCJA a encore été confortée dans l’arrêt n° 161/2015 du 17 décembre 2015 N° Lexbase : A1601WYX qui déclare irrecevable le recours en cassation devant la CCJA lorsque « l’avocat ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’avocat dans le délai à lui imparti par le greffier en chef de la CCJA »[8].
Il convient de rappeler que dans les faits du présent arrêt, le requérant SIDAM SA était tenu de fournir des informations sur l’identité de l’avocat l’ayant représenté d’une part et, préciser la date de la signification de l’arrêt objet du litige d’autre part. Toutefois, l’absence de ces mentions dans la requête aux fins de pourvoi n’aurait pu entraîner l’irrecevabilité du recours que suite à une demande de régularisation formulée à l’attention de la SIDAM SA restée infructueuse. Or dans le cas d’espèce, aucune demande de régularisation du recours n’a été adressée à cette dernière. La Cour en déduit la recevabilité du pourvoi.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de précision de certaines informations ne saurait être automatiquement reçue. Sa réception est subordonnée, d’une part, à la demande d’une régularisation formulée à l’attention de la requérante et, d’autre part, à l’absence de régularisation des mentions prescrites dans un délai fixé par le greffier en chef ou le par le juge rapporteur de la CCJA[9]. Par ces précisions, la Cour réitère solution qu’elle a retenue dans plusieurs de ses arrêts[10].
Cependant, la CCJA, en reprenant le contenu de l’art 28 - 6° du Règlement précité statue sur la recevabilité du pourvoi nonobstant le défaut de certaines mentions prescrites si « le juge rapporteur n’a pas adressé de demande de régularisation au requérant dans le délai imparti ». Ainsi, le recours exercé au mépris des prescriptions de l’art 28 du Règlement ne semble pouvoir être déclaré irrecevable dans l’hypothèse où le greffier ou le juge rapporteur n’a pas invité le requérant à régulariser. Or, dans le cas d’espèce, aucune demande de régularisation du recours n’a été adressée à la requérante, ce qui entraîne la recevabilité du pourvoi et le rejet de la fin de non-recevoir jugée non fondée. Cette mise en œuvre de la recevabilité du recours en l’absence de toute demande de régularisation rejoint certains arrêts dans lesquels la CCJA avait déjà le contenu de l’article 28.6 du Règlement[11].
Par ailleurs, on peut également s’interroger sur le « délai imparti » pour que la Cour décide de la recevabilité ou non du pourvoi. Ce délai imparti, tel que prévu par le législateur, n’a pas de contenu fixe. Son contenu est laissé à la libre appréciation du greffier en chef ou du juge rapporteur qui demande la régularisation au requérant dans le délai qu’il estime raisonnable[12]. À cet effet, le législateur adopte une approche pragmatique sur cette question ; il n’a pas voulu que le domaine d’intervention de la Cour se retrouve renfermé dans les limites du règlement de procédure. Cela revient à dire que, dès lors qu’une demande de régularisation n’a pas été adressée au requérant, le pourvoi ne peut être rejeté sur la base d’un motif tiré d’une violation de l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA. Cette solution semble conforme aux termes de l’article 28.6° dudit règlement de procédures. En effet, il ressort de cette disposition que même si la régularisation demandée au requérant dans un délai défini reste infructueuse, il appartiendra à la Cour de décider des suites utiles en se prononçant sur la recevabilité du recours.
Au-delà des conditions de recevabilité du recours en cassation, la CCJA impose, par le présent arrêt, un respect strict des délais de jugement impartis aux juridictions nationales.
II. Le respect strict des délais de jugement imposé aux juridictions nationales
Gage de célérité des procédures dans l’espace OHADA, l’observation par la CCJA du respect des délais de jugement imposés aux juridictions nationales repose sur deux éléments principaux : la fixation de la date de saisine (A) et la computation des délais impartis aux juridictions nationales (B).
A. La fixation de la date de saisine
La saisine renvoie au fait de recourir à une juridiction ou à une entité de conciliation ou de médiation afin de lui soumettre un litige en vue de sa résolution. La date de saisine quant à elle peut être différemment fixée selon la législation étatique considérée. Elle peut correspondre au jour à laquelle une assignation a été placée ou la date de mise au rôle pour la saisine d’une juridiction[13]. Selon le droit ivoirien, cette date correspond « au jour fixé pour l’audience si l’affaire est enrôlée » d’une part, ou « à compter de la première audience » d’autre part. Or selon le droit OHADA, l’art 27 AUA dispose : « la juridiction compétente statue dans les trois mois de sa saisine… ». Dans la présente affaire, la CCJA déduit de la combinaison de ces dispositions qu’aucune juridiction ivoirienne ne peut commencer à instruire une affaire avant la date fixée pour la première audience. Il en ressort que la notion de date de saisine prévue par l’article 27 AUA doit être entendue, en République de Côte d’Ivoire, comme celle à laquelle la juridiction nationale peut légalement commencer l’instruction de son dossier, à savoir la date de la première audience.
En l’espèce, l’affaire objet du recours a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 décembre 2021. Cette date étant celle à laquelle la juridiction a légalement commencé l’instruction de l’affaire constitue la date de saisine de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan. Ainsi, en droit ivoirien, la saisine s’opère le jour de la première audience. À cet effet, déterminer la date de saisie d’une juridiction comporte plusieurs avantages. Elle permet de faciliter la computation des délais, et de délimiter la sphère de compétence des juridictions nationales afin d’éviter tout excès de pouvoir tel que présenté dans l’arrêt commenté ; toute chose qui enclenche la computation des délais.
B. La computation des délais
La computation des délais c’est-à-dire la manière dont les délais de procédure sont calculés, constitue une étape cruciale en matière de procédure. Il s’agissait en l’espèce de déterminer le point de départ et d’expiration du délai dans lequel le juge saisi pouvait statuer. Ainsi, une computation erronée peut entraîner la perte d’un droit ou d’une action. Dans le cadre du droit OHADA, les règles applicables à la computation des délais de saisine d’une juridiction nationale pour se prononcer sur un recours contre une sentence arbitrale sont prévues à l’art 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage en ces termes : « la juridiction compétente statue dans les trois mois de sa saisine ». Le législateur ivoirien est également allé dans le même sens à l’art 45 al 3 qui dispose : « en tout état de cause, le jugement est rendu dans un délai impératif de trois mois à compter de la première audience ». En instituant ces délais dans l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le législateur a cherché à assurer la célérité des procédures dans cette matière.
La CCJA précise par ailleurs que le calcul du délai dans lequel une juridiction nationale saisie d’un recours contre une sentence arbitrale doit statuer s’opère de quantième à quantième. Dès lors, à compter de sa saisine, la juridiction nationale, dispose d’un délai de trois mois à compter de la première audience. En l’espèce, l’affaire ayant été appelée pour la première fois à l’audience du 23 décembre 2021, le délai de trois mois qui commence à courir à compter de ce jour expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte ou de l’évènement qui le fait courir ; que ce jour qui porte le même quantième étant le 23, ce délai a expiré le 23 mars 2022. Dès lors, la CA ayant statué le 24 mars, alors que le délai avait expiré l’a fait hors délai. En se prononçant le lendemain de la date limite du délai imparti, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan était dessaisie au profit de la CCJA et qu’en statuant hors délai, la Cour d’appel de commerce d’Abidjan commet inlassablement un excès de pouvoir, car, elle a agi alors qu’elle n’était plus saisie ; d’où l’annulation de son arrêt.
Il est clair que, la tardiveté de la décision expose inéluctablement l’arrêt d’appel à la cassation. En prévoyant un délai dans lequel la juridiction nationale doit statuer sur une demande d’annulation, le législateur émet sa volonté d’accélérer l’examen du recours d’une part et met en orbite le principe de célérité propre à l’arbitrage. Par ailleurs, le dessaisissement du juge étatique compétent lorsqu’il n’a pas statué dans le délai de 3 mois imparti est un dessaisissement de plein droit.
Le législateur en prévoyant le dessaisissement du juge national au profit de la CCJA essaie de pallier la défaillance de la juridiction nationale. Dès lors, la CCJA n’agit plus dans le cadre de ses attributions classiques, mais comme juridiction statuant à l’origine sur une question. À cet effet, elle statue sur un recours qui lui est adressé par le demandeur. Cette décision de la CCJA marque la continuation et la constance de la jurisprudence, car, dans un arrêt similaire, la CCJA avait décidé de la cassation d’un arrêt rendu par une juridiction nationale hors délais. C’est donc à bon droit que, la CCJA saisie du recours pour excès de pouvoir et après appréciation des faits déclare « nul et non avenu » l’arrêt attaqué.
[1] J.C Birika Bonzi, Commentaire du Règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996, JO OHADA n°4 ; 1er novembre 1996, p 9 et s.
[2] Cf. art 28.6 du règlement de procédure de la CCJA
[3] V. : « régularisation » in Centre national de ressources textuelles et lexicales, 2012.
[4] Cf. art 28.6 du Règlement de procédure de la CCJA modifié le 30 janvier 2014.
[5] Cf. art 28.5 du règlement de procédure de la CCJA du 18 avril 1996.
[6] V. CCJA, 1ère ch., 1er décembre 2022, Arrêt n°186/2022 N° Lexbase : A31219H3
[7] V. CCJA, 1ère ch., 1 décembre 2022, Arrêt n°185/2022 N° Lexbase : A31229H4
[8] V. CCJA, 1ère ch., 17 décembre 2015, Arrêt n°161/2015 N° Lexbase : A1601WYX
[9] Cf. Juris Ohada n°1/2002, p.13,14,16 et 18.
[10] CCJA, 2e ch., 21 avril 2016, Arrêt n°062/2016 ; CCJA, 1ère ch., 27 avril 2017, Arr. n°086/2017 N° Lexbase : A1760WLR.
[11] CCJA 1ère ch., 27 avril 2017, Arrêt n°082/2017 N° Lexbase : A1756WLM ; CCJA 2e ch., 25 octobre 2018, Arrêt n°198/2018 N° Lexbase : A2014Z84
[12] Voir en ce sens J-F. Kriegk, « Le délai raisonnable : office du juge et office de l’autorité publique », Petites affiches n°127, 2003, p.4.
[13] Voir : C. Bléry, « Assignation ou mise au rôle pour la saisine d’une juridiction ? », Dalloz-Actualité, n° 16/04151, 7 nov. 2017.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[Le point sur...] Les mutations conceptuelles de l’autorité de la chose jugée : regards croisés sur les droits camerounais et français
par Ibrahim NDAM, Docteur en droit privé, Maître-Assistant CAMES/ Chargé de Cours, FSJP - Université de Yaoundé II (Cameroun)
« Le droit ne cesse d’évoluer dans un monde qui change », affirme avec justesse Jean-Louis Bergel[1]. Le droit du procès, en perpétuelles « métamorphoses »[2], n’échappe pas à ces mutations qui trouvent aujourd’hui une explication dans un contexte mondial en renouvellement constant exigeant, par conséquent, d’inventer de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes et d’imaginer des solutions nouvelles, notamment pour assurer le procès équitable, la sécurité juridique et/ou judiciaire. Ici, les évolutions touchent de manière générale la procédure civile et, spécifiquement, l’autorité de la chose jugée sur laquelle les regards croisés entre le droit camerounais et le droit français révèlent qu’elle est aujourd’hui différemment frappée par d’importantes mutations conceptuelles. Pareilles mutations résultent notamment des efforts jurisprudentiels et doctrinaux pour tenter de cerner l’autorité de la chose jugée, notion « éminemment plurielle »[3] et, par conséquent, « délicate à appréhender »[4] qui, bien que très ancienne parce que déjà connue des droits babylonien ou romain[5], n’en « demeure pas moins assez mystérieuse »[6]. En fait, l’une des principales difficultés en la matière est terminologique : cette nécessité sociale « de tous les temps et de tous les lieux »[7] engendre effectivement une pluralité de conceptions ; « les auteurs plaçant souvent des concepts différents sous des mots identiques »[8]. Face à cette situation, la définition étymologique de l’autorité de la chose jugée quoique importante ne suffit plus à l’identifier précisément ; il faut encore la confronter aux notions voisines qui gravitent autour d’elle créant ainsi la confusion.
Étymologiquement, l’autorité de la chose jugée désigne l’autorité attachée à un acte juridictionnel, qui en interdit la remise en cause en dehors des voies de recours légalement ouvertes[9]. Elle a une double dimension positive et négative[10]. La première, plus débattue en doctrine comme en droit positif, consiste à reconnaître force probatoire aux motifs d’une décision de justice précédemment rendue, dès lors qu’ils constituent le soutien nécessaire du dispositif de cette décision. La seconde, présente dans la quasi-totalité des ordonnancements juridiques sous des formes variées[11], c’est-à-dire la dimension négative[12], interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé, sous la condition de la triple identité de parties, d’objet et de cause et sous réserve des voies de recours encore ouvertes pour ce faire.
Ainsi définie, l’autorité de la chose jugée est consubstantielle à la décision juridictionnelle. Par conséquent, si elle est attachée aux décisions juridictionnelles comme les sentences arbitrales et les jugements, elle ne couvre pas les décisions non juridictionnelles notamment les décisions administratives qui n’ont simplement que « l’autorité de la chose décidée »[13].
Pour mieux cerner l’autorité de la chose jugée, il importe de la confronter aux notions voisines avec lesquelles des confusions sont souvent entretenues, à savoir la chose jugée elle-même, la force de chose jugée, la force exécutoire, l’irrévocabilité de la chose jugée ou encore l’efficacité du jugement.
Premièrement, pour nombre de juristes, évoquer la chose jugée, c’est faire référence à l’autorité de la chose jugée. Ils diront : « il y a chose jugée », lorsqu’il n’est plus possible de revenir sur la décision. Une telle assimilation est regrettable, car la chose jugée correspond au contenu décisionnel du jugement et renvoie précisément à ce « qui a été tranché par le juge pour mettre fin à une contestation »[14] et non à l’autorité attachée à la décision juridictionnelle. C’est dans ce sens que l’expression est employée dans le Code de procédure civile français dans l’article 561 qui dispose que « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Deuxièmement, il est nécessaire de procéder à une distinction claire et nette de l’autorité de la chose jugée de la force exécutoire, de la force de chose jugée et, par conséquent, de l’irrévocabilité de la chose jugée.
Les fonctions de l’autorité de la chose jugée et de la force exécutoire sont distinctes. La première notion vise à assurer l’immutabilité de la décision en ce sens que ce qui est jugé ne peut l’être à nouveau tandis que la seconde vise à permettre une exécution de la décision avec le concours éventuel, à défaut d’exécution spontanée, de la force publique. Par conséquent, si la force exécutoire participe à l’effectivité des décisions en permettant leur transcription dans les faits, l’autorité de la chose jugée assure la stabilité juridique des droits reconnus en justice.
À l’opposé de l’autorité de la chose jugée qui est attachée aux décisions définitives, mais susceptibles de faire l’objet de voie de recours[15], la force de chose jugée est la caractéristique d’un jugement définitif qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (opposition, appel, pourvoi dans les rares cas où il est suspensif) ou qui n’en est plus susceptible (les délais étant expirés ou les recours ayant été exercés)[16].
Alors que l’autorité de la chose jugée s’oppose au recommencement du procès qui a déjà eu lieu, l’irrévocabilité de la chose jugée s’oppose à sa perpétuation par le biais des voies de recours. L’irrévocabilité participe de l’idée d’une impossibilité de continuer le procès, la décision étant devenue définitive, tandis que l’autorité de la chose jugée relève de l’idée d’une impossibilité de recommencer le même procès.
Troisièmement, l’autorité de la chose jugée se distingue de l’efficacité substantielle du jugement qui renvoie à la modification de la situation substantielle des parties par le jugement[17]. L’efficacité substantielle s’attache au commandement du juge ; ce dernier constituant une norme concrète qui prend le relais de la norme légale abstraite pour modifier l’ordonnancement juridique[18].
Grâce à ces distinctions successives, l’autorité de la chose jugée devient précisément identifiable. Elle s’analyse au final en un moyen de défense procédural, une fin de non-recevoir car, pour paraphraser l’article 122 du Code de procédure civile français, elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir[19].
Quatrièmement, même si cela ne fait pas souvent l’objet de controverses, l’autorité de la chose jugée peut davantage être distinguée de la règle du dessaisissement. Le principe du dessaisissement empêche le juge de revenir sur le jugement une fois que celui-ci est prononcé[20]. Il s’agit alors de protéger la chose jugée des velléités d’un juge pris de remords. Le dessaisissement empêche le juge de revenir sur la chose jugée, alors que pour les parties, c’est l’autorité de la chose jugée qui s’y oppose.
Éclairé par ces distinctions, l’on peut aisément réaliser, à la faveur d’une lecture croisée des droits camerounais et français, qu’ils se rapprochent sans se confondre.
Dans ces deux pays existe, à côté de la dimension positive, la dimension négative de l’autorité de la chose jugée[21] qui puise aux sources du droit romain, à travers le principe « non bis in idem »[22] et se traduit techniquement par un moyen de défense adaptée traditionnellement appelé « exception de chose jugée », entendue plus exactement au sens de « moyen de défense pris de la chose jugée »[23]. Si ce principe dessine le plus petit dénominateur commun entre ces deux pays, le rapprochement entre les deux droits devient sensible lorsqu’on examine les rapports entre l’autorité de la chose jugée et l’écoulement du temps. Ainsi, à l’opposé des droits allemand et italien qui considèrent qu’une décision n’a pleine autorité formelle de la chose jugée que lorsqu’elle n’est plus susceptible de voies de recours, y compris de cassation (ou révision en droit allemand)[24], les droits français et camerounais, comme les droits de Common Law, confèrent l’autorité de la chose jugée à la décision dès son prononcé. Le caractère final ou définitif est acquis dès lors que la décision achève la procédure dans des conditions telles qu’il ne reste rien à trancher par la juridiction qui l’a rendue. Bien plus, ces deux pays privilégient l’approche restrictive de l’autorité de la chose jugée qui contraste avec une perspective extensive de la même notion dans les pays de Common Law, spécifiquement en droit anglais où il est possible de mettre en œuvre la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée alors même que l’affaire n’a pas été effectivement jugée sous tous ses aspects, en fait et en droit[25].
En revanche, l’harmonie autour de la notion vacille et le fossé semble infranchissable entre le Cameroun et la France lorsque l’on prend en considération l’impact de l’arrêt Cesaréo[26], consacrant en droit français le principe de concentration des moyens ainsi que d’autres arrêts qui l’ont suivi[27], sur l’autorité de la chose jugée. En effet, si le principe de concentration des moyens entraîne, en droit français, l’extension de la cause aux moyens de droit non examinés par le premier juge, une telle mutation n’atteint pas le droit camerounais qui n’a pas réceptionné cette règle[28]. Le fossé semble davantage se creuser entre le Cameroun et la France lorsqu’on vient à s’interroger sur les conceptions ayant cours dans ces deux pays. Au Cameroun et en France, l’autorité de la chose jugée est frappée par des mutations conceptuelles importantes. Seulement, la teneur de ces mutations contemporaines ou modernes correspondant aux évolutions actuelles d’origine jurisprudentielle, légale ou doctrinale, varie d’un État à un autre. Par conséquent, il existe entre ces pays une différence fondamentale de conception qui dépend en partie des évolutions subies par les textes et de l’audace jurisprudentielle. Dès lors, à partir d’une analyse croisée du régime juridique de l’autorité de la chose jugée en droit camerounais et en droit français, quelle est l’étendue des mutations conceptuelles subies aujourd’hui par cette institution ?
La question ne manque pas d’intérêt. D’une part, l’autorité de la chose jugée fait partie de ces thèmes majeurs qui, de tout temps, suscitent toujours l’intérêt de la doctrine, notamment parce qu’elle cumule autant d’aspects théoriques tout en présentant un intérêt pratique aussi capital que celui d’assurer la sécurité juridique. Si elle préoccupe la doctrine de longue date[29], elle demeure d’actualité[30] et a même fait l’objet d’un regain d’intérêt en droit français avec le principe de concentration des moyens ou la modification de l’article 125 du Code de procédure civile français N° Lexbase : L1421H4E par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 entré en vigueur le 1er janvier 2005 N° Lexbase : L0896GTD[31]. Au Cameroun, l’analyse de la jurisprudence révèle même une mutation conceptuelle de cette notion récemment confirmée par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) qui se substitue, en matière commerciale, aux juridictions nationales de cassation des États partie à l’OHADA, dont la Cour suprême camerounaise[32]. D’autre part, même si cette interrogation incline à s’inscrire dans le prolongement de plusieurs études non seulement de droit comparé sur l’autorité de la chose jugée en général[33], mais aussi effectuées par des auteurs camerounais et français en particulier, elle demeure intéressante pour deux principales raisons[34]. D’un côté, elle permet de tirer des leçons de la lecture croisée du droit français et du droit camerounais et, par conséquent, de s’appuyer sur les évolutions conceptuelles de l’autorité de la chose jugée observées ici ou là pour proposer le dynamisme aussi bien du droit camerounais que du droit français. De l’autre, elle permet de mettre en exergue les évolutions conceptuelles observées en droit camerounais.
Aujourd’hui, du fait de la diversité, de la richesse des analyses doctrinales consacrées à l’autorité de la chose jugée et de l’audace jurisprudentielle en la matière, les divergences de conceptions deviennent importantes[35] et rendent compte d’une évolution conceptuelle de la notion. La doctrine contemporaine voit en elle non une présomption de vérité, mais une force de vérité légale voire un attribut du jugement ou plus exactement une fin de non-recevoir qui a pour principale fonction d’éviter de nouveaux procès identiques.
Si l’on s’en tient au droit camerounais et au droit français mobilisés dans cette étude, les conceptions sont loin d’être toujours les mêmes, alors pourtant que les finalités sont identiques, à savoir éviter le recommencement infini des procès. À s’en tenir au droit civil ou, plus précisément, aux branches du droit appliquant le Code civil et le Code de procédure civile au Cameroun et en France (ce qui inclut alors le droit civil stricto sensu, le droit commercial, le droit social, le droit rural…), d’importantes évolutions conceptuelles ont eu lieu.
De l’analyse croisée du droit camerounais et du droit français, il ressort que l’autorité de la chose jugée a, de nos jours, subi une double mutation conceptuelle. La première est observable en droit français où la conception classique qui en fait une présomption de vérité légale a, aujourd’hui, cédé la place à une conception moderne qui en constitue une force de vérité légale. La seconde, observable en droit camerounais, résulte de l’exploitation de la jurisprudence qui semble faire passer l’autorité de la chose jugée d’une fin de non-recevoir d’intérêt privé à une fin de non-recevoir d’ordre public.
Pour rendre compte de cette situation, trois principales méthodes de recherche sont mobilisées. La première, la méthode exégétique, impose de jeter un regard croisé sur l’ensemble des règles de droit camerounais et de droit français régissant l’autorité de la chose jugée. La seconde, la méthode comparative, est utilisée pour comparer ces deux droits en la matière. Et la troisième, la casuistique, implique une analyse de la jurisprudence non seulement française, mais aussi camerounaise incluant celle de la CCJA, car cette juridiction se substitue aux juridictions nationales de cassation en matière commerciale, dont la Cour suprême du Cameroun.
La combinaison de ces méthodes de recherche permet de faire aisément une double démonstration résultant d’une étude croisée des droits français et camerounais : l’autorité de la chose jugée est doublement passée d’une présomption de vérité légale à une force de vérité légale (I), d’une part, et d’autre part, d’une fin de non-recevoir d’ordre privé à une fin de non-recevoir d’ordre public (II).
I. De la présomption de vérité légale à la force de vérité légale
Traditionnellement, l’autorité de la chose jugée est au Cameroun comme en France juridiquement une présomption de vérité légale. Cette conception classique résulte de l’analyse de certaines dispositions du Code civil de 1804 encore en vigueur au Cameroun, mais aujourd’hui abrogées en France à la faveur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats N° Lexbase : L4857KYK, du régime général et de la preuve des obligations ratifiée par la loi no 2018 du 20 avril 2018 N° Lexbase : L0250LKH. Selon une doctrine avisée, cette ordonnance a fait de l’autorité de la chose jugée une force de vérité légale en droit français[36].
Des regards croisés sur le droit camerounais et français révèlent donc que si cette institution est traditionnellement admise dans ces deux pays comme une présomption de vérité légale (A), une telle conception a, de nos jours, évoluée en France où elle est devenue une force de vérité légale (B).
A. La conception traditionnelle de l’autorité de la chose jugée comme une présomption de vérité légale en droits français et camerounais
La présomption est, étymologiquement, un mode de raisonnement juridique en vertu duquel de l’établissement d’un fait le législateur ou le juge induit un autre fait qui n’est pas prouvé. Le terme désigne à la fois la démarche inductive de celui (législateur ou juge) qui pose ou admet la présomption et la preuve qui en résulte (la preuve induite). La présomption peut être légale ou judiciaire.
La présomption légale est celle établie par la loi. Dans ce cas, le législateur tire lui-même d’un fait établi un autre fait dont la preuve n’est pas rapportée. Il en est ainsi de la présomption d’innocence : principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par un jugement irrévocable de la juridiction compétente. La présomption légale peut être simple ou absolue. La présomption légale absolue ou irréfragable dite juris et de jure est celle qui ne peut être combattue par aucune preuve contraire. Elle ne peut donc être renversée. En revanche, la présomption légale simple dite juris tantum est celle qui peut être combattue par la preuve du contraire.
À l’opposé des présomptions légales, celles judiciaires ne sont pas établies par la loi ; elles sont laissées à l’appréciation du juge dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, et ne sont admises que si elles sont « graves, précises et concordantes »[37]. Elles sont dites de fait ou de l’Homme lorsque le magistrat tient lui-même et en toute liberté ce raisonnement par induction, pour un cas particulier. On qualifie de présomption mixte celle dont la preuve contraire est réglementée par le législateur, qui restreint ses moyens ou son objet[38].
Éclairé par ces définitions, l’on peut aisément réaliser que l’autorité de la chose jugée est classiquement, aussi bien en droit camerounais qu’en droit français, une présomption de vérité légale. Le lien entre l’autorité de la chose jugée et la présomption est établi, dans ces deux pays, depuis longtemps. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la théorie des présomptions est renouvelée en France par Domat puis par Pothier affirmant l’idée d’une présomption posée par la loi et attachée à l’autorité de la chose jugée. Cette réflexion passa dans le Code civil en 1804 et fut justifiée tout au long du XIXe siècle par ses commentateurs[39]. À propos des présomptions, Domat écrivait qu’elles « sont des conséquences qu’on tire d’un fait connu, pour servir à faire connaître la vérité d’un fait incertain, dont on cherche la preuve »[40]. En intégrant un élément de subjectivité lorsqu’il parle du « jugement que la Loi, ou l’homme portent sur la vérité d’une chose, par une conséquence tirée d’une autre chose »[41], la définition de la présomption faite par Pothier diffère légèrement de celle de Domat, mais emporta, dans son sillage, la conviction des rédacteurs du Code civil de 1804 qui ne revinrent pas sur la qualification de présomption irréfragable de vérité attachée à la chose jugée.
À travers la colonisation, le Cameroun hérita du Code civil de 1804 et, par conséquent, de la conception traditionnelle de l’autorité de la chose jugée comme une présomption de vérité légale qui y fut introduite[42]. Ce Code fait de l’autorité de la chose jugée un moyen de preuve et la classe au rang des présomptions légales. En effet, logé dans le chapitre VI consacré aux preuves des obligations et du payement, plus précisément à la section III réservée aux preuves par présomption, l’article 1350 alinéa 3 du Code civil Napoléon range parmi les présomptions légales l’« autorité que la loi attribue à la chose jugée » et attache ainsi une présomption légale de vérité à la décision du juge. L’autorité de la chose jugée est alors ici une présomption, voire « une vérité par déclaration de la loi ». En effet, la présomption est un mécanisme de logique juridique permettant au juge dans son argumentation de décider de « la non-pertinence du doute »[43]. Elle agit comme un « mécanisme de déplacement de l’objet de preuve »[44]. Elle diffère de la fiction qui consiste en une « interprétation contraire à la réalité »[45] pour produire un effet de droit.
L’article 1352 du Code civil de 1804 rappelle d’ailleurs que cette présomption « dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ». Il en ressort « le caractère incontestable attribué par la loi au contenu du jugement »[46]. La présomption légale de vérité ainsi attachée à l’autorité de la chose jugée est donc irréfragable, car elle ne peut être renversée. Elle appartient « à cette catégorie de présomptions qui constituent moins une règle de preuve qu’une règle de fond décidée par le législateur »[47] et entraîne plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle emporte non seulement une dispense de preuve pour celui qui en bénéficie, mais aussi une interdiction absolue de preuve contraire pour l’adversaire. Ensuite, le jugement revêtu d’une telle présomption a la force probante d’un acte authentique : ses énonciations, tout au moins les constatations personnelles du juge, font foi jusqu’à inscription de faux. Enfin, la présomption de vérité se double d’une présomption de régularité dont bénéficie le jugement.
Même si cette conception classique est reprise par une partie de la doctrine moderne[48], le rattachement qu’elle établit entre l’autorité de la chose jugée et la théorie de la présomption est critiquable[49]. Ce rattachement est, en effet, artificiel.
Tout d’abord, ce lien est juridiquement illogique. Dans la logique juridique, les présomptions relèvent de la rhétorique touchant à la preuve. S’il est admis qu’elles sont, à tout le moins, des preuves indirectes, il en est autrement du caractère des présomptions légales facilitant l’émergence de la vérité en ce qu’elles dispensent de produire une preuve, ce qui doit faciliter la tâche du juge. Si certaines présomptions légales admettent leur renversement par la production d’une preuve contraire, il n’en est rien pour l’autorité de la chose jugée[50]. Dans son Traité élémentaire de procédure civile, René Morel affirme par exemple que le fondement de l’autorité de la chose jugée n’est à rechercher « ni dans une présomption légale de vérité », comme l’affirme le Code civil de 1804, « ni dans un prétendu contrat ou quasi-contrat judiciaire », comme l’affirmait Demolombe[51].
Ensuite, d’un point de vue historique, il est frappant d’apprendre que la maxime res judicata pro veritate accipitur fondement traditionnel de l’autorité de la chose jugée comme une présomption de vérité légale, serait le fruit d’une erreur d’interprétation d’une phrase attribuée à Ulpien[52]. Un auteur relève que ce sont les compilateurs du Digeste qui ont retenu en la généralisant à l’autorité de la chose jugée l’idée émise dans un contexte bien particulier ayant trait à la comparaison des Hommes libres aux esclaves affranchis selon laquelle il pouvait être considéré que la chose jugée remplace la vérité[53]. Ce sont ensuite les premiers glossateurs qui se sont emparés de la maxime pour rattacher la chose jugée à une institution de nature probatoire. Alors que ce rattachement était contesté, la force des travaux de Domat, relayés par ceux de Pothier, permit de faire le lien avec les textes du Code civil[54]. Pour un autre auteur, le rattachement de l’autorité de la chose jugée à la présomption de vérité légale procède d’une absence de distinction claire entre l’autorité positive et l’autorité négative de la chose jugée. Pour cet auteur, le recours à la vérité ne fonde logiquement que l’autorité positive de la chose jugée dont le rôle est quasi probatoire ; pour l’autorité négative, l’idée de consommation du droit d’agir en justice se suffit à elle-même[55].
Enfin, à partir du milieu du XXe siècle, la doctrine a nettement abandonné la théorie de la présomption légale attachée à l’autorité de la chose jugée pour faire de celle-ci un attribut, une qualité du jugement[56]. La doctrine civile, dans sa majorité, n’admet plus du tout la conception fondée sur la présomption légale et définit maintenant « l’autorité de la chose jugée comme un attribut procédural du jugement dont la finalité est de renforcer l’incontestabilité de la décision du juge (…), puisque la formation d’une autre demande entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, avec le même objet et la même cause, se heurte à une irrecevabilité »[57].
En outre, pour faire définitivement litière du rattachement de l’autorité de la chose jugée à la présomption, on peut relever un argument pratique. Si cette institution était une règle de preuve, elle ne pourrait être invoquée qu’en tant que moyen de fond et non comme moyen de s’opposer à la recevabilité de la demande[58].
Au regard de ces critiques, l’on comprend pourquoi le législateur français dans le nouveau Code civil semble avoir consacré une conception moderne de l’autorité de la chose jugée, celle qui fait de cette institution une force de vérité légale.
B. La conception moderne de l’autorité de la chose jugée comme une force de vérité légale en droit français
Dans l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK ratifiée par la loi no 2018 du 20 avril 2018 N° Lexbase : L0250LKH, le législateur français a abandonné la classification de l’autorité de la chose jugée au rang des présomptions légales. Dans ce texte portant Code civil français, l’ancien article 1350 est abrogé par le nouvel article 1354 N° Lexbase : L1012KZI qui abandonne la liste des exemples de présomptions légales, dont l’autorité de la chose jugée. Le législateur français donne ainsi raison aux auteurs qui pensent que « juridiquement parlant, le mot et le concept de présomption conviennent mal à l’autorité de la chose jugée »[59]. Le nouveau Code civil français consacre ainsi une évolution vers la reconnaissance du caractère artificiel des liens entre vérité et autorité de la chose jugée.
Toutefois, l’ancien article 1351 du Code civil de 1804 est maintenu à l’identique, mais devient l’article 1355 N° Lexbase : L1011KZH. Seulement, ce dernier article a conservé le même emplacement dans la structure générale du Code civil, car il est logé dans le titre IV bis consacré à la « preuve des obligations » et plus précisément au Chapitre 1er qui traite des « dispositions générales » sur cette preuve. Un tel emplacement permet de réaliser que l’autorité de la chose jugée constitue encore, en droit français, un moyen de preuve. Or, la preuve est consubstantielle à la vérité car elle renvoie à « ce qui sert à établir qu’une chose est vraie »[60], à « ce qui montre la vérité d’une proposition, la réalité d’un fait » selon le Littré ou encore à ce « qui démontre, établit, prouve la vérité ou la réalité d’une situation de fait ou de droit » selon le Petit Larousse illustré[61]. Par conséquent, le cordon entre vérité et autorité de la chose jugée n’est pas encore véritablement coupé en droit français. L’on comprend pourquoi certains auteurs relèvent pertinemment que le nouveau Code civil français fait seulement passer l’autorité de la chose jugée d’une « présomption de vérité légale à une force de vérité légale »[62].
On peut voir dans cette demi-réforme la difficulté à rompre avec un mythe bien ancré depuis le droit romain qui a pour vertu de donner une assise morale à l’autorité de la chose jugée : le juge dit le droit et la croyance plus ou moins fictive dans la vérité du jugement est supposée mieux garantir le respect de cette décision par tous, écartant ainsi toute tentation de vengeance privée ou de résistance aux décisions de justice[63]. Ce passage fait donc de l’autorité de la chose jugée une qualité des décisions de justice qui permet d’assurer une certaine immutabilité à leur contenu, en leur « reconnaissant une force de vérité à l’égal de la loi »[64], c’est-à-dire « une force de vérité légale ». Cela se comprend aisément : au lieu de parler de présomption, on dit parfois que la décision qui a autorité de la chose jugée a plutôt « force de vérité légale » ; admettant ainsi que le législateur peut imposer une fausse vérité. L’expression « force de vérité légale » met doublement en exergue les liens entre la loi et la force publique.
D’une part, elle rapproche l’autorité du jugement à la force qui s’attache à la loi. Pareille conception dominante dans les décennies qui ont précédé la Révolution française, célèbre la loi intrinsèquement libératrice, par opposition à l’équité des Parlements ; l’office du juge se ramenant à une comparaison quasi mécanique entre les faits et la loi par le biais du syllogisme judiciaire. Dès lors que l’office du juge est accompli et le jugement de ce dernier rendu, il est donc important, si l’on veut bien reconnaître à la décision de justice une certaine autorité, revenir à la loi, tout au moins par analogie : d’où l’expression « force de vérité légale ».
D’autre part, l’expression plus moderne « force de vérité légale », peut aussi signifier que le pouvoir exécutif exécute les décisions juridictionnelles et place donc ainsi sa force au service de la justice.
Même si le choix de traiter de la chose jugée au sein des présomptions dans le Code civil de 1804 est critiquable d’un point de vue technique et incline à suggérer au législateur camerounais d’abandonner cette classification, force est de réaliser que le rattachement de l’autorité de la chose jugée à une présomption ou une force de vérité légale est également critiquable.
Certes, le « juriste a coutume de dire que lorsque la chose est jugée, la vérité est dite »[65] et, par conséquent, l’autorité qui découle de la chose jugée devrait être fondée sur l’idée de vérité. C’est cependant faire fi des possibles entraves à la bonne marche du procès et qui ont parfois conduit le juge à prononcer un jugement en déphasage ou parfois en opposition avec la vérité. Même si le procès est théoriquement un processus de découverte de vérité[66], l’investiture d’une décision de l’autorité voire de la force de la chose jugée ne devrait pas suffire à affirmer sans réserve que la vérité a été dite. Avant d’être un juge, le magistrat qui, seul ou en collégialité, a rendu la décision, est d’abord un être humain. Or celui-ci, en plus d’être faillible est, il faut le souligner, ondoyant et divers. De plus, la justice est un tout organisé dans un système judiciaire qui peut connaître des défaillances. Il peut donc arriver qu’à l’occasion d’un procès, le juge ne rende pas une bonne justice soit parce qu’il a commis une erreur, soit à cause du système qui lui a permis d’abuser de son pouvoir. Un auteur affirme même que le « procès civil n’est pas une mécanique tendue vers la conquête de la vérité »[67] et un autre, relativisant cette affirmation, relève que « le droit comme le procès civil se contentent d’une vérité satisfaisante au regard des normes sociales »[68].
À côté des cas d’abus de pouvoir et d’erreurs judiciaires[69], on peut ajouter que le droit ne considère pas la vérité pouvant résulter de l’autorité de la chose jugée comme absolue ou définitive, car il ouvre des voies de recours tendant à la remettre en cause et, par voie de conséquence, à la rejeter. Il ne peut donc s’agir que d’une vérité judiciaire provisoire qui, parfois, s’écarte de la vérité matérielle. De même, en consacrant de manière générale un simple pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le droit fragilise curieusement la vérité qui découlerait de cette autorité. Plus curieux encore, les juges font parfois reculer l’autorité de la chose jugée[70]. Même si la décision de justice contient une erreur[71] ou est manifestement irrégulière, la chose jugée ne peut être remise en cause et l’autorité qui en découle, ni directement ni indirectement par ou contre ceux à qui elle est opposable. En tout cas, la critique post-moderne du droit conduit à remettre nettement en cause l’idée d’une vérité intrinsèque du jugement et à ne voir dans la vérité judiciaire qu’une vérité construite[72]. L’autorité de la chose jugée ne devrait donc pas être fondée sur l’idée de vérité ou sur l’idéal de justice dont elle serait l’expression. En fait, elle vise à assurer la sécurité juridique : que la décision juridictionnelle soit rendue à tort ou à raison, elle empêche le recommencement du même procès. Bien plus, l’institution de l’autorité de la chose jugée est justifiée par sa finalité pratique et son utilité sociale : « la conclusion de la chose jugée se fonde, au-delà du texte de la loi, sur une nécessité sociale. Nul besoin d’aller chercher ailleurs la justification et le fondement. Il faut éviter le renouvellement des procès »[73].
En fait, la chose jugée est seulement tenue pour vraie et est censée l’être (habetur), parce que la loi a voulu qu’il en soit ainsi. Il n’est pas dans la formule latine qu’elle est vraie. On retrouve aussi en latin l’expression res judicata pro veritate accipitur, qui signifie que « la chose jugée est tenue pour la vérité ». Et comme le souligne le Doyen Carbonnier, le droit « fait l’aveu hautin de l’irréalité de son univers : la chose jugée n’est pas la vraie vérité ; elle est reçue (accipitur) par le bon peuple pour tenir lieu de vérité (pro veritate) »[74]. Un auteur relève même que si « la chose jugée était toujours vraie, il n’y aurait pas besoin de la tenir pour vraie ; la vertu de son autorité légale est de couvrir les décisions erronées »[75]. La chose jugée couvre même les erreurs judiciaires puisqu’elle vaut même si elle l’a été à tort, par l’effet d’une erreur judiciaire. En cela, l’autorité de la chose jugée se rapprocherait plus de la fiction que de la présomption, parce qu’il n’est pas absolument vrai que toutes les énonciations du jugement correspondent à la vérité.
Si l’autorité de la chose jugée est ainsi techniquement dissociée de la nature vraie ou fausse de la décision de justice, elle traduit l’idée de la recherche de la sécurité juridique. En droit camerounais, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui se substitue en matière commerciale aux Cours de cassation des États parties à l’OHADA et dont à la Cour suprême du Cameroun, retient dans un arrêt important que l’autorité de la chose jugée est un principe fondamental de justice qui assure la sécurité juridique[76]. Dans cette décision, la CCJA a fait un exercice d’exégèse qu’il faudrait apprécier : elle a montré que si l’autorité de la chose jugée participe de l’ordre public international, c’est parce qu’elle assure la sécurité juridique.
Le lien entre l’autorité de la chose jugée et la sécurité juridique est justifié : en interdisant, sauf voies de recours légalement ouvertes, le réexamen d’une même affaire, elle permet d’éviter la coexistence dans un même ordre juridique de décisions contradictoires. L’impératif de la non-contrariété de jugements est tel qu’au cas où par extraordinaire deux décisions contraires venaient à coexister, l’autorité de la seconde doit être anéantie afin que soit assurée la sécurité juridique[77].
Bien plus, l’autorité de la chose jugée est en même temps un instrument de sécurité juridique et de paix sociale, car elle assure la fin des conflits. Ce double objectif est mis en évidence par plusieurs auteurs : « lorsque le juge a dit le droit, il faut, à un certain moment, que ce dire s’impose à tous, que le droit ainsi dit puisse s’insérer dans l’ordonnancement juridique ; précautions prises, tant au niveau de l’élaboration de l’acte juridictionnel que des voies de recours, la sécurité juridique commande d’empêcher toute remise en cause, de donner un terme au litige et d’arrêter le processus judiciaire »[78]. Sous l’angle de la philosophie du droit, elle apparaît comme un élément essentiel du contrat social. Par le pacte social, chaque individu renonce à se faire justice à lui-même. En compensation à ce renoncement à la vengeance privée, il remet à un tiers, l’État, la cité ou la société, le pouvoir de trancher les litiges. Le juge étatique comme les arbitres se voient ainsi confier une mission de protection juridictionnelle des citoyens : c’est un devoir qui leur incombe et s’ils venaient à y manquer, un déni de justice se constituerait. L’autorité de la chose jugée est un complément nécessaire de cette renonciation à se faire justice à soi-même. En assurant à chacun la stabilité de la protection juridictionnelle accordée, elle garantit l’apaisement des conflits et le maintien de la paix sociale. La tradition juridique de la Common Law par exemple rend compte de cette vertu pacificatrice à travers le « principle of finality », traduit comme « principe de l’achèvement »[79], dans lequel un juge anglais a vu « un principe fondamental »[80]. Montesquieu l’a exprimé dans une formule demeurée célèbre : « le repos des familles et de la société tout entière se fonde non seulement sur ce qui est juste, mais sur ce qui est fini »[81].
Il serait nécessaire que les législateurs camerounais et français rompent définitivement le rattachement de cette notion à la vérité pour en faire plus simplement une fin de non-recevoir visant à assurer la sécurité juridique ou une institution de paix sociale. Une telle rupture implique l’abandon du rattachement de l’autorité de la chose jugée à la présomption de vérité légale et à l’idée de force de vérité légale, mais ne présage pas toujours de l’évolution conceptuelle de cette notion d’une fin de non-recevoir d’ordre privé à une fin de non-recevoir d’ordre public qui résulte de la lecture croisée du droit camerounais et du droit français.
II. D’une fin de non-recevoir d’ordre privé à une fin de non-recevoir d’ordre public
Vaste conception d’ensemble de la vie en commun sur le plan politique, économique et juridique, l’ordre public renvoie au « caractère des règles juridiques qui s’imposent dans les rapports sociaux pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives »[82]. En droit processuel, lorsqu’une règle de procédure est d’ordre public, sa violation peut être invoquée par les parties, soulevée d’office par le ministère public et relevée d’office par le juge saisi. Un moyen d’ordre public, par opposition aux moyens d’ordre privé, peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et les juges devraient être tenus de le soulever d’office. Ces définitions et constats amènent à se poser la question de savoir si l’autorité de la chose jugée est, en droits camerounais et français, une fin de non-recevoir d’ordre privé ou d’ordre public. Si la réponse à cette question, en dépit de l’évolution législative récente, demeure identique en droit français, elle a subi une évolution en droit camerounais où la jurisprudence a procédé à une mutation conceptuelle faisant passer cette autorité d’une fin de non-recevoir d’intérêt privé à une fin de non-recevoir d’ordre public[83].
Des regards croisés sur le régime juridique de l’autorité de la chose jugée en droits camerounais et français révèlent que cette institution est dans l’un maintenue comme une fin de non-recevoir d’ordre privé et dans l’autre devenue une fin de non-recevoir d’ordre public (B).
A. Le maintien en droit français de l’autorité de la chose jugée comme une fin de non-recevoir d’ordre privé
En dépit de la modification de l’article 125 alinéa 2 de l’ancien Code de procédure civile par le décret no 2004-836 du 20 août 2004 N° Lexbase : L0896GTD qui a renouvelé les solutions jurisprudentielles traditionnellement admises, l’autorité de la chose jugée demeure, en droit français, une fin de non-recevoir d’intérêt privé.
Avant ce décret, il était clairement considéré que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’était pas d’ordre public. Tout d’abord, la Cour de cassation en déduisait que le juge n’avait pas la possibilité de la relever d’office[84]. Ensuite, de la même manière ne s’agissant pas d’un moyen d’ordre public, l’autorité de la chose jugée ne pouvait pas être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation[85] et les parties pouvaient même renoncer à l’invoquer devant le juge qui ne pouvait pas le relever d’office[86]. Enfin, depuis très longtemps et de manière constante, la Cour de cassation considérait « l’exception de la chose jugée » ou, plus exactement la fin de non-recevoir tirée de cette autorité, comme un bénéfice personnel auquel on pouvait renoncer[87].
La doctrine[88] a montré son étonnement face à cette solution seulement limitée par deux exceptions. D’une part, la Cour de cassation française jugeait que lorsque les droits objets de la décision étaient eux-mêmes d’ordre public, parce que les parties n’en ont pas la libre disposition[89], ce caractère rejaillissait sur la décision et rendait l’autorité de la chose jugée d’ordre public. D’autre part, la Cour de cassation admettait traditionnellement que le moyen tiré de la chose jugée était d’ordre public lorsque la juridiction statuait, dans la même instance, sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée[90]. Dans ce cas, l’autorité de la chose jugée devait être relevée d’office par le juge[91] et pouvait être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation[92].
Il y avait là deux petites exceptions à une solution discutable dans son principe, d’autant plus que la Cour de cassation française avait renchéri en jugeant que la violation de l’autorité de la chose jugée ne constituait pas la violation d’un principe essentiel de procédure dont l’allégation devrait ouvrir la voie du recours-nullité autonome[93].
La solution était gênante. Elle l’est également aujourd’hui en dépit de l’intervention législative ayant conduit à la modification de certaines solutions jadis admises par le décret du 20 août 2004 N° Lexbase : L0896GTD. L’alinéa 1er de l’article 125 du Code de procédure civile français N° Lexbase : L1421H4E issu de ce décret prévoit que les « fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ». Son alinéa 2 précise que le « juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
On le voit bien, l’autorité de la chose jugée reste malgré tout, en droit français, une fin de non-recevoir d’ordre privé. L’opposition entre les deux alinéas de l’article 125 N° Lexbase : L1421H4E le montre bien : dans un cas, le juge « doit »alors que dans l’autre, il « peut » relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. La Cour de cassation, depuis l’entrée en vigueur du décret du 20 août 2004 N° Lexbase : L0896GTD, continue à considérer que l’autorité de la chose jugée n’est pas un moyen d’ordre public, de telle sorte que ce moyen ne peut être invoqué pour la première fois devant elle[94]. Dans un arrêt récent du 14 janvier 2021 N° Lexbase : A22964CZ, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation française reprend la position traditionnellement admise selon laquelle le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance[95]. Une telle fin de non-recevoir est exceptionnellement d’ordre public. Il en découle que le Tribunal de grande instance saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge. Dès lors que la Cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir, après l’avoir soumise à la contradiction.
L’autorité de la chose jugée est un principe qui assure la bonne administration de la justice[96]. Corollaire de la litispendance, elle prévient les risques de contradiction entre les décisions. À partir de là, on aurait pu imaginer que la règle du respect de l’autorité de la chose jugée soit d’ordre public. Il est nécessaire de faire de l’autorité de la chose jugée une fin de non-recevoir d’ordre public et en tirer la conséquence qui s’impose : l’obligation pour les juges de la relever d’office dès lors qu’ils ont connaissance d’un précédent jugement rendu entre les mêmes parties et revêtu de cette autorité. Certes, imposer une obligation se heurterait à une impossibilité pratique : les juges n’ont pas toujours accès à l’ensemble des décisions rendues en France comme dans d’autres États malgré les progrès aujourd’hui observés de l’informatisation croissante des juridictions[97]. Mais cet obstacle n’est pas infranchissable dans la mesure où le second procès opposant les mêmes parties, il y a de fortes chances que l’une d’entre elles fasse savoir au juge l’existence d’un jugement étant intervenu entre elles. Même si les parties négligent de soulever l’exception de la chose jugée, le développement de la justice prédictive, composée à la fois de Big data (ensemble des données légales et jurisprudentielles) et des logiciels d’analyse sémantique qui indiquent la solution probable en fonction des mots employés par les juges et les parties dans leurs écrits[98], restreint considérablement le risque pour le juge d’ignorer l’existence d’un précédent jugement rendu entre les mêmes parties. Il serait plutôt nécessaire que le législateur français consacre le caractère d’ordre public de la fin-de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, cette évolution est de nature à assurer le procès équitable, parce qu’elle sied avec la recherche de la célérité procédurale et la garantie d’une bonne justice. Elle évite, en effet, la multiplication ou les saisines infinies des juridictions potentiellement compétentes par les mêmes parties défendant les mêmes causes.
Ensuite, l’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée se justifie par la protection des intérêts de l’institution judiciaire elle-même. Une telle obligation sert aussi bien les parties par la sécurité juridique qu’elle leur apporte que le service public de la justice en assurant le désencombrement des juridictions. Elle évite, plus que la faculté de relever d’office cette fin de non-recevoir, les décisions contradictoires rendues par les juridictions dans un État. Par conséquent, elle est un moyen pouvant stimuler la confiance en l’institution judiciaire. L’objectif de sécurité juridique et de paix sociale qui justifie l’autorité de la chose jugée devrait conduire à conférer à la fin de non-recevoir qui la sanctionne un caractère d’ordre public.
Enfin, même si l’analyse de la jurisprudence récente de la Cour de cassation française révèle, en dépit de la modification de l’article 125 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1421H4E, que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée est notamment « d’ordre public lorsqu’elle concerne des droits qui sont eux-mêmes d’ordre public »[99], il n’est pas toujours aisé de délimiter de manière claire et précise les frontières qui existent entre les moyens d’ordre privé de ceux d’ordre public. L’on comprend pourquoi le caractère d’ordre public de l’autorité de la chose jugée est unanimement admis en procédure pénale qui constitue pour autant une matière de droit processuel[100]. Bien plus en dépit du fait que l’autorité de la chose jugée, comme toute fin de non-recevoir, vise à protéger les intérêts privés (la protection individuelle des parties) et les intérêts publics (la protection de l’intérêt général, plus précisément celui de l’institution judiciaire), les seconds intérêts devraient primer sur les premiers. Il faut simplement que le juge qui est tenu de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, soit légalement tenu de la soumettre à la contradiction.
En outre, le fait que les juges soient tenus de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée lorsqu’ils ont connaissance d’une décision déjà rendue entre les mêmes parties permet de lutter efficacement contre certaines formes d’instrumentalisation du service public de la justice, notamment dans des contentieux de masse comme celui des affaires familiales où certains plaideurs n’hésitent pas à réitérer les demandes dont ils ont été déboutés au lieu d’exercer les voies de recours appropriées. Il faut non seulement barrer la route au procédurier impénitent, mais également garantir la stabilité des droits reconnus au profit du défendeur à la nouvelle action.
Au regard de ce qui précède, l’évolution entreprise par la jurisprudence faisant, en droit camerounais, de l’autorité de la chose jugée une fin de non-recevoir d’ordre public peut être saluée et encouragée.
B. L’admission de l’autorité de la chose jugée comme une fin de non-recevoir d’ordre public en droit camerounais
Traditionnellement, l’autorité de la chose jugée était au Cameroun une fin de non-recevoir d’ordre privé. La Cour suprême reconnaissait qu’elle était une règle d’intérêt privé destinée à sauvegarder les droits acquis des justiciables[101], ne pouvait être soulevée que par les parties [102] qui avaient d’ailleurs la possibilité d’y renoncer[103] même tacitement[104] et devaient en apporter la preuve lorsqu’elle était invoquée[105]. Bien plus, l’autorité de la chose jugée était soumise au régime rigide de la présentation in limine litis prescrit par l’article 97 du Code camerounais de procédure civile et commerciale N° Lexbase : A0064YTK. C’est dans ce sens que la Cour suprême affirmait qu’à l’instar des exceptions de nullité d’exploit ou d’actes de procédure[106], l’autorité de la chose jugée ne pouvait être présentée pour la première fois devant elle[107]. Cette solution est critiquable parce qu’elle conduit à nier la distinction entre les fins de non-recevoir qui doivent en règle être soulevées en tout état de cause quitte pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt et les exceptions de procédure qui ne doivent valablement être soulevées qu’avant tout débat au fond[108]. En dépit des évolutions jurisprudentielles sur la question, ces critiques inclinent à suggérer la modification de l’alinéa 1er de l’article 97 du Code camerounais de procédure civile et commerciale N° Lexbase : A0064YTK qui consacre une telle obligation de présentation in limine litis en ces termes : « toutes les exceptions, demandes en nullités, fins de non-recevoir et tous les déclinatoires visés aux articles précédents sauf l’exception d’incompétence rationae materiae et l’exception de communication de pièces, seront déclarés non recevables s’ils sont présentés après qu’il aura été conclu au fond ». Il est nécessaire pour le législateur camerounais de s’inspirer de l’article 123 du Code de procédure civile français N° Lexbase : L9280LTU qui dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Aujourd’hui cependant, l’autorité de la chose jugée est hissée, par la jurisprudence, au rang des moyens d’ordre public en droit camerounais. Sa conception traditionnelle comme une fin de non-recevoir d’intérêt privé ne retient plus l’attention de la jurisprudence camerounaise contemporaine qui lui applique le régime propre aux fins de non-recevoir d’ordre public. Désormais, la Cour suprême a tendance à reconnaître au juge d’importants pouvoirs dans sa mise en œuvre. Elle décide également qu’elle peut être soulevée en tout état de cause[109], c’est-à-dire à toute phase de la procédure, même après tout débat au fond. Dans un arrêt rendu en 2009, la Cour suprême semble avoir érigé l’autorité de la chose jugée au rang d’une fin de non-recevoir d’ordre public devant, par conséquent, être soulevée d’office par le juge même lorsque les parties sont demeurées silencieuses sur la question. Saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt confirmatif qui avait méconnu l’autorité de la chose jugée, la Cour suprême casse l’arrêt attaqué estimant que les juges du fond auraient dû relever d’office la fin de non-recevoir, quand bien même les parties ne l’avaient pas soulevée[110].
Par un arrêt rendu le 31 janvier 2011 N° Lexbase : A3621WQ8, la CCJA qui se substitue en matière commerciale aux juridictions nationales de cassation des États membres de l’OHADA et dont à la Cour suprême du Cameroun, érige l’autorité de la chose jugée en un principe fondamental de la justice, participant de l’ordre public international[111]. Dans cet arrêt, la société requérante devant la Cour commune fait grief à une sentence arbitrale d’avoir contrarié l’ordre public international. Elle soutient que cette sentence est incompatible avec une décision rendue le 19 juin 2009 dans la même cause par la Cour d’appel de Ouagadougou, décision bénéficiant de l’autorité et de la force de la chose jugée et « devenue de surcroît irrévocable après le rejet du pourvoi fait contre elle ». La CCJA avait à répondre à deux questions dont l’une concerne le lien entre l’autorité de la chose jugée et l’ordre public. Il s’agit de la question de savoir si une sentence arbitrale incompatible avec une décision judiciaire bénéficiant de l’autorité et de la force de la chose jugée est, de ce fait, contraire à l’ordre public international. La réponse de la CCJA est saisissante : une telle sentence est contraire à l’ordre public international. Pour arriver à cette solution, la Cour commune prend la peine de préciser que « l’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure la sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international (…), s’oppose à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties ».
L’importance de cet arrêt dans la modification de l’ordonnancement juridique des États parties à l’OHADA, dont le Cameroun, se voit aisément si l’on considère la formation qui l’a rendu : l’Assemblée plénière de la CCJA[112]. Même si les textes de l’OHADA ne le précisent pas[113], on a relevé que la possibilité de siéger en formation plénière devrait être réservée aux arrêts de principe[114]. En suivant cette logique, il y a lieu comme l’a fait un auteur, de considérer la décision du 31 janvier 2011 comme un arrêt de principe constituant ainsi « une pièce importante dans la construction du droit OHADA »[115] en général et du droit camerounais en particulier. Dans sa teneur, il l’est effectivement, parce que pour la première fois il donne un contenu à une notion au sujet de laquelle la Cour était attendue, l’ordre public international[116], et établit le lien entre cette notion et l’autorité de la chose jugée.
Quoi qu’il en soit, avec l’admission de l’autorité de la chose jugée comme une fin de non-recevoir d’ordre public et l’obligation de la soulever d’office, cette institution n’apparaît plus comme un simple moyen de défense dont la mise en œuvre est laissée à l’entière discrétion des parties, mais comme un instrument procédural entre les mains du juge qui lui permet de gérer l’accès à la justice. Seulement, pour parer aux conséquences qu’une telle obligation peut engendrer, notamment la violation du principe dispositif et du principe d’égalité entre les parties, il est important d’instituer l’obligation pour le juge de respecter le contradictoire et de le faire respecter en soulevant les débats sur cette exception quand elle est relevée d’office. Le juge qui soulève de sa propre initiative une fin de non-recevoir du fait de l’autorité de la chose jugée doit donc soumettre l’examen de ce moyen au débat contradictoire entre les parties en cause. En le faisant, il ménage le sacrosaint principe de la contradiction.
Le respect du contradictoire permet de rétablir l’égalité entre les justiciables. En soulevant d’office un moyen, le juge rompt l’égalité entre ces derniers, car il prend ainsi l’initiative de se substituer à l’une des parties pour suppléer sa carence et vient ainsi à sa rescousse au détriment de son adversaire.
L’obligation de respecter le contradictoire permet enfin de restaurer le principe du dispositif qui se trouve affecté par le pouvoir reconnu au juge de relever d’office l’autorité de la chose jugée. En soumettant la fin de non-recevoir soulevée d’office au débat contradictoire des parties, l’on permet de mettre ces dernières au centre du procès qui a vocation à protéger leur intérêt personnel, tout en garantissant les intérêts de la justice.
La question peut se poser de savoir si le juge est tenu de respecter le contradictoire dans tous les cas où il soulève d’office la fin de non-recevoir attachée à l’autorité de la chose jugée. Une partie de la doctrine pense que le juge peut s’abstenir de provoquer la contradiction dans certaines hypothèses, notamment lorsque le moyen est dans la cause. Il en est ainsi lorsque l’autorité de la chose jugée soulevée d’office repose sur l’existence d’un précédent jugement rendu dans la même instance. Selon la Cour de cassation française, le juge n’est pas tenu de rouvrir les débats lorsqu’il s’agit de soulever d’office l’autorité de la chose jugée d’une décision rendue dans la même instance[117]. Cette solution se justifie, selon certains auteurs[118], par le fait que la première décision est déjà dans le débat ou dans la cause. Or, la théorie des « moyens dans la cause » ou « dans le débat »[119] qui justifierait, dans ce cas, la violation du principe de la contradiction est critiquable au point où il est souhaitable que l’obligation de contradiction soit respectée en toute hypothèse. Certes, le moyen étant dans la cause, la décision protégée par l’autorité de la chose jugée est par définition connue des parties. Mais, l’étendue et la portée de ce moyen peuvent être source de controverses entre les parties. Cela se comprend aisément : la portée d’un jugement, fût-il rendu dans la même cause, n’est jamais chose évidente et l’on pourrait fort bien imaginer que les parties soient en désaccord sur l’étendue de ce qui a été jugé et sur les suites qu’il y a lieu d’en tirer[120]. Cela s’explique d’autant plus que le moyen dans la cause « n’échappe pas à un certain empirisme qu’il est difficile de maîtriser »[121].
Conclusion
Au terme de cette étude croisée du droit français et du droit camerounais, l’on peut retenir que l’autorité de la chose jugée a, aujourd’hui, subi une double mutation conceptuelle.
La première est observable en droit français où la conception classique qui fait de l’autorité de la chose jugée une présomption de vérité légale a, de nos jours, cédé la place à une conception moderne qui en constitue une force de vérité légale. La seconde, observable en droit camerounais, résulte de l’exploitation de la jurisprudence qui a fait passer l’autorité de la chose jugée d’une fin de non-recevoir d’intérêt privé à une fin de non-recevoir d’ordre public.
Seulement, si le choix de traiter d’une telle autorité au sein des présomptions de vérité dans le Code civil de 1804 est critiquable d’un point de vue technique et incline à suggérer au législateur camerounais d’abandonner cette classification, le rattachement, en droit français, de l’autorité de la chose jugée à une vérité même légale est également critiquable. Il serait nécessaire que les législateurs camerounais et français rompent définitivement le rattachement de cette notion à la vérité pour en faire plus simplement une fin de non-recevoir visant à assurer la sécurité juridique ou une institution de paix sociale. Une telle rupture implique l’abandon du rattachement de l’autorité de la chose jugée à la présomption de vérité légale et à l’idée de force de vérité légale. De même, parce qu’elle intéresse la bonne administration de la justice, la sécurité juridique, elle devrait avoir un caractère d’ordre public.
[1] « À la recherche des concepts émergents en droit », D. 2012, p. 1567.
[2] S. Guinchard, « Les métamorphoses de la procédure civile », Gaz. Pal., 31 juillet 2014, n° 212, p. 4 sq ; « Les métamorphoses de la procédure à l’aube du IIIe millénaire », in Clefs pour le 21ème siècle, Paris 2, D., 2000, p. 1135 sq.
[3] C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », Rev. arb. no 1, 2016, p. 3.
[4] L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, Paris, PUF, 2e éd., coll. Thémis droit, 2013, p. 893.
[5] Sur les origines babyloniennes et romaines de l’autorité de la chose jugée, v. par exemple E. Szlechter, « L’autorité de la chose jugée en droit babylonien », in Études Jean Macqueron, Faculté de droit et des sciences économiques d’Aix-en-Provence, Imprimerie Louis-Jean, 1970, p. 613 sq. ; E. Cuq, Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites, Paris, 1920, p. 281 sq.
[6] L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, ibid. Dans le même sens, G. Wiederkehr, « Sens, signifiance et signification de l’autorité de la chose jugée », in Justice et droits fondamentaux, Mélanges Jacques Normand, Litec, 2003, p. 507 sq.
[7] J. Foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, thèse, Paris, 1954, p. 325.
[8] C. Bouty, « Chose jugée », Répertoire de procédure civile, juin 2012 (actualisation : avril 2016), no 3.
[9] V. S. Guinchard et Th. Debard (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 26 éd., 2018-2019, vo « Autorité de chose jugée ».
[10] V. notamment Th. Le Bars, « Autorité positive et autorité négative de chose jugée », Procédures, no 8, août-septembre 2007, p. 9 sq.
[11] Les Allemands et les Italiens la désignent comme la dimension matérielle de l’autorité de la chose jugée (F. Fernand, « Res judicata : From National Law to a Possible European Harmonisation ? », in Festschrift für Peter Gottwald, Verlag C. H. Bech München, 2014, p 143 sq) les juristes français en rendent compte en évoquant la dimension négative de l’autorité de la chose jugée (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, Paris, Dalloz, coll. Précis, 35e éd., 2020, p. 855, no 1197).
[12] V. P. Meyer, « Réflexions sur l’autorité négative de chose jugée », Mélanges Jacques Héron, LGDJ, 2008, p. 331 sq.
[13] V. R.-G. Schwartzenberg, L’autorité de chose décidée, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, 1969, 452 p.
[14] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, 12e éd., 2018, vo « Chose jugée ».
[15] La situation serait différente en droit pénal où pour plusieurs pénalistes l’autorité de la chose jugée n’intervient que lorsque les voies de recours sont épuisées ou fermées. v. notamment B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 20e éd., 2006, no 971 et 981, J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, 13e éd., 2006, no 1032. Contra : S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Litec, 13e éd., 2006, no 2206.
[16] V. S. Guinchard et Th. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, op. cit., vo « Force de chose jugée ».
[17] V. par exemple J. Foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, thèse, Paris, 1954, p. 107 et 142) ; D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, Paris, LGDJ, 1975, nos 19 sq) ; C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2000, nos 6, p. 125 s.
[18] Sur cette efficacité, v. C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 2000, nos 160 et 539.
[19] Pour une définition plus profonde de la notion de fin de non-recevoir, lire notamment G. Block, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Bruylant, 2002, 453 p. ; J.-P. Beguet, « Étude critique de la notion de fin de non-recevoir en droit privé », RTDciv.1947, p. 133-160 ; J. Normand, « Les excroissances des fins de non-recevoir », obs. RTDciv. 1981, p. 684 et C. Bléry, « Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? Une question d’école ? », Procédures, août-septembre 2007, p. 6 sq.
[20] V. art. 457 N° Lexbase : L6567H7D et 481 N° Lexbase : L2302LUS du CPC français.
[21] V. art. 1351 du Code civil de 1804 applicable au Cameroun et 1355 du nouveau Code civil français.
[22] Personne ne doit être attaqué deux fois pour une seule et même cause.
[23] En droit anglais, l’on pense à l’estoppel per rem judicatam, moyen de défense conçu comme un véritable bouclier (B. Fauvarque-Cosson, « L’estoppel ou la confiance légitime », in B. Fauvarque-Cosson [dir.], La confiance légitime et l’estoppel, Société de législation de droit comparé, 2007, spéc p. 11 sq).
[24] V. A. Zeuner et H. Koch, « Chapter 9. Effects of judgments (Res Judicata) », vol. XVI, Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, 2012, n° 8, p. 4. V. art. 324 du Code de procédure civile italien.
[25] Pour le droit anglais, v. R. Stürner, « Preclusive effects of Foreign Judgements-the European Tradition », in R. Stürner et M. Kawano (dir.), Current Topics of international Litigation, Mohr Siebeck, 2009, n° 4.
[26] Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006, no 04-10.672, N° Lexbase : A4261DQU JCP G, 2007, II, 10070, note Widerkehr.
[27] V., entre autres, Civ. 2e, 21 janvier 2010, no 08-17.707 N° Lexbase : A4615EQY, Bull civ. II, no 14; Civ. 3e, 20 janvier 2010, no 08-70.206 N° Lexbase : A4761EQE, Bull. civ. III, no 17; Civ. 2e, 27 février 2020, no18-23.972 N° Lexbase : A78413GI, Gaz. Pal., 21 juillet 2020, p. 61, obs. V. Égéa,
D. actu. 24 avril 2020, obs. Bléry et no 18-23.370 N° Lexbase : A49693G7, D. actu. 24 avril 2020, obs. Bléry.
[28]V. I. Ndam, « La réception du principe de concentration des moyens en droits africains », Revue RAMReS, vol. 2, no 2, mai-juillet 2023, p.70 sq.
[29] V., entre autres, L. Laurens, De l’autorité de la chose jugée en matière civile, thèse, Toulouse, 1852, 77 p. ; N. Valticos, « L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil », RIDC, 1954, vol.6, no 3, p. 619 sq.
[30] v. notamment, L. Cadiet et D. Loriferne (dir.), L’autorité de la chose jugée, Paris, LGDJ, coll. « Bibliothèque de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne-André Tunc », 2012, 178 p. ; C. Bléry, « Retour sur l’autorité de la chose jugée », Dalloz Actualité, 28 avir. 2020.
[31] Sur ce décret, v. N. Fricéro, « Le décret du 20 août 2004 : une adaptation du procès civil aux exigences modernes d’une justice de qualité », Droit et Procédure, n° 1, 2005, Chron. 1.
[32] L’OHADA est l’acronyme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
[33] On songe notamment aux recherches réalisées en France par F. Ferrand (« Res judicata : From National Law to a Possible European Harmonisation? », in Festschrift für Peter Gottwald, verlag C. H. Beck München, 2014, p. 143 sq), C. Chainais (« L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé », Rev. arb. no 1, 2016, p. 3 sq) ou en Allemagne, par R. Stürner (« Preclusive effects of Foreign Judgements – the European Tradition », in R. Stürner et M. Kawano (dir .), Current Topics of international Litigation, Mohr Siebeck, 2009, p . 239) et par Albrecht Zeuner et Harold Koch (« Chapter 9. Effects of judgments (Res Judicata) », vol. XVI, Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Mohr Siebeck, 2012).
[34] L’on pense aux études réalisées au Cameroun par L. Hounbara Kaossiri, (« L’autorité de la chose jugée en procédure civile camerounaise : vers la consécration d’une fin de non-recevoir d’ordre public », Civil Procedure Review, vol. 6, no 2 (65-98), may-aug., 2015, p. 65 sq.), A.-F. Tjouen, (« La chose jugée et la vérité dans le procès civil en droit camerounais », RIDC, vol. 67, no 3, 2015 p. 727 sq.) et en France par C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, (Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, Paris, Dalloz, coll. Précis, 35e éd., 2020, no 1195) ou encore C. Bouty, (« Chose jugée », Répertoire de procédure civile, juin 2012 [actualisation : avril 2016].
[35] Sur ces divergences, v. G. Wiederkehr, « Sens, signifiance et signification de l’autorité de la chose jugée », in Justice et droits fondamentaux, Mélanges Jacques Normand, op. cit., p. 507 et C. Brenner, « Les conceptions actuelles de l’autorité de la chose jugée en matière civile au regard de la jurisprudence », in J. Foyer et C. Puigelier (dir.), Le nouveau code de procédure civile [1975-2005], Economica, 2006, p. 221 sq.
[36] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, Paris, Dalloz, coll. Précis, 35e éd., 2020, p.852, no 1195.
[37] V., par exemple, art. 1382 N° Lexbase : L1018KZQ du nouveau Code civil français.
[38] Sur ces définitions, v. notamment S. Guinchard et Th. Debard (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 26 éd., 2018-2019, p. 1687 et G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Paris, PUF, 12e éd., 2018, p. 1594. Le terme de « præsumptio » apparaît en droit français par exemple sous Justinien consacrant certaines des présomptions du droit prétorien, afin de permettre au plaideur de tirer d’un fait connu un fait inconnu. Ce mode de preuve était désigné avant cela sous les termes « signum ou indicium » (v. J.-P. Lévy, A. Castaldo, Histoire du droit civil, Paris, Précis Dalloz, 2e éd., 2010, p. 893).
[39] Pour ces justifications, v. S. Yahia Cherif, « L’autorité de la chose jugée, présomption légale de vérité », Clio@Themis [En ligne]
[40] J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel ; Le droit public et Legum Delectus, Paris, Nouvelle édition, La Veuve Cavelier, 1756, Livre III, titre VI, section IV, I.
[41] R. -J. Pothier, Traité des obligations, t. II, Paris, Orléans, Debure, RouzeauMontaut, 1774, p. 425.
[42] Un tel héritage est renforcé par la réception en droit Camerounais de la jurisprudence de la Cour de cassation française d’avant 1960, jurisprudence très ancienne entrée dans le droit positif de plusieurs pays africains par le jeu de la colonisation et y est restée souvent de droit positif faute de remise en cause.
[43] Y. Thomas, « Fictio Legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », Les opérations du Droit, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 2011, p. 134.
[44] F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Précis, Dalloz, 10e éd., 2016, p. 484.
[45] Y. Thomas, « Fictio Legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales », op. cit., p. 133.
[46] J. Foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, thèse, Paris, 1954, p. 320.
[47] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, op. cit.,no 1194.
[48] V. X. Lagarde, Réflexion critique sur le droit de la preuve, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, 1994, nos 241 et 245 : l’autorité de la chose jugée est une présomption doublée d’une fin de non-recevoir ; S. Guinchard et Th. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, op. cit., vo « Autorité de chose jugée » ; S. Yahia Cherif, « L’autorité de la chose jugée, présomption légale de vérité », Clio@Themis no 19, 2020, mis en ligne le 24 novembre 2020, consulté le 17 février 2024 [en ligne]
[49] Sur ces critiques, v. par exemple E. J. Couture, « La chose jugée comme présomption légale. Note critique sur les articles 1349 et 1350 du Code civil », RIDC, 1954, p. 681 sq.
[50] Sur la logique juridique et en particulier les présomptions, v. C. Perelman, Logique juridique. Nouvelle rhétorique, Paris Dalloz, Méthode du droit, 1979, réimp. Bibliothèque Dalloz, 1999, p. 31 sq. et 61 sq.
[51] R. Morel, Traité élémentaire de procédure civile, Paris, Sirey, 1932, p. 600. La présomption légale attachée à l’autorité de la chose jugée fut, plus nettement encore, remise en question par Jean Foyer, se référant fréquemment à Giuseppe Chiovenda et Henri Motulsky dans la seconde moitié du XXe siècle. V. G. Chiovenda, « Studi sulla cosa giudicata », Nuovi saggi di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1912, p. 67-72 ; Principi di diritto processuale civile, Napoli, Jovene, 1923, §. 78, p. 758-783.
[52] G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, Paris, PUF, 3e éd., 1996, p. 595 et P. Mayer, « Réflexions sur l’autorité négative de chose jugée », Mélanges Héron, 2008, LGDJ, no 6.
[53]P. Mayer, Réflexions sur l’autorité négative de chose jugée, op. cit., no 6.
[54] D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, Paris, LGDJ, 1975, nos 326 sq.
[55] P. Mayer, « Réflexions sur l’autorité négative de chose jugée », ibid.
[56] V. notamment, J. Foyer, L’autorité de la chose jugée en matière civile, Essai d’une définition, Thèse, Paris 1954, n° 66, p. 29 ; H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée
en matière civile », D. 1968, chr. 1, n° 2 ; D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en
matière civile, t. VII Obligations, 2 ᵉ partie, LGDJ, 1931, n° 1552, p. 890. C. Bléry, « Qu’est-ce que l’autorité de la chose jugée ? Une question d’école ? », Procédures 2007, étude 11, n° 1 ; C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, Paris, Dalloz, coll. Précis, 35e éd., 2020, no 1195.
[57] N. Fricero, « Le fabuleux destin de l’autorité de la chose jugée », Principes de Justice. Mélanges Jean-François Burgelin, Paris, Dalloz, 2008, p. 199.
[58]Motulsky se fonde à la fois sur des raisons pratiques et théoriques pour demander l’actualisation de la délimitation de la chose jugée. V. H. Motulsky, « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », Dalloz – Sirey, 1958, Chron. 1, reprod. Écrits. Études et notes de procédure civile, Paris, Dalloz, 2010, p. 202-203.
[59] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, op. cit., no 1195.
[60] J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil. Introduction générale, 2e éd., LGDJ, 1983, p. 472.
[61] V. respectivement le Littré et le Petit Larousse illustré, vo « Preuve ».
[62] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, op. cit., no 1195.
[63] V. G. Chantepie, M. Latina, La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Paris, Dalloz, 2016, p. 935 sq.
[64] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, op. cit., no 1195.
[65] A. -F. Tjouen, « La chose jugée et la vérité dans le procès civil en droit camerounais », op. cit., p. 727.
[66] M. -A. Frison-Roche, Généralités sur le principe du contradictoire, thèse, Paris, 1988, p.187.
[67] D. Tomasin, Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, Paris, LGDJ, 1975, no 329.
[68] V. J.-M. Le Masson, La recherche de la vérité dans le procès civil, thèse dactyl., Nantes, 1991, cité par C. Bouty, « Chose jugé », Répertoire de procédure civile, juin 2012 (actualisation : avril 2016), no 263.
[69] Sur ces erreurs, v. J. Vergès, Les erreurs judiciaires, Paris, PUF, 2e éd., coll. « Que sais-je ? », 2019, 126 p. ; M.-A. Frison-Roche, « L’erreur du juge », RTDciv., octobre 2001, p. 819 sq. ; D. Inchauspé, L’erreur judiciaire, Paris, PUF, coll. « Questions judicaires », 2010, 528 p ; N. Dongrois, « L’erreur judiciaire en matière pénale. Regards croisés sur ses contours et ses causes potentielles, 2e éd. Schulthess, coll. “quid iuris ?”, 2022, 330 p.
[70] V. par exemple l’arrêt rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation française le 29 mai 2019, n° 18-17.377 N° Lexbase : A1054ZDE, (D. 2019. 1171, AJ fam. 2019. 406, obs. M. Trinquet, RTD civ. 2019. 560, obs. A.-M. Leroyer), dans lequel la Cour admet que des éléments fixés par décision de justice — la durée et le montant d’une rente — peuvent constituer des faits nouveaux susceptibles de rendre caduque l’autorité de la chose jugée. Lire utilement, R. Legendre, « Autorité de la chose jugée et fait nouveau : quand l’exécution d’une décision justifie sa révision… », Rec. Dalloz, 2020 p. 267 sq.
[71] Civ. 1re, 3 novembre 1966, JCP 1966, II, 14880, 22 juillet 1986, Bull. I, no 225; Soc. 19 mars 1998, Bull. V, no 158; Com. 20 octobre 2009, no 08-18.321 N° Lexbase : A2675EMZ, Bull. civ. IV, no 130 et 16 novembre 2010, no 09-71.935 N° Lexbase : A5924GKM, Bull. civ. IV, no 171.
[72] Sur les dangers de pousser cette analyse dans les limites excessives, v. C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, op. cit., no 1198.
[73] J. Foyer, De l’autorité de la chose jugée en matière civile. Essai d’une définition, op. cit., p. 325.
[74] J. Carbonnier, Droit Civil. Introduction, Paris, PUF, 27e éd., 2022, p. 192.
[75] Ch. Atias, « L’erreur grossière du juge », D. 1998, p. 280.
[76] V. CCJA, Ass. Plén., arrêt n° 03/2011 du 31 janvier 2011, Aff. Société Planor Afrique S.A. C/ Société
Atlantique Telecom S.A., N° Lexbase : A3621WQ8 Le Juris Ohada n° 2, avril-juin 2011, p. 8.
[77] La solution est consacrée par l’article 617 du Code de procédure civile français.
[78] C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil, MARD et arbitrage, op. cit.,no 1199, p. 856 sq.
[79] V. C. Chainais, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile : perspectives de droit comparé», Rev. arb. no 1, 2016, p. 6.
[80] Smith vs Brough, [2005] EWCA Civ 261, [54].
[81]Cité par G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, 1996, n° 139.
[82] V. S. Guinchard et Th. Debard (dir.), Lexique des termes juridiques, op. cit., vo « ordre public ».
[83] V. L. Hounbara Kaossiri, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile camerounaise : vers la consécration d’une fin de non-recevoir d’ordre public », op. cit., p. 65 sq.
[84] V. par exemple Civ. 24 octobre 1951, JCP 1952. II. 6806, note Perrot, RTD civ. 1952. 254, obs. Hébraud ; 18 mai 1955, JCP 1955, IV, 93 ; Soc. 12 mars 1969, Bull. V, no 150; 20 juin 1990, Bull. V. no 311; Com. 29 mars 1965, Bull. civ. III, no 238 ; Civ. 2e, 20 juillet 1970, Bull. civ. II, no 251; 24 novembre 1976, Bull. civ. II, no 315, D. 1977. IR 75 ; Civ. 3e, 20 mai 1992, no 90-13.598 N° Lexbase : A5156AHG, Bull. civ. III, no159; Civ. 2e, 10 avril 1995, D. 1996, Somm. 135, obs. Julien ; 4 décembre 2003, D. 2004. IR 109, JCP 2004. IV. 1198.
[85] V. entre autres, Req. 29 mai 1911, DP 1912/1, 269 ; Civ. 2e, 4 octobre 1972, Bull. civ. II, no 230; 25 octobre 1972, Bull. civ. II, no 254; 15 décembre 1980, Bull. civ. II, no 264; Com. 19 juillet 1983, D. 1984, IR 240, obs. Julien.
[86] Civ. 27 janvier 1857, DP 1857/1. 82 ; Civ. 2e, 10 février 1960, Bull. civ. II, no 108.
[87] V. Cass. Civ., 27 janvier 1857, DP 1857, 1, 82 ; Req. 11 décembre 1895, DP 1896, 1, 468 ; Cass. Civ. 2e, 10 avril 1995, Bull. civ. II, no 121.
[88] F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Précis Dalloz, 6e éd., 2003, no 610 ; J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 27e éd., 2003, no 184.
[89]V. Civ. 1re, 19 mai 1976, Bull. civ. I, no 184, D. 1976, IR 224, RTD civ. 1976. 820, obs. Normand.
[90] V. Cass. civ. 29 octobre 1990, Bull. Civ. I, no 225; Cass. civ. 2e, 10 mars 1993, RTD civ. 1993, p. 890.
[91] V. Civ. 3e, 16 octobre 1970, Bull. civ. III, no 528; 24 février 1976, Bull. civ. III, no 85; Civ. 1re, 7 avril 1976, Bull. civ. I, no 113; RTDciv.1976. 821; 19 mai 1976, Bull. civ. I, no 184; Com. 28 juin 1976, Bull. civ. IV, no 216; Civ. 1re, 29 juin 1977, Bull. civ. I, no 304; Soc. 20 janvier 1982, Bull. civ. V, no 27; Civ. 2e, 22 mars 1982, JCP 1982, IV. 201 ; Civ. 1re, 29 octobre 1990, no 8716.605, Bull. civ. I, no 225. - Civ. 2e, 2 décembre 1992, no 91-15.787 N° Lexbase : A5959AH8, RTD civ. 1993. 890, obs. Perrot ; 10 mars 1993, D. 1993, IR 90 ; 25 mai 2000, no 97-20.412 N° Lexbase : A1476C33 ; Soc. 30 janvier 2001, no 98-43.901 N° Lexbase : A9787ASB ; 3 mai 2001, no 99-40.945 N° Lexbase : A3444ATQ.
[92] V. Civ. 3e, 6 décembre 1977, Bull. civ. III, no 425.
[93] V. Com., 2 mai 2001, JCP 2001, IV, 2144.
[94] V. Civ. 1re, 17 janvier 2006, no 05-10.875, N° Lexbase : A4131DMX Bull. civ. I, 2006, no 11.
[95] V. Cass. Civ. 2e, 14 janvier 2021, no 19-17.758, N° Lexbase : A22964CZ D. 15 février 2024, note C. Bléry.
[96] V. F. Terré, Introduction générale au droit, Paris, Précis Dalloz, 6e éd., 2003, no 610.
[97] Sur cette informatisation, v. notamment M. Legras, « Les technologies de l’information et de la
communication, la justice et le droit. Contribution à la réflexion sur l’incidence de la technique sur le droit », Lex Electronica, vol. 7, no 2, Printemps / Spring 2002, p.1 sq ; S. Bories, « L’informatisation des données juridiques et doctrinales : une contribution à la connaissance et à la recherche juridique », Documentaliste-Sciences de l’Information, vol. 40, no 3, 2003, p. 272 sq.
[98] Sur cette justice, v. B. Dondero, « Justice prédictive : la fin de l’aléa judiciaire ? », D. 2017, p. 532 sq ; A. Garapon, « Les enjeux de la justice prédictive », JCP 2017, p. 31 sq ; F. Rouvière, « La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal », RTDCiv., no 02, 2017, p.527 sq ; S. Lebreton-Derrien, « La justice prédictive. Introduction à une justice “simplement” virtuelle », Archives de philosophie du droit, 2018/1 (tome 60), p. 3 sq.
[99] C. Bouty, « Chose jugée », Répertoire de procédure civile, juin 2012 (actualisation : avril 2016), no 279.
[100] Pour la procédure pénale, v. par exemple B. Bouloc, Procédure pénale, 24e éd., coll. Précis Droit privé, Dalloz, 2014, n° 1172, p. 1037 sq ; J. Larguier et Ph. Conte, Procédure pénale, Paris, Dalloz, 23e éd., coll. Mémentos, 2014, p. 422 ; É. Verny, Procédure pénale, Paris, Dalloz, 4e éd., coll. Cours, 2014, n° 517, p. 300. Pour des applications jurisprudentielles en matière pénale, v. Cass. Crim. 18 décembre 1989, Bull. crim., no 483 ; 3 juin 1997, Bull. crim. no 217. Pour le contentieux administratif, lire entre autres G. Lebreton, Droit administratif général, Paris Dalloz, 7e éd., coll. Cours, 2014, n° 49, p. 67.
[101] V. CS/CO, arrêt n° 205/P du 2 juin 1970, Bull. no 22, p. 2664 ; n° 173 du 29 juin 1971, Bull. n° 24, p. 3102.
[102] CS/CO, arrêt n° 205/P du 2 juin 1970, Bull. n° 22, p. 2664.
[103] CS/CO, arrêt n° 45/CC du 18 février 1969, Bull. 17, p. 2459 ; arrêt no 173 du 29 juin 1971, Bull. no 24, p. 3102.
[104] V. CS/CO, arrêt n° 45/CC du 18 février 1969, Bull. no 17, p. 2459.
[105] V. CS, arrêt n° 105/Civ. du 28 mai 2011, AXA Assurance Cameroun c/ Njoumelongue Krispo et autres, inédit.
[106] V. CS, arrêt du 4 juin 1977, inédit ; arrêt n° 120/CC du 26 mai 1983, RCD, Série 2, n° 29, p. 199-210 ; arrêt n° 114/CC du 17 mai 1983, RCD n° 29,1985, p. 196-210 ; arrêt n° 158/CC, du 15 septembre 1983, RCD, op.cit., p. 248-256.
[107] V. CS/CO, arrêt n° 173 du 29 juin 1971, Bull. n° 24, p.3102.
[108] Sur ces critiques, v. L. Hounbara Kaossiri, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile camerounaise : vers la consécration d’une fin de non-recevoir d’ordre public », op. cit., p. 77 sq.
[109] V. CS, arrêt n° 121/Civ. du 17 décembre2009, Aff. Madola P. C/ La SGBC-S.A., inédit.
[110] CS, arrêt n° 121/Civ. du 17 décembre 2009, op. cit., inédit.
[111] CCJA, Ass. Plén., arrêt n° 03/2011 du 31 janvier 2011 N° Lexbase : A3621WQ8, Aff. Société Planor Afrique S.A. c/ Société Atlantique Telecom S.A., Le Juris Ohada n° 2, avril-juin 2011, p. 8.
[112] Les textes juridiques OHADA, notamment l’article 21 du Règlement de procédure de la CCJA du 30 janvier 2014, parlent de la « formation plénière ». L’appellation « assemblée plénière » est décidée par la CCJA elle-même. Ceci constitue une source de difficulté dans la mesure où il existe aussi une autre formation de la CCJA dénommée « assemblée plénière » lorsqu’elle agit comme centre d’arbitrage (v. art. 2.3 du Règlement intérieur de la CCJA en matière d’arbitrage du 20 septembre 2023). Pour éviter des risques de confusion entre ces deux formations distinctes, il faut trouver un nom différent à l’une d’entre elles (v. S.-P. Levoa Awona, La cour commune de justice et d’arbitrage, Yaoundé, L’Harmattan, coll. L’Harmattan Cameroun, 2021, p. 41, note no 66).
[113] Lire par exemple les dispositions des articles 9 du Règlement de procédure de la CCJA, 23 et 28 du Règlement intérieur de cette Cour.
[114] V. J.-Cl. Bonzi, Commentaires sous l’article 9 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage tel que modifié par le Règlement no 001/2014/CM du 30 janvier 2014, in OHADA, traité et Actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2018, p. 93.
[115] V. J.-M. Tchakoua, « Une pièce importante dans la construction du droit OHADA : l’arrêt Planor Afrique SA. c/ Atlantique Telecom SA. du 31 janvier 2011 », in De l’esprit du droit africain, Mélanges en l’honneur de Paul Gérard Pougoué, Wolters Kluwer, éd. CREDIJ, 2014, p.706.
[116] V. P. -G. Pougoué, J.-M. Tchakoua et A. Fénéon, Droit de l’Arbitrage dans l’espace OHADA, PUA, Yaoundé, 2000, p. 238.
[117] V. par exemple Cass. Com., 26 juin 1984, Bull. civ. IV, n° 205 ; Civ. 1re, 29 octobre 1990, no 87-16.605, Bull. % civ. I, no 225; Civ. 2e, 10 mars 1993, D.1993, IR 90 ; RTDciv.1993, p. 890, obs. R. Pérrot.
[118] J. Héron et Th. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 5e éd., coll. Domat Droit privé, 2010, p. 291.
[119] Sur cette théorie, lire utilement A. Bénabent, « Les moyens relevés en secret par le juge », JCP 1977, I. 2849 ; G. Bolard, « Le principe de contradiction et les faits tirés du dossier », D.2002, p. 2704 ; « Les faits tirés du dossier », in Justice et droits fondamentaux, Mélanges en l’honneur de J.NORMAND, Litec, 2003, p. 43 ; R. Pérrot, « Principe de la contradiction et les faits dans le débat », RTDCiv. 2011, p. 590.
[120] V. dans le même sens, R. Pérrot, « Chose jugée et principe de la contradiction », note sous (deux arrêts) Civ. 2e, 2 décembre 1992 et 10 mars 1993, RTDciv.1993, p.890.
[121] L. Hounbara Kaossiri, « L’autorité de la chose jugée en procédure civile camerounaise : vers la consécration d’une fin de non-recevoir d’ordre public », op. cit., p. 89.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[Jurisprudence] La fraude lors d’un procès est-il un motif d’ouverture d’un recours devant la CCJA ?
par La rédaction Lexbase Afrique OHADA
Réf:CCJA, 27 avril 2023, n° 105/2023 N° Lexbase : A59312DZ
CCJA, 27 avril 2023, n° 105/2023, Affaire Crédit Foncier du Cameroun
L’arrêt n° 105/2023rendu le 17 avril 2023 par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA) apporte une utile clarification sur la question de la fraude d'une partie au procès en tant que motif de recours en cassation devant la CCJA.
Extrait:
« (...)Sur le troisième moyen, tiré de la fraude orchestrée par le Crédit Foncier du Cameroun
Attendu que madame IMANDY Gisèle Hortense fait grief au jugement attaqué de n’avoir pas déclaré nuls les actes du Crédit Foncier du Cameroun, en ce qu’usant de la fraude, celui-ci a, d’une part, omis d’indiquer qu’elle n’a reçu sur les 95.123.000 FCFA fixés par la convention que la somme de 80.000.000 FCFA et, d’autre part, indiqué dans le cahier des charges que la mise à prix de son immeuble, évalué à plus de 238.000.000 FCFA, était de 70.000.000 FCFA, alors que selon la vieille maxime « la fraude corrompt tout », tous les actes qui en découlent ne peuvent produire le moindre effet ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’Article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, "Le recours en cassation est fondée sur la
violation de la loi, l’incompétence et l’excès de pouvoir, la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, le défaut, l’insuffisance ou la contrariété des motifs, l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes, la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, le manque de base légale, la perte de fondement juridique, le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé";
Mais attendu que ce moyen tiré de la fraude orchestrée par le Crédit Foncier du Cameroun, n’est pas un cas d’ouverture prévu par le texte ci-dessus rapporté ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable»
Contexte :
L'affaire porte sur l'exécution d'une convention de prêt assortie d'une hypothèque conventionnelle par un établissement de crédit. La débitrice a réagi à la saisie de son immeuble en formulant des plusieurs observations, ce qui a conduit le tribunal à accorder un délai de grâce et à ordonner la suspension des poursuites. Lorsque la saisie n'a pas entraîné de paiement pendant le délai de grâce, le tribunal a ordonné une expertise immobilière et, sur la base de ce rapport, a rendu un jugement d'adjudication. La débitrice a formé un recours en cassation devant la CCJA, alléguant que certains actes étaient frauduleux, notamment le défaut d'indication par la banque du montant effectivement mis à la disposition de la débitrice et du prix réel de l'immeuble hypothéqué.
La décision de la CCJA :
La CCJA a rejeté le moyen de cassation en rappelant que les cas d'ouverture du recours en cassation devant la CCJA sont limitativement énumérés par l'article 28 bis de son règlement de procédure. Selon ces dispositions, le recours en cassation est autorisé pour les motifs suivants : violation de la loi, incompétence et excès de pouvoir, violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, défaut, insuffisance ou contrariété des motifs, omission ou refus de répondre à des chefs de demandes, dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, manque de base légale, perte de fondement juridique, fait de statuer sur une chose non demandée ou d'attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé. La CCJA a souligné que ces motifs sont limitatifs, excluant explicitement le moyen fondé sur la fraude d'une partie au procès.
En conclusion :
La CCJA a confirmé que la fraude d'une partie au procès ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en cassation devant elle. Cette décision s’explique par la nécessité de respecter les limites énumérées par le règlement de procédure de la CCJA. Elle est donc de nature à préciser les limites de la compétence attribuée à cette juridiction par les textes de l’OHADA qu’il convient de s’abstenir d’étendre indûment au risque de nourrir les conflits entre la CCJA et les juridictions nationales de Cassation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[En librairie] Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Deuxième édition de l'ouvrage « Droit et Pratique des sûretés réelles OHADA »
par La rédaction

Cette deuxième édition de l'ouvrage met en lumière les évolutions récentes et les pratiques actuelles des sûretés dans l'espace OHADA, offrant une analyse rigoureuse des mécanismes de protection des créances.
À travers cette édition révisée, l'autrice explore les différents types de sûretés réelles, telles que les hypothèques et les sûretés mobilières en particulier celles introduites après la réforme de 2010, avec une précision remarquable et un souci du détail qui rendent ce texte indispensable pour les étudiants, les chercheurs et les praticiens. L'ouvrage détaille également le cadre légal et les procédures associées à ces différentes sûretés, avec des exemples concrets et des explications détaillées des implications de chaque sûreté notamment dans le contexte commercial et bancaire.
Chaque chapitre du livre propose un aperçu approfondi des principes, de la formation, de la mise en œuvre et des conséquences des sûretés, enrichi par des revues de jurisprudence récente et des modèles d'actes de procédure. Au-delà de leur présentation, les réformes législatives sont discutées lorsque cela est nécessaire, avec un accent particulier sur leur impact sur la sécurité des transactions et l'amélioration de l'accès au crédit dans les pays membres de l'OHADA.
Cet ouvrage est une ressource précieuse pour quiconque cherche à comprendre ou à naviguer dans le complexe domaine des sûretés réelles en Afrique selon le système OHADA. C'est aussi une contribution significative au corpus de la littérature juridique africaine, affirmant l'engagement des Presses Universitaires d'Afrique à promouvoir le savoir et l'expertise dans le domaine du droit des affaires africain.
Présentation de l'autrice
Yvette Rachel KALIEU ELONGO est agrégée des Facultés de droit et Professeure Titulaire à l'Université de Dschang. Elle est autrice et co-autrice de plusieurs ouvrages en droit OHADA. Coordonnatrice du groupe d'Études et de Recherches en Droit, Institutions et Intégration Communautaire, elle est par ailleurs responsable du Master en Droit des activités Économiques et du Marché CEMAC et membre du Conseil d'établissement de l'ERSUMA.
- Prix public : FCFA 20.000 (30 €)
- Éditeur : Presses universitaires d'Afrique
- Nombre de pages : 272
- Format : 165 x 240 mm
ISBN : 978-9956-532-38-7-4
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[Le point sur...] La réforme de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA : entre avancées et persistance des brèches d’insécurité juridique et judiciaire
par Evariste LELO PHUATI, Doctorant à l’Université de Kisangani en RD. Congo, Chef de Travaux à l’Université Président Joseph Kasa Vubu, Formateur en Droit OHADA/ERSUMA Avocat au Barreau du Kongo Central
La création de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en 1993, fut une réponse à l’insécurité juridique et judiciaire qui régnait dans les États de la zone franc[1]. Cette insécurité était due à la nature désuète et disparate du cadre juridique qui régissait le domaine des affaires dans ces États d’une part, et d’autre part, à son application imprévisible par des pouvoirs judiciaires peu crédibles[2]. Ce qui eut, entre autres, pour conséquence de susciter une méfiance de la part d’investisseurs qui hésitaient, avec prudence, d’investir dans des États considérés comme moins sûrs[3].
L’OHADA fut alors créée dans ce contexte avec comme but primordial de garantir la sécurité juridique et judiciaire dans les États membres[4]. Pour parvenir à la sécurité juridique, il fut décidé d’unifier le droit des affaires à travers l’adoption des actes uniformes, censés contenir des règles simples, modernes et adaptées à la situation économique de ces États[5]. La sécurité judiciaire, en revanche, devait être assurée par la saine application des actes uniformes en amont et par l’exécution effective des décisions rendues par les cours et tribunaux (ou mieux des titres exécutoires) en aval[6].
Au regard de ce but de l’OHADA, la règlementation efficace et efficiente du recouvrement des créances s’est révélée comme un impératif puisque c’est à travers elle que les investisseurs devraient être rassurés quant à la sécurité de leurs probables investissements dans l’espace communautaire[7]. En d’autres termes, il a fallu, au préalable, rassurer les investisseurs sur la certitude de recouvrer, en cas de besoin, leurs créances le plus vite possible et à moindre coût. Claire Séjean-Chazal est d’avis que « l’efficacité du recouvrement est une pierre d’angle de la réussite de l’objectif de l’OHADA »[8]. Anne-Marie Assi-Esso et Ndiaw Diouf considèrent que la réforme des voies d’exécution est l’un des moyens pour faire revenir l’investissement dans les États membres[9]. Joseph Fometeu abonde dans le même sens et affirme que le droit de l’exécution constitue un des leviers essentiels sans lequel l’objectif poursuivi par l’OHADA ne peut être atteint[10]. Joseph Djogbenou quant à lui voit dans l’exécution forcée un aspect de la sécurisation judiciaire recherchée par l’OHADA[11].
Conscient de la nécessité de doter les États membres d’un cadre juridique performant dans ce domaine, les pères fondateurs de l’OHADA se résolurent de retenir expressément le recouvrement des créances et les voies d’exécution parmi les matières faisant partie du droit des affaires et dont les règles devaient faire l’objet d’une unification[12]. C’est ainsi que fut adopté, très tôt, l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dès le 10 avril 1998[13].
En effet, si cet acte uniforme a eu le mérite de doter les États membres d’un droit de l’exécution plus ou moins lisible et cohérent, il a aussi assez souvent été le cible de virulentes critiques doctrinales notamment à cause de la nature l’immunité d’exécution [14] que son article 30 accordait à certaines personnes. Felix Onana Etoundi avait vu dans cette immunité une règlementation en déphasage avec la finalité de l’OHADA et l’évolution du droit comparé sur la question[15]. Filiga Michel Sawadogo a relevé, à travers la même immunité, une incohérence par rapport à la finalité de l’OHADA qui est la garantie de la sécurité juridique et judiciaire nécessaire à la promotion du développement économique et social[16].
Pour tout dire, l’immunité d’exécution telle que réglementée initialement par l’acte uniforme du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT n’avait jamais, comme telle, reçu l’approbation de la doctrine autorisée qui la considérait globalement comme un facteur d’insécurité juridique et judiciaire. C’est ainsi qu’elle appelait constamment à sa réforme à travers une révision de l’acte uniforme[17].
La révision, longtemps attendue, est finalement intervenue à Kinshasa le 17 octobre 2023 N° Lexbase : A6607134. Conformément à l’article 9 du Traité de l’OHADA N° Lexbase : A6607134, le texte révisé est entré en vigueur depuis le 16 février 2024[18]. En effet, s’il s’avère, de toute évidence, que cette réforme apporte globalement de nombreuses innovations formelles et substantielles[19], le législateur OHADA était particulièrement attendu sur la révision de l’article 30 réglementant l’immunité d’exécution. Ce à quoi il ne s’est pas dérobé.
Comparativement à l’ancien texte, le nouveau renferme, à première vue, quelques avancées majeures sur le droit de l’immunité d’exécution. D’une part, il énumère expressément les bénéficiaires de l’immunité d’exécution avec une précision sur leur régime juridique et d’autre part, il adopte une mesure restreignant cette immunité et une autre favorisant le paiement par les personnes publiques des exigibles.
Contre toute attente, la même réforme semble ouvrir des brèches susceptibles de conduire à une insécurité juridique et judiciaire. En effet, la formulation du premier alinéa du nouvel article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A6607134 laisse penser que la liste des personnes immunisées [20] n’est pas en soi exhaustive. Cette approche adoptée par le législateur de la réforme peut susciter des interrogations sur la suite de la liste et l’autorité habilitée de la compéter. Bien plus, l’article 30-2 du même texte autorise au juge de prendre toutes mesures urgentes appropriées lorsque l’exécution forcée ou une saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de personnes morales autres que celles visées à l’article 30 N° Lexbase : A6607134 sont de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public. La demande en vue de la prise de ces mesures peut être formulée par la personne morale concernée ou par le Ministère public. À dire vrai, cet article (30-2) N° Lexbase : A6607134soulève quelques problématiques. Primo, l’identification précise des personnes concernées paraît peu aisée et pratiquement une source des spéculations. Secundo, ces mesures urgentes susceptibles d’être prises par le juge ne sont pas indiquées au même moment que leur réelle nature juridique suscite des interrogations. Bien plus, il y a lieu de se s’interroger si le pouvoir ainsi reconnu au Ministère public de formuler aussi une telle demande ne briserait-il pas l’équilibre nécessaire que le droit de l’exécution moderne est appelé à garantir entre le créancier et le débiteur dans la mise en œuvre des procédures d’exécution.
Ce qui précède suscite de réelles interrogations sur le fait de savoir si la réforme, au-delà de ses avancées, ne serait pas, au même moment, une source insécurité juridique et judiciaire dans certains de ses aspects. Tel est exactement l’objet de cette étude. Elle analyse la réforme sur l’immunité d’exécution afin d’y déceler les avancées (I) et les brèches d’insécurité juridique et judiciaire qu’elle ouvre pour finalement suggérer d’autres pistes (II).
I. Les avancées de la réforme sur l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA
La révision de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution introduit, il faut le rappeler, quelques innovations sur le droit de l’immunité d’exécution. Certaines d’entre elles peuvent, à juste titre, être considérées comme de réelles avancées sur la question. Il en est ainsi de l’énumération expresse des bénéficiaires de cette immunité (A), sans compter sa relativisation et l’adoption d’une nouvelle mesure de nature à faciliter l’exécution par les bénéficiaires de l’immunité d’exécution (B).
A. L’énumération des personnes immunisées au regard de l’AUPSRVE révisé
L’article 30 de l’AUPSRVE du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT dispose ce qui suit : « L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité (…) ».
Cette disposition a longtemps été au centre de controverses doctrinales et jurisprudentielles en ce qu’elle énumérait de manière assez lacunaire les bénéficiaires de l’immunité d’exécution. En effet, son alinéa premier pose, certes, le principe de l’immunité d’exécution, mais, sans clairement en énumérer les bénéficiaires. Le fait que les personnes morales de droit public et les entreprises publiques aient été citées au deuxième alinéa comme personnes contre lesquelles la compensation était possible n’a pas suffi pour mettre fin aux divergences sur la liste des personnes immunisées.
Une certaine opinion a soutenu qu’il revenait à chaque État membre de l’OHADA de déterminer les bénéficiaires de l’immunité d’exécution à partir de son droit interne[21]. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a réfuté cette thèse et a affirmé, par contre, que l’article 30 N° Lexbase : A0099YTT déterminait bel et bien les bénéficiaires de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA. Elle a, à l’origine, retenu les personnes morales de droit public et les entreprises publiques [22] avant d’écarter subtilement ces dernières (les entreprises publiques) dans la suite de sa jurisprudence[23]. La même Cour a, au fil du temps, apporté plus de clarté sur les bénéficiaires de l’immunité d’exécution. Ainsi, a-t-elle fini par arrêter progressivement qu’étaient bénéficiaires de l’immunité d’exécution au regard de l’article 30 : l’État, ses démembrements, les établissements publics [24] et les personnes morales de droit public international[25]. Elle a, par contre, exclu de ce régime les sociétés mixtes soumises au droit privé [26] et les sociétés de fait tenues par l’État[27].
En dépit de ce remarquable apport de la CCJA sur la question, l’énumération claire des bénéficiaires de l’immunité d’exécution est demeurée l’un des points sur lesquels une réforme était vivement attendu surtout au regard de la quasi-instabilité et imprévisibilité de la jurisprudence en la matière.
Le législateur de la réforme du 17 octobre 2023 N° Lexbase : A6607134 s’y est effectivement attelé. En effet, tirant les enseignements du passé, il a adopté une nouvelle approche consistant à énumérer expressément les bénéficiaires de l’immunité d’exécution quand bien même un flou semble persister en ce qui concerne la nature complète de la liste[28].
Au fond, l’acte uniforme révisé fait systématiquement une distinction entre les bénéficiaires de l’immunité d’exécution relevant du droit public interne et ceux relevant du droit public international. Ainsi, sont immunisés en interne, « notamment l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics »[29]. Par contre, sont bénéficiaires de l’immunité d’exécution relevant du droit public international, les « personnes morales de droit public étrangères, les organisations internationales qui bénéficient de l’immunité d’exécution en vertu de conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d’accords d’établissement ou de siège »[30]. Le fait qu’il soit évoqué cette dernière catégorie (personnes morales de droit public international) est un progrès par rapport au texte du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT qui n’y avait pas fait allusion. Seule la jurisprudence de la CCJA y avait fait état en reconnaissant l’immunité d’exécution à un établissement public international[31].
Par ailleurs, le législateur du 17 octobre 2023 N° Lexbase : A6607134 s’est efforcé de lever toute équivoque sur les bénéficiaires de l’immunité d’exécution en se prononçant, cette fois-ci, de manière claire même sur leur régime juridique. Les concernés doivent, en effet, relever d’un régime juridique de droit public (interne ou international)[32]. Le législateur de la réforme a suivi, par-là, la CCJA qui avait, auparavant, exclu du champ de l’immunité d’exécution : « toute entité, y compris celle appartenant à l’État, qui opère sous une forme de personne morale de droit privé (…) régie par les règles de droit privé »[33].
Une telle précision permet au même moment d’écarter tout doute quant à l’exclusion des personnes morales de droit privé du bénéfice de l’immunité d’exécution quand bien même elles auraient été créées par l’État ou avec sa participation. Il faut en déduire que la réforme exclut désormais du bénéfice de l’immunité d’exécution : les entreprises publiques, les sociétés d’État et mixtes soumises à un régime juridique de droit privé. Ce qu’il convient de considérer comme une avancée par rapport à l’ancien texte au même titre que la relativisation de l’immunité d’exécution.
B. La relativisation de l’immunité d’exécution et le renforcement des mesures incitant les personnes immunisées à s’exécuter
L’article 30 de l’AUPSRVE du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT avait institué une immunité d’exécution absolue en ce qu’il consacrait une interdiction totale de faire pratiquer les mesures conservatoires et les saisies contre ses bénéficiaires. Seule la compensation était admise à leur encontre. La compensation, dans ce cas, s’analyse non pas comme une restriction à l’immunité d’exécution, mais plutôt comme un simple tempérament dont la mise en œuvre est conditionnée par la réciprocité des dettes certaines, liquides et exigibles. Il s’ensuivait qu’une telle immunité absolue se mettait en marge de la tendance actuelle du droit comparé et du droit international qui consacre de plus en plus une immunité d’exécution relative notamment au regard d’exigences de l’État de droit et de l’effectivité du droit à l’exécution.
La nature de cette immunité mettait les créanciers des personnes immunisées dans l’impossibilité de procéder à une exécution forcée. La CCJA, en sa qualité d’interprète autorisée du droit communautaire, s’était montrée, à chaque fois, intransigeante, dans la mainlevée des saisies pratiquées contre les bénéficiaires de l’immunité d’exécution[34]. L’exécution, dans ce cas, dépendait surtout de leur bonne foi à tel point que leurs créanciers ne pouvaient que se contenter de les « exhorter » à s’exécuter. C’est pratiquement une sorte « de droit de ne pas s’exécuter » qui leur était reconnu implicitement sous l’acte uniforme du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT.
Une immunité d’exécution d’une telle étendue ne pouvait qu’être incompatible à la garantie de la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace communautaire. En effet, les créanciers des bénéficiaires de l’immunité d’exécution se retrouvaient dans une insécurité juridique et judiciaire face à l’impossibilité de recouvrer leurs créances par la contrainte même lorsqu’ils détenaient des titres exécutoires. Comme cela peut être remarqué, le choix opéré par le législateur allait à l’encontre du but même de l’OHADA. Felix Onana Etoundi y voyait « un recul par rapport à la finalité de l’OHADA »[35]. Joseph Djogbenou a considéré que l’immunité d’exécution sous l’acte uniforme du 10 avril 1998 « constitue un risque juridique et judiciaire qui retient l’investissement économique dans l’espace »[36]. Elle était aussi perçue « comme une forteresse non franchissable par les sujets de droit en relation avec ces personnes publiques »[37]. Il va de soi que pareille immunité ne pouvait pas inspirer confiance aux investisseurs. C’est, au contraire, une méfiance qui était suscitée dans leur chef puisqu’ils ne pouvaient que se sentir en insécurité[38]. Ce qui impactait de manière négative l’essor d’un partenariat public-privé ou même public-public.
Pour toutes ces raisons, la relativisation de l’immunité d’exécution et le renforcement des mesures favorisant le paiement par les personnes immunisées ont fortement préoccupé le législateur de la réforme du 17 octobre 2023 N° Lexbase : A6607134.
Ainsi, au-delà du maintien de la compensation qui était déjà prévue dans l’AUPSRVE du 10 avril 1998[39], le législateur de la réforme vient de consacrer la possibilité de renonciation à l’immunité d’exécution (1) et d’inscription des créances exécutoires ou reconnues dans les budgets des personnes immunisées (2).
1- La possibilité de renonciation à l’immunité d’exécution
Renoncer à l’immunité d’exécution est une solution traditionnelle[40]. Elle consiste, pour un bénéficiaire de l’immunité d’exécution, d’accepter de se soumettre aux mesures conservatoires et d’exécution forcée au même titre qu’un simple particulier. Cependant, la validité d’une renonciation à l’immunité d’exécution est généralement soumise à deux conditions. Elle doit, en effet, être expresse et spéciale[41]. Cela signifie que la personne immunisée doit déclarer expressément renoncer à son immunité tout en mentionnant les biens ou la catégorie des biens pour lesquels la renonciation est consentie[42]. Il s’ensuit qu’une renonciation présumée (implicite) ou généralisée à l’immunité d’exécution n’est pas, en principe, admissible.
L’acte uniforme sur les voies d’exécution du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT n’avait pas prévu comme telle la possibilité de renoncer à l’immunité d’exécution même si la CCJA semblait ne pas s’y opposer[43].
Par contre, l’acte uniforme révisé retient la renonciation comme exception ou restriction au principe de l’immunité d’exécution. Ceci ressort du premier alinéa de l’article 30 l’AUPSRVE révisé N° Lexbase : A6607134 qui dispose que : « Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ». Conformément à l’article 30-3 N° Lexbase : A6607134 du même acte uniforme révisé, la possibilité de renonciation à l’immunité d’exécution est aussi reconnue « aux personnes morales de droit public étrangères et aux Organisations internationales qui bénéficient de l’immunité d’exécution en vertu de conventions sur les relations diplomatiques ou consulaires ou d’accords d’établissement ou de siège ».
Comme il y a lieu de le remarquer, le nouveau texte n’admet qu’une renonciation expresse, c’est-à-dire le bénéficiaire de l’immunité d’exécution doit déclarer clairement y renoncer.
Cependant, l’acte uniforme révisé N° Lexbase : A6607134 est silencieux quant à l’étendue et au moment de cette renonciation. En ce qui concerne l’étendue, il a été relevé précédemment qu’une renonciation doit, en principe, être spéciale. La réforme n’ayant pas apporté cette précision, il y a lieu de considérer avec Ibrahim ADJI que la renonciation consacrée en droit OHADA à un caractère général avec comme conséquence que les saisies pourraient porter sur l’ensemble des biens des personnes publiques concernées[44]. En effet, si la possibilité de renonciation à l’immunité d’exécution est à retenir comme une avancée dans l’espace OHADA, il y a, tout de même lieu, de déplorer son caractère général qui risquerait de mettre à mal le fonctionnement des personnes publiques qui pourraient voir les biens essentiels à l’accomplissement de leur mission être saisis. Nous pensons qu’une renonciation spéciale aurait été plus conciliable avec la mission d’intérêt général confiée aux bénéficiaires de l’immunité d’exécution.
Pour le moment de la renonciation, il convient de considérer qu’elle doit se faire pendant la prise de l’engagement donnant éventuellement lieu, plus tard, aux mesures conservatoires ou d’exécution forcée. C’est dire que la renonciation doit faire partie intégrante de clauses contractuelles. Dans tous les cas, il serait assez aléatoire et peu réaliste d’espérer une quelconque renonciation au moment de l’exécution.
Dans tous les cas, la possibilité reconnue désormais de renoncer à l’immunité d’exécution sera bénéfique aux créanciers des personnes publiques dans le recouvrement de leurs créances. C’est là un atout dans la garantie de la sécurité juridique et judiciaire recherchée dans l’espace OHADA. Ce qui, par ailleurs, renforcera la crédibilité de ces personnes quant au respect des engagements pris par elles, y compris par la contrainte. L’immunité d’exécution ne devra plus nécessairement être considérée comme un frein à l’émergence du partenariat public-privé ou public-public.
La possibilité prévue par l’article 30-1 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A6607134 de faire inscrire les créances dues par les bénéficiaires de l’immunité d’exécution dans leur budget constitue aussi au moyen susceptible de faciliter le paiement.
2- La possibilité de faire inscrire d’office une créance au titre de dépense obligatoire dans le budget de la personne publique immunisée
La réforme du 17 octobre 2023 N° Lexbase : A6607134 innove également en ce qu’il est désormais permis à un créancier impayé de faire inscrire d’office, en vue du paiement, sa créance dans les comptes d’exercice et dans le budget de la personne immunisée. L’article 30-1 N° Lexbase : A6607134 dispose à ce sujet que : « Toute créance constatée par un titre exécutoire ou découlant d’une reconnaissance de dette par une personne morale de droit public, notamment l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public peut, après mise en demeure adressée à l’organe dirigeant ou à l’autorité compétente dans chaque État partie et restée infructueuse pendant un délai de trois mois à compter de la notification, faire l’objet d’une inscription d’office dans les comptes de l’exercice et dans le budget de ladite personne morale, au titre des dépenses obligatoires. La demande d’inscription, adressée au ministre chargé des Finances, est accompagnée des pièces justificatives de la créance et de la mise en demeure. Les créances inscrites à la suite d’une demande d’inscription d’office portent de plein droit intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure ».
Ce tempérament au principe de l’immunité d’exécution qui, par ailleurs, ne concerne que les personnes publiques internes[45] est appréciable en ce qu’il est de nature à faciliter le recouvrement des créances dues par les personnes immunisées en vertu d’un titre exécutoire ou même d’une simple reconnaissance de dette.
Cependant, l’efficacité de ce mécanisme sera surtout tributaire de la volonté des autorités qui interviendront au niveau interne, d’une part et, d’autre part, du respect des contraintes liées à l’exécution du budget. Si dans certains États membres de l’OHADA, il existe une rigueur en matière d’exécution des budgets, il y en a d’autres dans lesquels même l’inscription d’une dépense au budget n’offre aucune sérieuse garantie de paiement.
À côté des avancées précédemment analysées, la réforme comporte également des brèches d’insécurité juridique et judiciaire.
II. La persistance des brèches d’insécurité juridique et judiciaire dans la réforme de l’immunité d’exécution
Une meilleure compréhension de l’insécurité juridique ou judiciaire permettra de réaliser que les articles 30 alinéa 1er et 30-2 de l’AUPSRVE révisé N° Lexbase : A6607134 sont susceptibles d’ouvrir des brèches à une insécurité juridique et judiciaire.
A. Notions de l’insécurité juridique et judiciaire
L’insécurité juridique et l’insécurité judiciaire sont deux concepts distincts même s’ils sont souvent employés l’un à côté de l’autre. Cependant, la maîtrise de leur portée est aussi liée à des concepts qui leur sont opposés, à savoir : la sécurité juridique et la sécurité judiciaire.
En effet, la recherche de la sécurité juridique est présentée comme une valeur essentielle de l’OHADA dont la finalité est de « favoriser l’essor des activités économiques et de promouvoir les investissements »[46]. Cependant, aucun texte officiel de l’OHADA ne définit l’expression « sécurité juridique ». D’après un vocabulaire juridique édité sous la direction de Gérard Cornu, la sécurité, de manière générale, renvoie à « la situation de celui ou de ce qui est à l’abri des risques » [47] tandis que juridique fait allusion à ce qui a trait au droit[48]. Partant, la sécurité juridique peut se comprendre littéralement comme le fait d’être à l’abri des risques pouvant résulter du droit. Le Conseil d’État français restitue le mieux la quintessence de cette notion dans son rapport public de 2006. Il y explique, en effet, que : « Le principe de la sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations très fréquentes, ni surtout imprévisibles »[49]. La sécurité juridique suppose de « règles stables, prévisibles et connues »[50]. Partant, un ensemble normatif est à même de contribuer à la sécurité juridique « s’il est à la fois complet, précis et cohérent »[51]. C’est, en réalité, la qualité de la loi qui est visée à travers la notion de la sécurité juridique.
L’insécurité juridique est justement le contraire de la sécurité juridique. Elle se caractérise, entre autres, par l’instabilité de la règle de droit, son imprévisibilité, son illisibilité ou son manque de clarté ou de cohérence.
La notion de la sécurité et de l’insécurité juridique ayant été explicitée, il convient de s’atteler sur celle de la sécurité et de l’insécurité judiciaire. En effet, le concept de sécurité judiciaire est à rattacher à l’activité des cours et tribunaux. Elle vise spécifiquement l’application correcte de la règle du droit. La sécurité judiciaire postule à la création « des conditions qui placent un usager du service public de la justice à l’abri des risques qui peuvent en résulter (mauvaise application de la loi, insuffisances intellectuelles ou corruption des magistrats, manque d’indépendance et d’impartialité des cours et tribunaux, inexécution des décisions rendues…). C’est rassurer ou mettre le justiciable en confiance quant à la préservation de ses droits par les instances saisies. La sécurité judiciaire implique impérativement un système judiciaire fiable et crédible »[52].
A contrario, l’insécurité judiciaire est l’incertitude ou l’absence de garanties quant à la saine application des règles du droit par les juridictions compétentes et à l’exécution effective des décisions rendues. Elle se traduit substantiellement par le manque de fiabilité et de crédibilité du système judiciaire[53].
B. Les brèches d’insécurité juridique et judiciaire dans la réforme de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA
Si la réforme de l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA comporte des avancées, elle ouvre également des brèches à une insécurité juridique et judiciaire. Ces brèches peuvent, pour l’essentiel, être repérées dans la formulation du premier alinéa de l’article 30 et dans la substance de l’article 30-2 N° Lexbase : A6607134.
1- La formulation du premier alinéa de l’article 30 de l’AUPSRVE révisé, une brèche d’insécurité juridique et judiciaire
Pour besoin de l’étude, il y a lieu de rappeler que l’article 30 alinéa 1er de l’acte uniforme révisé N° Lexbase : A6607134 dispose ce qui suit : « Sauf renonciation expresse, il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ».
Dans cette formulation, l’emploi de l’adverbe « notamment » signifie que la liste des bénéficiaires de l’immunité d’exécution (relevant du droit interne) n’est pas exhaustive. Il y a alors lieu de se demander s’il s’agit là d’un renvoi implicite au droit interne des États. Dans l’affirmative, une telle approche irait non seulement à contre-courant de l’objectif de l’unification du droit des affaires dans l’espace OHADA, mais aussi, serait une source d’insécurité juridique et judiciaire puisque chaque État pourrait conférer (peut-être abusivement) l’immunité d’exécution aux personnes internes de son choix.
Par ailleurs, doit-on mettre cette disposition en lien avec le point 10 du nouvel article 51 N° Lexbase : A6607134 qui dispose que : « Sont insaisissables (…) les biens et les droits déclarés insaisissables par les États parties » ? Pareille liaison n’est pas assez conciliable. En effet, si l’article 51 autorise à un État de déclarer un bien ou un droit insaisissable pour une quelconque raison, cela ne devrait pas être considéré comme un pouvoir qui lui serait reconnu d’immuniser certaines personnes. En effet, malgré l’étroite proximité qu’on leur reconnaît, l’immunité d’exécution ne doit pas être confondue à l’insaisissabilité. L’immunité d’exécution est un privilège conféré à une personne en raison de sa qualité (son régime juridique) et ses missions. Un bénéficiaire de l’immunité d’exécution voit, en principe, ses biens devenir insaisissables sauf en cas de renonciation. Il en résulte que l’immunité est attachée à une personne et non à un bien ou un droit. Par contre, une insaisissabilité peut exister en dehors de toute immunité. Tel est le cas de cet article 51 N° Lexbase : A6607134 qui permet à l’État de déclarer un bien insaisissable sans que cela ne soit synonyme d’une reconnaissance d’une immunité d’exécution.
Au-delà, la formulation de cette disposition ne permet pas de savoir l’autorité habilitée à compléter la liste des bénéficiaires d’exécution laissée ouverte. Ces autres personnes paraissent difficiles identifier. Aucune indication supplémentaire n’est donnée pour rendre leur identification aisée. Ce qui ne peut être qu’une brèche d’insécurité juridique et judiciaire. Pourtant, au regard de controverses auxquelles la détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution a donné lieu sous l’AUPSRVE du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT, le législateur de la réforme aurait dû éviter une telle brèche, source de spéculations ou d’insécurité juridique.
Dans le contexte de l’OHADA, l’adoption d’une liste exhaustive, au niveau communautaire, semble la piste la plus adaptée et la plus sécurisante.
2- L’article 30-2 de l’AUPSRVE révisé, une brèche d’insécurité juridique et judiciaire
L’article 30-2 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A6607134 révisé dispose ce qui suit : « lorsque l’exécution forcée et les mesures conservatoires sont entreprises à l’égard de personnes morales autres que celles visées à l’article 30 du présent acte uniforme et sont de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public, le juge peut, à la demande de la personne morale intéressée ou du ministère public, prendre toutes mesures urgentes appropriées, en subordonnant de telles mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Cette disposition est explicite sur le fait qu’il n’est pas conféré une quelconque immunité d’exécution à la catégorie des personnes visées. Comme on peut y lire, l’exécution forcée et les mesures conservatoires peuvent effectivement être pratiquées à leur encontre. Cependant, une analyse un peu plus poussée révèle que la même disposition peut être une brèche d’insécurité juridique et judiciaire à cause de certaines de ses imprécisions. Il s’agit de l’absence d’énumération claire des personnes visées, l’indétermination des mesures urgentes appropriées susceptibles d’être prises par le juge, l’immixtion du Ministère public dans la procédure d’exécution et l’absence de précision sur les actes de nature à faciliter ou à garantir le paiement.
a- L’ambiguïté autour de personnes morales visées
L’article 30-2 N° Lexbase : A6607134 sous examen fait allusion aux personnes morales autres que celles visées à l’article 30. Autrement dit, il s’agit de personnes morales autres que (notamment) l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
La première difficulté dans l’identification exacte de ces personnes réside dans le fait que l’article 30 N° Lexbase : A6607134 auquel il est renvoyé n’énumère pas ces personnes (immunisées non concernées) de manière exhaustive de par l’emploi de l’adverbe « notamment ». C’est comme pour dire que l’article 30-2 renvoie à l’article à l’article 30 N° Lexbase : A6607134 qui, lui-même, ne donne pas la liste complète des bénéficiaires de l’immunité d’exécution devant être écartés.
La seconde difficulté consiste en ce qu’il n’est pas, par ailleurs, indiqué clairement le régime juridique auquel ces personnes doivent être soumises. La disposition se limite à évoquer « des personnes morales autres ». Il y a lieu, dans ce cas, de s’interroger s’il doit s’agir de personnes publiques ou privées. Il est, certes, vrai que la même disposition semble donner un critère fonctionnel susceptible de conduire à l’identification de ces personnes. Celles-ci devront, en effet, être chargées d’une mission de service public[54]. C’est donc la continuité de ce service public qui doit être gravement mise à mal par les mesures d’exécution forcées ou conservatoires pratiquées contre elles. Cependant, ce critère ne peut vraisemblablement suffire à lui seul pour lever l’équivoque puisqu’une mission de service public peut être confiée tant à une personne morale créée par l’État que par un particulier. Ce qui amènerait alors à se demander si les personnes morales créées par de privées, mais investies d’une mission de service public pourraient également revendiquer le bénéfice du privilège que prévoit l’article 30-2 N° Lexbase : A6607134. En tout cas, rien ne semble s’opposer à cela.
Par ailleurs, ne s’en tenir qu’au critère de service public, laisserait entendre que les entreprises publiques (même transformées en sociétés commerciales), les sociétés d’État et mixtes investies d’une mission de service public pourraient se prévaloir du même privilège. Ce qui serait visiblement un recul par rapport à la jurisprudence de la CCJA qui, sous l’AUPSRVE du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT, avait fini par soumettre ces personnes aux mesures conservatoires et d’exécution sans un quelconque aménagement.
En tout, le manque de clarté sur les bénéficiaires du privilège consacré par l’article 30-2 de l’AUPSRVE est une réelle brèche d’une insécurité juridique, voire judiciaire. Rien n’est précis sur les personnes réellement visées. C’est comme pour dire que le législateur semble avoir laissé à chacun la périlleuse tâche de les identifier. Ce qui est en marge de l’exigence de la sécurité juridique qui voudrait notamment, il faut le rappeler, « que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable »[55].
Cette imprécision qui peut être considérée comme une faiblesse est une porte ouverte à des spéculations doctrinales et jurisprudentielles et cela, au détriment de la sécurité juridique recherchée à travers le droit communautaire. Une telle insécurité juridique ne tardera pas visiblement à devenir aussi une insécurité judiciaire au même titre que l’indétermination des mesures urgentes susceptibles d’être prises par le juge.
b- L’indétermination des mesures urgentes appropriées susceptibles d’être prises par le juge
L’article 30-2 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A6607134 autorise au juge (de l’exécution) de prendre des mesures urgentes appropriées lorsque des saisies pratiquées contre une personne morale (autre que celles reprises à l’article 30) portent gravement atteinte à la continuité d’un service public dont elle a la charge. Ces mesures sont prises à la demande de la personne morale concernée ou du Ministère public.
Il y a lieu de comprendre, à travers cette disposition, le souci, peut-être légitime, du législateur de protéger les personnes morales investies d’une mission de service public contre des saisies susceptibles de mettre à mal la continuité du service et cela, au préjudice de l’intérêt général.
Cependant, il s’avère que ces mesures pouvant être prises par le juge pour cette finalité ne sont nullement énumérées. L’article 30-2 se limite à disposer que le juge peut « prendre toutes mesures urgentes appropriées, en subordonnant de telles mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». C’est pratiquement une forme de « chèque en blanc » qui est remis au juge.
De même, la nature de ces mêmes mesures n’est pas clarifiée. Il n’est pas, en effet, indiqué s’il devra s’agir de décisions judiciaires ou administratives. C’est presque un pouvoir discrétionnaire inédit qui est conféré au juge. C’est à lui seul de commencer à apprécier le degré de gravité des saisies pratiquées sur la continuité du service public et de décider « discrétionnairement » sur les mesures urgentes qu’il jugerait appropriées. La loi semble placer une étrange confiance en ce juge. La décision est entièrement laissée à son appréciation personnelle au point même de rendre complexe tout recours. Comment démontrer lors d’un recours qu’une mesure prise par le juge ne serait pas appropriée dès lors qu’il n’est pas indiqué, au préalable, la mesure ou les mesures possibles ?
Un tel rarissime pouvoir discrétionnaire que l’article 30-2 N° Lexbase : A6607134 reconnaît au juge ne peut qu’être une source d’insécurité juridique et judiciaire. Il y a fort à parier que le juge interne, souvent mal réputé, ne tardera à en faire un usage abusif au préjudice des créanciers et des objectifs de l’OHADA.
c- L’immixtion du Ministère public et l’indétermination d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement
Au-delà des imprécisions relevées précédemment, le pouvoir reconnu au Ministère public dans la mise en œuvre de l’article 30-2 N° Lexbase : A6607134 et l’indétermination d’actes à faciliter et à garantir le paiement posent problème.
Traditionnellement, la pratique des mesures conservatoires et des voies d’exécution concerne, en principe, le créancier qui recouvre sa créance auprès du débiteur. La procédure est conduite par un huissier de justice ou un agent chargé de l’exécution. Un juge de l’exécution est institué pour éventuellement trancher toute contestation ou demande liée à l’exécution.
Partant, le pouvoir que l’article 30-2 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A6607134 reconnaît au Ministère public dans la saisine du juge pour obtenir de lui un privilège en faveur du créancier, personne morale, investie d’une mission de service public sort de l’ordinaire. Ce qu’il convient de considérer comme une immixtion du Ministère public semble briser l’équilibre que le droit de l’exécution moderne s’évertue de garantir entre le créancier et le débiteur dans la mise en œuvre des voies d’exécution. Il s’ensuit que le droit à l’égalité des armes (entre le créancier et le débiteur) comme l’une des garanties de l’équité de toute procédure (même d’exécution) ne peut qu’être mise à mal[56]. En effet, le débiteur se verra gracieusement obtenir un ralliement du Ministère public à sa cause et cela, au détriment du créancier.
Par ailleurs, il y a même lieu de craindre que, par-là, le Ministère public devienne en quelque sorte « un bras prolongé » du pouvoir exécutif pour obstruer les mesures conservatoires et d’exécution pratiquées à l’encontre les personnes morales créées par l’État et investies d’une mission de service public. Ce qui pourrait également être interprété comme une entorse au principe de la séparation des pouvoirs.
L’autre problématique que suscite la même disposition se rapporte à l’imprécision sur les actes propres à garantir ou à faciliter le paiement que devra accomplir le débiteur pour amener le juge à prendre des mesures urgentes appropriées. Au fait, que faut-il comprendre concrètement par « actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » ? Est-ce un paiement partiel ou une promesse de paiement ?
Ces questions sont dépourvues de réponses claires dans l’article 30-2 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A6607134 révisé. Un tel manque de clarté ne pourrait que faire de cette disposition « un germoir » d’insécurité juridique et judiciaire. Il y a lieu de voir à travers cette disposition la volonté, à peine voilée, des États membres de l’OHADA, de conférer aux personnes morales de droit privé créées par eux, un privilège sui generis, à défaut d’être parvenu à « arracher » une immunité d’exécution en leur faveur.
Que conclure ?
Longtemps attendue, la réforme sur l’immunité d’exécution dans l’espace OHADA a eu lieu le 17 octobre 2023 à travers l’adoption, à Kinshasa, d’un acte uniforme révisé sur les voies d’exécution qui est entré en vigueur le 16 février 2024 N° Lexbase : A6607134.
Le nouveau texte comporte des innovations remarquables sur la question. Cependant, une étude un peu plus approfondie permet de réaliser que la réforme ne comprend pas que d’avancées. Il y a également des faiblesses qui peuvent s’analyser comme des brèches conduisant à une autre insécurité juridique et judiciaire au détriment des créanciers et des objectifs de l’OHADA.
Comme avancées, le législateur OHADA a finalement pallié quelques insuffisances de l’article 30 de l’AUPSVE du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT. En effet, les bénéficiaires de l’immunité d’exécution sont désormais énumérés selon qu’ils relèvent du droit interne ou du droit international. Au-delà, la réforme précise le régime juridique dont doivent relever les personnes immunisées. Il doit, en effet, s’agir d’un régime juridique de droit public.
Une autre avancée consiste dans la limitation de l’immunité d’exécution qui était accordée de manière absolue sous l’acte uniforme du 10 avril 1998 N° Lexbase : A0099YTT. La réforme maintient la compensation comme tempérament à l’immunité d’exécution. Mais, elle institue désormais une mesure de restriction à l’immunité d’exécution et une autre mesure facilitant le recouvrement des créances auprès des bénéficiaires de l’immunité d’exécution.
À titre de restriction, un bénéficiaire de l’immunité d’exécution relevant du droit interne ou du droit international a désormais la possibilité de renoncer à son immunité. Il y a tout de même lieu, à ce sujet, de déplorer que la renonciation prévue soit générale en lieu et place d’une renonciation spéciale généralement admise en droit comparé et en droit international.
Comme mesure facilitant le paiement, une créance due par un bénéficiaire de l’immunité d’exécution peut faire l’objet d’une inscription d’office dans son budget au titre de dépenses obligatoires. Il faut, toutefois, admettre que l’efficacité du recouvrement à travers cette inscription dépendra surtout de la volonté politique des intervenants dans le processus et du sérieux de ces personnes publiques débitrices dans l’exécution de leurs budgets.
Néanmoins, la renonciation comme mécanisme de relativisation de l’immunité d’exécution et la possibilité de faire inscrire la créance dans le budget d’une personne immunisée sont des réelles avancées dans la garantie d’une sécurité juridique et judiciaire au service de l’attraction des investissements des États membres. C’est aussi une contribution à l’effectivité du droit à l’exécution et à l’édification d’un État de droit dans l’espace communautaire.
Cependant, des faiblesses persistent même dans le texte révisé. En effet, si le législateur y a pris, cette fois-ci, la précaution d’énumérer les personnes immunisées, l’emploi, par lui, de l’adverbe « notamment » à l’article 30 de l’AUPSRVE N° Lexbase : A6607134 signifie que la liste n’est pas limitée. Pourtant, rien n’est dit sur l’autorité habilitée à compléter la liste. Ce qui est contre-productif dans la garantie de la sécurité juridique et judiciaire voulue dans l’espace OHADA.
Le législateur aurait dû, pourtant, tirer les enseignements du passé sur la même question pour emprunter la piste d’une liste close.
Bien plus, la substance de l’article 30-2 de l’acte uniforme révisé N° Lexbase : A6607134 est assez préoccupante. En effet, cette disposition permet au juge de prendre toutes les mesures urgentes appropriées lorsque des saisies conservatoires ou d’exécution pratiquées à l’égard des personnes morales autres que celles visées à l’article 30 sont de nature à porter gravement atteinte à la continuité du service public. Ces mesures sont prises à la demande du Ministère public ou de la personne morale concernée à condition, pour celle-ci, d’accomplir d’actes de nature à garantir ou à faciliter le paiement.
La disposition susmentionnée n’octroie, certes, pas d’immunité d’exécution à la catégorie des personnes qu’elle vise. Elle pose, pourtant, trois problèmes majeurs à même d’être à la base d’une nouvelle insécurité juridique et judiciaire. D’abord, il n’est pas aisé de déterminer avec exactitude les personnes placées sous ce régime. Ensuite, les mesures urgentes appropriées que le juge devra prendre ne sont pas précisées. C’est donc au juge lui-même de les imaginer au cas par cas. Un véritable pouvoir discrétionnaire inédit lui est conféré en cette matière avec un risque réel de le voir se verser dans l’arbitraire. Enfin, le pouvoir de saisir le juge reconnu au Ministère public aux fins de solliciter les mêmes mesures en faveur du créancier peut s’analyser en une immixtion qui brise l’équilibre qui doit être garanti entre le créancier et le débiteur dans la mise en œuvre des procédures d’exécution. Le droit à l’égalité des armes entre le créancier et le débiteur est aussi susceptible d’être remis en cause. Il y a lieu, par ailleurs, de craindre que le Ministère public devienne « un bras prolongé » de l’Exécutif pour faire obstruction aux saisies pratiquées à l’encontre des personnes morales créées par l’État pour assurer une mission de service public et cela, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs. De même, les actes de nature à garantir ou à faciliter le paiement que devra accomplir le débiteur pour amener à prendre les fameuses mesures urgentes appropriées ne sont précisés nulle part.
Ce qui précède nous amène à réaffirmer que l’article 30-2 risque de devenir un véritable vecteur d’insécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA. Il convient de voir en cela la volonté des États membres de l’OHADA d’accorder un privilège sui generis aux personnes investies d’une mission de service public créées par eux à défaut d’avoir réussi à obtenir une immunité d’exécution à leur faveur. Ceci est un recul par rapport à la jurisprudence de la CCJA précédemment évoquée qui soumettait, à l’exécution forcée, les entreprises publiques (transformées en sociétés commerciales), les sociétés d’État et mixtes même investies d’une mission de service public et cela, sans aménagement.
L’article 30-2 semble contraster, en tout cas, avec le discours officiel des États sur leur engagement de garantir la sécurité juridique et judiciaire dans l’espace communautaire. Ces États devraient réaliser que l’effectivité de l’exécution en vue de garantir la sécurité judiciaire et attirer les investisseurs ne concerne pas que les particuliers, mais aussi, eux-mêmes et leurs émanations.
En tout, cette disposition semble ne pas trouver sa place dans un arsenal juridique de l’OHADA destiné à garantir la sécurité juridique et judiciaire dans le domaine des affaires.
[1] Ph. Tiger, Le droit des affaires en Afrique (OHADA), PUF, 1999, pp.21-26.
[2] K. Mbaye, « Préface », in B. Martor et alii, Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, 2ème édition, Litec, 2004, p. 1.
[3] M. Diakhaté, « Les procédures simplifiées et les voies d’exécution : la difficile gestation d’une législation communautaire », disponible [en ligne]
[4] V. préambule du Traité de l’OHADA N° Lexbase : A6607134.
[5] V. article 1er du Traité de l’OHADA N° Lexbase : A6607134.
[6] E. Lelo Phuati, « De l’instauration d’un droit de l’exécution compatible avec l’objectif de la sécurité judiciaire dans l’espace OHADA », Lexbase Afrique-OHADA, octobre 2023, p.52 N° Lexbase : N7037BZN.
[7] F. Onana Etoundi, « La réforme des procédures de recouvrement et des voies d’exécution en droit OHADA : Étude pratique de législation et de jurisprudence », disponible sur le site [en ligne]
[8] Cl. Sejean-Chazal, « La réforme du droit OHADA de recouvrement », Lexbase Afrique-OHADA, mars 2024, p.17 N° Lexbase : N8864BZC.
[9] A-M. Assi-Esso et Nd. Diouf, Recouvrement des créances, Bruylant, 2002, p.3.
[10] J. Fometeu, « Théorie générale des voies d’exécution OHADA », in P-G. Pougoue (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p.2057.
[11] J. Djogbenou, L’exécution forcée droit OHADA, 2ème édition, CREDIJ, 2011, p.26.
[12] V. article 2 du Traité de l’OHADA.
[13] Du point de vue chronologique, cet acte uniforme fut le deuxième à être adopté. Ce qui peut être une expression de la place qui lui est accordée par les États dans l’arsenal juridique OHADA.
[14] En droit de l’exécution, l’immunité d’exécution est une protection dont bénéficient certaines personnes qui ne peuvent pas être l’objet d’une mesure d’exécution forcée (G. Couchez, D. Lebeau et O. Salati, Procédures civiles d’exécution, 13ème édition, Dalloz, 2021, p.30). En droit interne, l’immunité d’exécution est justifiée essentiellement par la mission d’intérêt général qui est confiée à ses bénéficiaires (personnes morales de droit public interne). En droit international, par contre, l’immunité d’exécution est, entre autres, consacrée en vertu du principe de l’égalité des États et de la courtoisie devant régner entre les États.
[15] F. Onana Etoundi, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA : À propos de l’arrêt n° 043/2005/CCJA du 7 juillet 2005 (Affaire Aziavi Yovo et Autres C/Société Togo Télécom), in Revue de Droit Africain, Actualité trimestrielle de droit et de jurisprudence, février 2010, p. 20.
[16] M. Sawadogo, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA », in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, Numéro spécial, février 2010, p.159.
[17] F. Onana Etoundi, Op.cit, p.20 ; M. Sawadogo, « L’immunité des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA », in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, Numéro spécial (2), février 2010, pp. 158-159.
[18] Toutefois, le nouveau texte ne régira que les procédures simplifiées, conservatoires et d’exécutions engagées après son entrée en vigueur. Celles engagées avant continueront à être réglementées par l’ancien AUPSRVE du 10 avril 1998 (V. article 337) N° Lexbase : A0099YTT.
[19] Lire utilement N-C-M. Ndiaye, « Présentation des innovations du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution », Lexbase Afrique-OHADA, Numéro 72, mars 2024, p.20-39 N° Lexbase : N8842BZI.
[20] Dans le cadre de cette étude, il faut entendre par personne immunisée, celle bénéficiant d’une immunité d’exécution. Il ne s’agit donc pas d’un bénéficiaire d’une immunité de juridiction.
[21] Cette thèse a été, entre autres, soutenue par la Société des Grands Hôtels du Congo dans une affaire qui l’a opposée à Sieur MBULU MUSESO devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Qualifié d’être une Société mixte et donc, non-bénéficiaire de l’immunité d’exécution consacrée par l’article 30, la Société des Grands Hôtels du Congo a rétorqué que la question de la détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution aurait été renvoyée au droit interne (v., CCJA., 3ème ch., 26 avril 2018, arrêt n° 103/2018 N° Lexbase : A2142Z8T).
[22] V. CCJA., 1ère Ch., 7 juillet 2005, arrêt n° 043/2005 N° Lexbase : A97312WC.
[23] V. CCJA., 14 mai 2020, arrêt n° 168/2020 N° Lexbase : A76137BL et CCJA., 1ère ch., 3 mars 2022, arrêt n° 053/2022 N° Lexbase : A59252HW.
[24] V. CCJA., Ass. Pl., 11 novembre 2014, arrêt n° 123/2014 N° Lexbase : A8794WQR.
[25] V. CCJA., Ass. Pl., 11 novembre 2014, arrêt n° 136/2014 N° Lexbase : A8794WQR.
[26] V. CCJA., 1ère Ch., 3 mars 2022, arrêt n° 053/2022 N° Lexbase : A59252HW; v.. CCJA., 1ère Ch., 28 novembre 2019, arrêt 267/2019 N° Lexbase : A48673AI et CCJA., 1ère Ch., 3 mars 2022, arrêt n° 060/2022 N° Lexbase : A86198KG.
[27] V. CCJA., 1ère Ch., 14 mai 2020, arrêt n° 168/2020 N° Lexbase : A76137BL.
[28] Nous y reviendrons dans la seconde partie de la présente étude.
[29] V. article 30 alinéa 1er de l’AUPSRVE révisé N° Lexbase : A6607134.
[30] V. article 30-3 de l’AUPSRVE révisé N° Lexbase : A6607134.
[31] V.. CCJA., Ass. Pl., 11 novembre 2024, arrêt n° 136/2014 N° Lexbase : A1248WRN.
[32] Cf. lecture croisée des articles 30 et 30-3 de l’AUPSRVE révisé N° Lexbase : A6607134.
[33] CCJA., 1ère Ch., 3 mars 2022, arrêt n° 053/2022 N° Lexbase : A59252HW.
[34] CCJA, Ass. Pl., du 11 novembre 2014, arrêt n° 136/2014 [LXB=1248WRN].
[35] F. Onana, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA : À propos de l’arrêt n° 043/2005 N° Lexbase : A97312WC et CCJA du 7 juillet 2005 (Affaire Aziablévi Yovo et Autres contre Société Togo Télécom » [en ligne]
[36] J. Djogbenou, Op.cit, p.61.
[37] Ibid., p.9.
[38] Cette méfiance peut se lire, par exemple, dans un contrat de prêt conclu entre l’Université Président Joseph Kasa Vubu (UKV) en République Démocratique du Congo et une institution financière dénommée la Rawbank SA. L’UKV est un établissement public d’Enseignement supérieur et universitaire et donc, bénéficiaire d’une immunité d’exécution aux termes de l’article 30 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution. Cherchant, à obtenir un crédit pour faire avancer les travaux de construction d’un bâtiment sur son campus, elle approcha la Rawbank pour solliciter un crédit. Celle-ci accepta d’accorder le prêt, mais, l’a conditionné par l’insertion, dans le contrat, d’une clause à travers laquelle l’UKV renonçait à son immunité d’exécution. Sous réserve de la validité juridique d’une telle clause au regard du cadre juridique de l’époque, il y a lieu d’y voir la réticence et la méfiance légitime de la Rawbank.
[38] Les avancées enregistrées sur le plan de la jurisprudence ne suffisaient pas surtout lorsqu’on sait que celle-ci était instable sur la question d’immunité d’exécution.
[39] C’est le deuxième alinéa de l’article 30 du nouvel acte uniforme sur les voies d’exécution N° Lexbase : A6607134 qui a reconduit la compensation comme tempérament à l’immunité d’exécution. Il dispose en effet : « Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité ».
[40] P. Leboulanger, « L’immunité des personnes morales de droit public », disponible sur le site [en ligne]
[41] Civ. 1re, 28 mars 2013, Clunet 2013. 899.
[42] G. Couchez, D. Lebeau et O. Salati, Op.cit., p.31.
[43] La CCJA a admis implicitement la possibilité de renoncer à l’immunité d’exécution dans une affaire qui avait opposé l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) à un collectif de ses ex employés. L’ASECNA est un Établissement Public International qui fut condamné à payer une somme 216 490 175 Francs CFA à un collectif de ses ex employés par les juridictions centrafricaines. Une saisie-attribution fut pratiquée sur ses créances placées dans des deux institutions financières basées en République centrafricaine. L’ASECNA a contesté cette saisie respectivement devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui et devant la Cour d’appel de Bangui en se prévalent de son immunité de juridiction et d’exécution en vertu d’un accord d’établissement passé avec la République centrafricaine. Les juridictions centrafricaines ont débouté l’ASECNA de sa contestation en considérant qu’elle avait « renoncé au bénéfice de son immunité d’exécution en comparaissant devant les tribunaux centrafricains et assuré sa défense sans se prévaloir de son immunité de juridiction, lors de la procédure judiciaire préalable à l’exécution ». La CCJA qui a été saisie de cette affaire sur pourvoi de l’ASECNA a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Bangui en considérant que l’ASECNA n’avait jamais renoncé à son immunité de juridiction et qu’au surplus le fait pour elle d’avoir comparu devant les juridictions centrafricaines « n’implique pas le consentement à l’exécution forcée, qui nécessite un consentement exprès distinct » (V. CCJA., 11 novembre 2014, arrêt n° 136/2014 N° Lexbase : A1248WRN.
[44] I. ADJI, « La révision de l’article 30 de l’AUPSRVE : la réduction du champ de protection de l’immunité d’exécution », Lexbase Afrique-OHADA, mars 2024, p.41 N° Lexbase : N8868BZH.
[45] L’acte uniforme révisé ne prévoit pas cette possibilité de faire inscrire les créances impayées dans les budgets de personnes morales étrangères (les États) et des Organisations internationales. Cela paraît logique puisque le contraire aurait dû être considéré comme une atteinte à l’indépendance de ces personnes relevant du droit public international.
[47] G. Cornu (sous dir.), Vocabulaire juridique, PUF, 2018, p.2008.
[48] Ibid., p.1263.
[50] J. Issa-Sayegh, P-G. Pougoue et M. Sawadogo, OHADA : Traité et actes uniformes commentés et annotés, 3ème édition, Juriscope, 2008, p.22.
[52] E. Lelo Phuati, « De l’instauration d’un droit de l’exécution compatible avec l’objectif de la sécurité judiciaire dans l’espace OHADA », Lexbase Afrique-OHADA, octobre 2023, p.53 N° Lexbase : N7037BZN.
[53] Ibid.
[54] Par service public, il faut entendre « aussi bien une activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général que l’organisme administratif chargé de la gestion d’une telle activité » (V. Gérard Cornu, Op.cit, p.2023
[56] Le droit à l’égalité des armes est retenu comme l’une des garanties de l’équité de la procédure. Il exige chaque partie puisse « se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire » (Cour eur. h. [GC], Ocalan c. Turquie, arrêt du 12 mai 2005).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
[Jurisprudence] L’éligibilité d’une créance à la procédure d’injonction de payer
par Fidèle DJONWE, Docteur en droit privé, Université de Ngaondéré (Cameroun), chargé de cours
Réf:CCJA, 1re ch., 25 mai 2023, Arrêt n°114/2023, Société Marojel SARL c/ Société Chantier Naval et Industriel du Cameroun N° Lexbase : A69082D9
NOTE : CCJA, 1re ch., 25 mai 2023, Arrêt n°114/2023, Société Marojel SARL c/ Société Chantier Naval et Industriel du Cameroun N° Lexbase : A69082D9
En date du 18 janvier 2017, la société Marojel Sarl obtenait du président du tribunal de grande instance du Wouri (Cameroun), une ordonnance d’injonction de payer[1], que contesta la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun au moyen d’une opposition en date du 16 mai 2017. L’opposition fut rejetée [2] au fond par le tribunal[3]. Insatisfaite de cette décision, la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun interjeta appel devant la Cour d’appel de Douala [4] le 1er juillet 2019. Celle-ci rendit un arrêt infirmatif, dit la créance de la société Marojel Sarl à l’égard de la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun inéligible à la procédure d’injonction de payer, d’où le présent pourvoi formé par la société Marojel Sarl. Il pose aux juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le problème de l’application des conditions d’éligibilité d’une créance à la procédure d’injonction de payer.
La société Chantier Naval et industriel du Cameroun, défenderesse, requerra l’irrecevabilité du pourvoi pour inexistence juridique de la société Marojel Sarl. Elle évoque en ce sens, d’une part, le défaut de production d’un extrait récent de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en violation des dispositions de l’article 28 alinéa 5 [5] du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. D’autre part, elle soulève la violation de l’article 28 alinéa 1 et 2 [6] du même règlement de procédure, en ce que la date de délivrance de l’expédition d’appel n’est pas mentionnée sur le recours. Or, celui-ci ayant été délivré le 18 avril 2020 à la société Marojel Sarl par le greffier en chef de la Cour d’appel du Littoral (Cameroun), elle avait jusqu’au 17 juin 2020 pour introduire son recours. Qu’ainsi, le recours introduit le 29 juin 2022 serait irrecevable.
La Cour rejeta cette exception soulevée par la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun. Elle relève, tout d’abord, que la société Marojel Sarl ayant produit l’extrait de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui renseigne qu’elle est immatriculée audit registre depuis le 05 novembre 2007. Cette pièce constitue, selon la Cour, une preuve suffisante de l’existence juridique de la société telle qu’exigée par l’article 28 alinéa 5 du Règlement susvisé. La Cour observe, ensuite que l’arrêt attaqué n’a jamais été signifié à la requérante par le défendeur auquel incombe cette obligation. À défaut d’une telle signification d’une, ce serait donc à tort que le défendeur au pourvoi soulève la forclusion du en raison de l’expiration du délai pour agir. En réalité, ce délai ne court qu’à compter du jour de la signification.
Venant au moyen unique du pourvoi, à savoir la violation des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE[7], les juges de la CCJA [8] ont précisé tout d’abord qu’il résulte de la lecture de l’article 1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que :
« Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer ».
Ensuite, il a été précisé suivant les termes de l’article 2 du même Acte uniforme[9], les conditions d’introduction de la procédure d’injonction de payer. Il en ressort que :
« la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : 1) la créance a une source contractuelle ; 2) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ».
Ainsi, pour conclure que la créance en cause n’était pas éligible à la procédure d’injonction de payer, il a été retenu que les caractères de certitude et de liquidité de ladite créance ne pouvaient être établis qu’aux termes d’une vérification des factures et des livraisons faites par une expertise. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la créance est justifiée par des factures émises par MAROJEL SARL à la suite des bons de commande émis par la société Chantier Naval et Industriel du Cameroun, et par les livraisons subséquentes réceptionnées, dont la preuve de paiement n’a pas été produite.
Pour apprécier l’éligibilité de la créance à la procédure d’injonction de payer, Cour observe d’abord que la créance dont le recouvrement est poursuivi a une origine contractuelle. Elle constate ensuite que ladite créance est connue et déterminée. Par ailleurs, celle-ci résulte des bons de commande émis par la société débitrice, suivis de bons de livraison de la société créancière dûment réceptionnés par la première. Enfin, des chèques émis par la débitrice sont restés impayés. Il résulte alors de ces constats qu’une telle créance remplit effectivement les critères imposés par l’article 1 et 2 de l’AUPSRVE.
[1] Ordonnance d’injonction de payer n°007/2017 du 18 janvier 2017 du Président du Tribunal de grande instance du Wouri.
[2] Jugement commercial n°247 rendus le 16 mai 2017 par le tribunal de grande instance du Wouri.
[3] Tribunal de Grande Instance du Wouri (Cameroun).
[4] Cameroun.
[5] Article 28 alinéa 5 du règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage : « Si le requérant est une personne morale, il joint à sa requête :
- Ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce et du crédit mobilier, ou toute autre preuve de son existence juridique ;
- La preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ».
[6] Article 28 alinéa 1 et 2 « (Règlement n°2014-01) Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée par l’Avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 du présent Règlement. Le recours contient
- a ) les nom et domicile du requérant ;
- b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur Avocat ;
- c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l’appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour.
2) La décision de la juridiction nationale qui fait l’objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant ».
[7] L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
[8] Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
[9] L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable